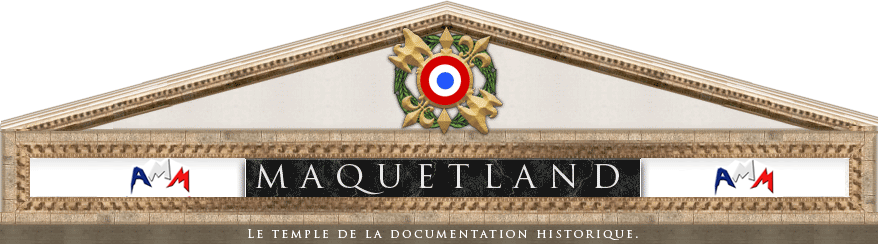La Légende des siècles
Nouvelle série
XXI
Le Temps présent
 |
| Le Cimetière d'Eylau |
À mes frères aînés, écoliers éblouis,
Ce qui suit fut conté par mon oncle Louis,
Qui me disait à moi, de sa voix la plus tendre :
— Joue, enfant ! — me jugeant trop petit pour comprendre.
J'écoutais cependant, et mon oncle disait :
— Une bataille, bah ! savez-vous ce que c'est ?
De la fumée. À l'aube on se lève, à la brune
On se couche ; et je vais vous en raconter une.
Cette bataille-là se nomme Eylau ; je crois
Que j'étais capitaine et que j'avais la croix ;
Oui, j'étais capitaine. Après tout, à la guerre,
Un homme, c'est de l'ombre, et ça ne compte guère,
Et ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Donc, Eylau
C'est un pays en Prusse ; un bois, des champs, de l'eau,
De la glace, et partout l'hiver et la bruine.
Le régiment campa près d'un mur en ruine ;
On voyait des tombeaux autour d'un vieux clocher.
Bénigssen ne savait qu'une chose, approcher
Et fuir ; mais l'empereur dédaignait ce manége.
Et les plaines étaient toutes blanches de neige.
Napoléon passa, sa lorgnette à la main.
Les grenadiers disaient : Ce sera pour demain.
Des vieillards, des enfants pieds nus, des femmes grosses
Se sauvaient ; je songeais ; je regardais les fosses.
Le soir on fit les feux, et le colonel vint,
Il dit : — Hugo ? — Présent. — Combien d'hommes ? — Cent-vingt.
— Bien. Prenez avec vous la compagnie entière,
Et faites-vous tuer. — Où ? — Dans le cimetière.
Et je lui répondis : — C'est en effet l'endroit.
J'avais ma gourde, il but et je bus ; un vent froid
Soufflait. Il dit : — La mort n'est pas loin. Capitaine,
J'aime la vie, et vivre est la chose certaine,
Mais rien ne sait mourir comme les bons vivants.
Moi, je donne mon cœur, mais ma peau, je la vends.
Gloire aux belles ! Trinquons. Votre poste est le pire. —
Car notre colonel avait le mot pour rire.
Il reprit : — Enjambez le mur et le fossé,
Et restez là ; ce point est un peu menacé,
Ce cimetière étant la clef de la bataille.
Gardez-le. — Bien. — Ayez quelques bottes de paille.
— On n'en a point. — Dormez par terre. — On dormira.
— Votre tambour est-il brave ? — Comme Barra.
— Bien. Qu'il batte la charge au hasard et dans l'ombre,
Il faut avoir le bruit quand on n'a pas le nombre.
Et je dis au gamin : — Entends-tu, gamin ? — Oui,
Mon capitaine, dit l'enfant, presque enfoui
Sous le givre et la neige, et riant. — La bataille,
Reprit le colonel, sera toute à mitraille ;
Moi, j'aime l'arme blanche, et je blâme l'abus
Qu'on fait des lâchetés féroces de l'obus ;
Le sabre est un vaillant, la bombe une traîtresse ;
Mais laissons l'empereur faire. Adieu, le temps presse.
Restez ici demain sans broncher. Au revoir.
Vous ne vous en irez qu'à six heures du soir. —
Le colonel partit. Je dis : — Par file à droite !
Et nous entrâmes tous dans une enceinte étroite ;
De l'herbe, un mur autour, une église au milieu,
Et dans l'ombre, au-dessus des tombes, un bon Dieu.
Un cimetière sombre, avec de blanches lames,
Cela rappelle un peu la mer. Nous crénelâmes
Le mur, et je donnai le mot d'ordre, et je fis
Installer l'ambulance au pied du crucifix.
— Soupons, dis-je, et dormons. La neige cachait l'herbe ;
Nos capotes étaient en loques ; c'est superbe,
Si l'on veut, mais c'est dur quand le temps est mauvais.
Je pris pour oreiller une fosse ; j'avais
Les pieds transis, ayant des bottes sans semelle ;
Et bientôt, capitaine et soldats pêle-mêle,
Nous ne bougeâmes plus, endormis sur les morts.
Cela dort, les soldats ; cela n'a ni remords,
Ni crainte, ni pitié, n'étant pas responsable ;
Et, glacé par la neige ou brûlé par le sable,
Cela dort ; et d'ailleurs, se battre rend joyeux.
Je leur criai : Bonsoir ! et je fermai les yeux ;
À la guerre on n'a pas le temps des pantomimes.
Le ciel était maussade, il neigeait, nous dormîmes.
Nous avions ramassé des outils de labour,
Et nous en avions fait un grand feu. Mon tambour
L'attisa, puis s'en vint près de moi faire un somme.
C'était un grand soldat, fils, que ce petit homme.
Le crucifix resta debout, comme un gibet.
Bref, le feu s'éteignit ; et la neige tombait.
Combien fut-on de temps à dormir de la sorte ?
Je veux, si je le sais, que le diable m'emporte !
Nous dormions bien. Dormir, c'est essayer la mort.
À la guerre c'est bon. J'eus froid, très-froid d'abord ;
Puis je rêvai ; je vis en rêve des squelettes
Et des spectres, avec de grosses épaulettes ;
Par degrés, lentement, sans quitter mon chevet,
J'eus la sensation que le jour se levait,
Mes paupières sentaient de la clarté dans l'ombre ;
Tout à coup, à travers mon sommeil, un bruit sombre
Me secoua, c'était au canon ressemblant ;
Je m'éveillai ; j'avais quelque chose de blanc
Sur les yeux ; doucement, sans choc, sans violence,
La neige nous avait tous couverts en silence
D'un suaire, et j'y fis, en me dressant un trou ;
Un boulet, qui nous vint je ne sais trop par où,
M'éveilla tout à fait ; je lui dis : Passe au large !
Et je criai : — Tambour, debout ! et bats la charge !
Cent-vingt têtes alors, ainsi qu'un archipel,
Sortirent de la neige ; un sergent fit l'appel,
Et l'aube se montra, rouge, joyeuse et lente ;
On eût cru voir sourire une bouche sanglante.
Je me mis à penser à ma mère ; le vent
Semblait me parler bas ; à la guerre souvent
Dans le lever du jour c'est la mort qui se lève.
Je songeais. Tout d'abord nous eûmes une trêve ;
Les deux coups de canon n'étaient rien qu'un signal,
La musique parfois s'envole avant le bal
Et fait danser en l'air une ou deux notes vaines.
La nuit avait figé notre sang dans nos veines,
Mais sentir le combat venir, nous réchauffait.
L'armée allait sur nous s'appuyer en effet ;
Nous étions les gardiens du centre, et la poignée
D'hommes sur qui la bombe, ainsi qu'une cognée,
Va s'acharner ; et j'eusse aimé mieux être ailleurs.
Je mis mes gens le long du mur ; en tirailleurs.
Et chacun se berçait de la chance peu sûre
D'un bon grade à travers une bonne blessure ;
À la guerre on se fait tuer pour réussir.
Mon lieutenant, garçon qui sortait de Saint-Cyr,
Me cria : — Le matin est une aimable chose ;
Quel rayon de soleil charmant ! La neige est rose !
Capitaine, tout brille et rit ! quel frais azur !
Comme ce paysage est blanc, paisible et pur !
— Cela va devenir terrible, répondis-je.
Et je songeais au Rhin, aux Alpes, à l'Adige,
À tous nos fiers combats sinistres d'autrefois.
Brusquement la bataille éclata. Six cents voix
Énormes, se jetant la flamme à pleines bouches,
S'insultèrent du haut des collines farouches,
Toute la plaine fut un abîme fumant,
Et mon tambour battait la charge éperdûment.
Aux canons se mêlait une fanfare altière,
Et les bombes pleuvaient sur notre cimetière,
Comme si l'on cherchait à tuer les tombeaux ;
On voyait du clocher s'envoler les corbeaux ;
Je me souviens qu'un coup d'obus troua la terre,
Et le mort apparut stupéfait dans sa bière,
Comme si le tapage humain le réveillait.
Puis un brouillard cacha le soleil. Le boulet
Et la bombe faisaient un bruit épouvantable.
Berthier, prince d'empire et vice-connétable,
Chargea sur notre droite un corps hanovrien
Avec trente escadrons, et l'on ne vit plus rien
Qu'une brume sans fond, de bombes étoilée ;
Tant toute la bataille et toute la mêlée
Avaient dans le brouillard tragique disparu.
Un nuage tombé par terre, horrible, accru
Par des vomissements immenses de fumées,
Enfants, c'est là-dessous qu'étaient les deux armées ;
La neige en cette nuit flottait comme un duvet,
Et l'on s'exterminait, ma foi, comme on pouvait.
On faisait de son mieux. Pensif, dans les décombres,
Je voyais mes soldats rôder comme des ombres ;
Spectres le long du mur rangés en espalier ;
Et ce champ me faisait un effet singulier,
Des cadavres dessous et dessus des fantômes.
Quelques hameaux flambaient ; au loin brûlaient des chaumes.
Puis la brume où du Harz on entendait le cor
Trouva moyen de croître et d'épaissir encor,
Et nous ne vîmes plus que notre cimetière ;
À midi nous avions notre mur pour frontière,
Comme par une main noire, dans de la nuit,
Nous nous sentîmes prendre, et tout s'évanouit.
Notre église semblait un rocher dans l'écume.
La mitraille voyait fort clair dans cette brume,
Nous tenait compagnie, écrasait le chevet
De l'église, et la croix de pierre, et nous prouvait
Que nous n'étions pas seuls dans cette plaine obscure.
Nous avions faim, mais pas de soupe ; on se procure
Avec peine à manger dans un tel lieu. Voilà
Que la grêle de feu tout à coup redoubla.
La mitraille, c'est fort gênant ; c'est de la pluie ;
Seulement ce qui tombe et ce qui vous ennuie,
Ce sont des grains de flamme et non des gouttes d'eau.
Des gens à qui l'on met sur les yeux un bandeau,
C'était nous. Tout croulait sous les obus, le cloître,
L'église et le clocher, et je voyais décroître
Les ombres que j'avais autour de moi debout ;
Une de temps en temps tombait. — On meurt beaucoup,
Dit un sergent pensif comme un loup dans un piége ;
Puis il reprit, montrant les fosses sous la neige :
— Pourquoi nous donne-t-on ce champ déjà meublé ? —
Nous luttions. C'est le sort des hommes et du blé
D'être fauchés sans voir la faulx. Un petit nombre
De fantômes rôdait encor dans la pénombre ;
Mon gamin de tambour continuait son bruit ;
Nous tirions par-dessus le mur presque détruit.
Mes enfants, vous avez un jardin ; la mitraille
Était sur nous, gardiens de cette âpre muraille,
Comme vous sur les fleurs avec votre arrosoir.
— Vous ne vous en irez qu'à six heures du soir.
Je songeais, méditant tout bas cette consigne.
Des jets d'éclairs mêlés à des plumes de cygne,
Des flammèches rayant dans l'ombre les flocons,
C'est tout ce que nos yeux pouvaient voir. — Attaquons !
Me dit le sergent. — Qui ? dis-je, on ne voit personne.
— Mais on entend. Les voix parlent ; le clairon sonne.
Partons, sortons ; la mort crache sur nous ici ;
Nous sommes sous la bombe et l'obus. — Restons-y.
J'ajoutai : — C'est sur nous que tombe la bataille.
Nous sommes le pivot de l'action. — Je bâille,
Dit le sergent. — Le ciel, les champs, tout était noir ;
Mais quoiqu'en pleine nuit, nous étions loin du soir,
Et je me répétais tout bas : Jusqu'à six heures.
— Morbleu ! nous aurons peu d'occasions meilleures
Pour avancer ! me dit mon lieutenant. Sur quoi,
Un boulet l'emporta. Je n'avais guère foi
Au succès ; la victoire au fond n'est qu'une garce.
Une blême lueur, dans le brouillard éparse,
Éclairait vaguement le cimetière. Au loin
Rien de distinct, sinon que l'on avait besoin
De nous pour recevoir sur nos têtes les bombes.
L'empereur nous avait mis là, parmi ces tombes ;
Mais, seuls, criblés d'obus et rendant coups pour coups,
Nous ne devinions pas ce qu'il faisait de nous.
Nous étions, au milieu de ce combat, la cible.
Tenir bon, et durer le plus longtemps possible,
Tâcher de n'être morts qu'à six heures du soir,
En attendant, tuer, c'était notre devoir.
Nous tirions au hasard, noirs de poudre, farouches ;
Ne prenant que le temps de mordre les cartouches,
Nos soldats combattaient et tombaient sans parler.
— Sergent, dis-je, voit-on l'ennemi reculer ?
— Non. — Que voyez-vous ? — Rien. — Ni moi. — C'est le déluge,
Mais en feu. — Voyez-vous nos gens ? — Non. Si j'en juge
Par le nombre de coups qu'à présent nous tirons,
Nous sommes bien quarante. — Un grognard à chevrons
Qui tiraillait pas loin de moi dit : — On est trente.
Tout était neige et nuit ; la bise pénétrante
Soufflait, et, grelottants, nous regardions pleuvoir
Un gouffre de points blancs dans un abîme noir.
La bataille pourtant semblait devenir pire.
C'est qu'un royaume était mangé par un empire !
On devinait derrière un voile un choc affreux ;
On eût dit des lions se dévorant entr'eux ;
C'était comme un combat des géants de la fable ;
On entendait le bruit des décharges, semblable
À des écroulements énormes ; les faubourgs
De la ville d'Eylau prenaient feu ; les tambours
Redoublaient leur musique horrible, et sous la nue
Six cents canons faisaient la basse continue ;
On se massacrait ; rien ne semblait décidé ;
La France jouait là son plus grand coup de dé ;
Le bon Dieu de là-haut était-il pour ou contre ?
Quelle ombre ! et je tirais de temps en temps ma montre.
Par intervalle un cri troublait ce champ muet,
Et l'on voyait un corps gisant qui remuait.
Nous étions fusillés l'un après l'autre, un râle
Immense remplissait cette ombre sépulcrale.
Les rois ont les soldats comme vous vos jouets.
Je levais mon épée, et je la secouais
Au-dessus de ma tête, et je criais : Courage !
J'étais sourd et j'étais ivre, tant avec rage
Les coups de foudre étaient par d'autres coups suivis ;
Soudain mon bras pendit, mon bras droit, et je vis
Mon épée à mes pieds, qui m'était échappée ;
J'avais un bras cassé ; je ramassai l'épée
Avec l'autre, et la pris dans ma main gauche : — Amis !
Se faire aussi casser le bras gauche est permis !
Criai-je, et je me mis à rire, chose utile,
Car le soldat n'est point content qu'on le mutile,
Et voir le chef un peu blessé ne déplaît point.
Mais quelle heure était-il ? Je n'avais plus qu'un poing,
Et j'en avais besoin pour lever mon épée ;
Mon autre main battait mon flanc, de sang trempée,
Et je ne pouvais plus tirer ma montre. Enfin
Mon tambour s'arrêta : — Drôle, as-tu peur ? — J'ai faim,
Me répondit l'enfant. En ce moment la plaine
Eut comme une secousse, et fut brusquement pleine
D'un cri qui jusqu'au ciel sinistre s'éleva.
Je me sentais faiblir ; tout un homme s'en va
Par une plaie ; un bras cassé, cela ruisselle ;
Causer avec quelqu'un soutient quand on chancelle ;
Mon sergent me parla ; je dis au hasard : Oui,
Car je ne voulais pas tomber évanoui.
Soudain le feu cessa, la nuit sembla moins noire.
Et l'on criait : Victoire ! et je criai : Victoire !
J'aperçus des clartés qui s'approchaient de nous.
Sanglant, sur une main et sur les deux genoux
Je me traînai ; je dis : — Voyons où nous en sommes.
J'ajoutai : — Debout, tous ! Et je comptai mes hommes.
— Présent ! dit le sergent. — Présent ! dit le gamin.
Je vis mon colonel venir, l'épée en main.
— Par qui donc la bataille a-t-elle été gagnée ?
— Par vous, dit-il. — La neige était de sang baignée.
Il reprit : — C'est bien vous, Hugo ? c'est votre voix ?
— Oui. — Combien de vivants êtes-vous ici ? — Trois.
Lire et Voir Aussi Read and See Also
Bataille d'Eylau 1807
Tableau Napoléon visitant le champ de bataille d’Eylau Baron Gros