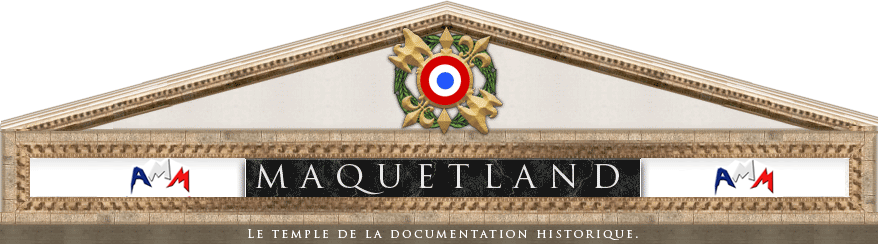
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Texte intégral
1Durant la période qui va de 1792 à 1811, certaines poursuites criminelles ne donnèrent pas lieu à des procès par jurés. Les premières procédures d’exception furent ordonnées par l’État en mars 1793. Aiguillonnés par le souci de la « sûreté publique », les Conventionnels ne se contentèrent pas de créer le tribunal révolutionnaire de Paris, ils autorisèrent de surcroît les tribunaux criminels à juger sans jurés certains crimes politiques. Les lois spéciales contre les émigrés et les prêtres réfractaires sont restés en vigueur tout au long du Directoire. Quant à Napoléon, tout en mettant fin à la situation qui justifiait ces lois, il institua en 1801 et 1802 ses propres juridictions exceptionnelles pour juger les crimes censés menacer la stabilité de l’État. Le domaine de compétence du nouveau jury de jugement, pièce maîtresse des réformes judiciaires de la Révolution, fut ainsi restreint par les législateurs – dans le but d’assurer un châtiment prompt et exemplaire de certains délits « sensibles ».
2La première brèche dans la procédure instituée par l’Assemblée constituante apparut en mars 1793. Les soulèvements dans l’ouest de la France poussèrent la Convention à promulguer une loi destinée à faire respecter la levée de 300 000 hommes, et à décourager la résistance à l’appel dans le reste du pays. La loi du 19 mars 1793, qui a été négligée par la plupart des ouvrages généraux sur la Révolution, a joué un rôle crucial dans l’évolution de la justice révolutionnaire. Le premier article annonçait une nouvelle conception du processus judiciaire :
3Les accusés sont « hors de la loi » : cette formule manifeste un changement radical des postulats de base de la Convention en matière de justice. Avant mars 1793, le langage du droit exprimait les tendances universalistes et légalistes des révolutionnaires. Dans la législation de 1791, même les crimes politiques graves comme la rébellion et la résistance armée à l’État étaient soumis au jury. Encore en janvier 1793, le roi en personne était considéré par la majorité des Conventionnels comme « dans la loi » : il était un citoyen ordinaire que ses crimes avaient déchu de son impunité et dont les actes (comme ceux de tout autre citoyen) pouvaient être jugés dans le cadre de la loi2.
4Et pourtant, quelques jours après le début du soulèvement en Vendée, l’idée d’une justice d’exception triompha chez les Conventionnels : on décréta que certaines personnes ne seraient plus jugées selon les règles de droit en vigueur. Cette conception reposait sur les arguments avancés par Saint-Just et Robespierre lors du procès de Louis XVI. Les deux tribuns de la Révolution jacobine affirmaient que le roi devait être « jugé comme un ennemi » et non selon la procédure judiciaire établie3. Leur position fut rejetée à l’époque, mais dans l’atmosphère tendue de mars 1793, les arguments en faveur d’une justice d’exception l’emportèrent. Ils furent toutefois modifiés en cours de route. Saint-Just avait soutenu que le roi ne devait pas bénéficier des formes légales normales puisque son identité particulière, qui incarnait la monarchie, était en elle-même exceptionnelle ; en revanche, par la loi du 19 mars, les Conventionnels fondaient désormais leurs réserves sur la conduite des accusés. Pour la Convention, le fait de résister à la levée des 300 000 hommes constituait un acte de rébellion. Les réfractaires à la levée défiaient la loi républicaine et ne pouvaient prétendre bénéficier des prérogatives que celle-ci accordait aux accusées. Ils étaient des non-citoyens, des « hors de la loi ».
5La signification de cette loi allait bien au-delà d’un simple refus de leur accorder un procès par jurés. De pair avec la législation de la Convention sur les émigrés et les prêtres réfractaires, elle transformait la nature même de la procédure judiciaire4. Les accusés n’avaient plus droit à un véritable « procès » au sens habituel du terme. L’article 2 prévoyait que les personnes appréhendées les armes à la main comparaîtraient devant une commission militaire et seraient exécutées « après que le fait [de la résistance à la levée] aura été reconnu ou déclaré constant […]5 ». De même, les personnes capturées sans armes, mais soupçonnées d’avoir participé à une « révolte » ou un « attroupement », se voyaient dénier le droit à un procès normal devant un tribunal criminel. Ils devaient être envoyés dans une maison de justice (une prison rattachée au tribunal criminel du département) :
6Il n’était plus question de peser les mobiles ou d’évaluer les circonstances atténuantes. Il s’agissait seulement de confirmer les faits. Quant aux « preuves légales », la Convention les trouva dans l’arsenal juridique de l’Ancien Régime. Devant les tribunaux criminels et les commissions militaires, il suffisait désormais d’un rapport verbal ou signé par deux témoins, ou encore d’un rapport signé par un témoin et confirmé oralement par un autre témoin7. Bref, la comparution de l’accusé avait une simple fonction de vérification. La guerre civile faisait rage : le crime de rébellion ne devait donner lieu à des débats, puisque cela reviendrait à remettre en cause la légitimité de l’État et de ses lois.
7La loi du 19 mars fut immédiatement appliquée en Vendée. En mars et en avril, le tribunal criminel jugea 104 personnes accusées de révolte armée et ordonna 16 exécutions8. De fait, avant la création de la commission militaire de Fontenay en décembre 1793, le tribunal criminel fut l’une des rares institutions judiciaires mobilisées par les autorités républicaines pour punir les insurgés du département. Il cessa provisoirement de fonctionner lorsque les rebelles s’emparèrent de Fontenay au cours de l’été. Quand il reprit ses audiences en octobre, le tribunal se consacra presque exclusivement à des affaires jugées au titre de loi du 19 mars. Entre octobre et décembre 1793, il statua sur le sort de 117 personnes soupçonnées de rébellion armée et en fit exécuter 32. Conformément aux ordres de la Convention nationale, les juges distinguèrent les « chefs » de la révolte et les simples participants : la peine de mort était réservée aux meneurs. Parmi les 32 personnes exécutées à Fontenay vers la fin de l’année 1793, on dénombre 14 artisans ou petits commerçants et 9 notables de villages ou fonctionnaires situés en zone rebelle. Concernant ces derniers, le tribunal criminel estima que leur soutien à la rébellion constituait un élément suffisant pour prononcer la peine capitale9. Mais en décembre, le tribunal perdit toute compétence pour juger les cas de rébellion. Excédé par le grand nombre de prisonniers et la relative lenteur des procédures au tribunal criminel de la Vendée, le représentant en mission Lequino instaura une commission militaire à Fontenay. Celle-ci avait compétence pour juger les affaires de révolte armée et contribua à accélérer le rythme des exécutions. De toute évidence, il y avait une différence essentielle entre le concept de « justice d’exception » de Lequinio et les principes de Dupuy, l’accusateur public du tribunal criminel : tandis que Lequinio se plaignait le 11 décembre que « la procédure au tribunal criminel du département est encore trop embarrassée de forme et entraîne trop de longueurs », Dupuy affirmait dix jours plus tôt que des rebelles présumés avaient été relâchés en l’absence d’« une preuve complète » et écrivait aux maires, officiers municipaux et juges de paix de la Vendée, leur demandant de recueillir des témoignages contre les personnes soupçonnées de révolte armée10.
8En dehors de la Vendée et des départements avoisinants, les tribunaux criminels usèrent rarement de la loi du 19 mars pour punir la résistance à la levée des 300 000 hommes. La plupart des représentants envoyés par la Convention pour contrôler le bon déroulement de la levée estimèrent qu’il n’était pas nécessaire d’appliquer ses dispositions. Parmi les seize tribunaux criminels que nous avons étudiés, seuls ceux de la Vendée, du Finistère, de la Haute-Garonne et de la Côte-d’Or y ont eu recours pour châtier les récalcitrants à la levée. Outre les 48 condamnations à mort déjà signalées en Vendée, on compte au total seulement 5 exécutions11.
9On a l’impression que les tribunaux criminels ont hésité à appliquer cette loi. Élus presque tous en 1791 et partisans des principes de 1789, les magistrats en poste au printemps de 1793 ont dû regretter l’intensification des conflits politiques après la chute de la monarchie et le recours à des mesures pénales draconiennes. Dans le Finistère, par exemple, le tribunal appliqua rarement la nouvelle loi dans toute sa rigueur. Malgré une opposition répandue à la levée des 300 000 hommes, seules 2 exécutions pour rébellion armée furent ordonnées en vertu des dispositions de la loi du 19 mars. Par contre, le même tribunal criminel acquitta et relâcha 169 rebelles présumés. Les dossiers de ces jugements suggèrent que les magistrats de Quimper – tout comme leurs collègues de Fontenay – cherchaient à obtenir des preuves légales, généralement des témoignages oraux cohérents ou des dépositions écrites de deux témoins. Le 20 avril, les juges ont exonéré 14 hommes accusés de rébellion au motif qu’il n’existait « aucun procès-verbal, aucune indication de témoins ni aucuns faits tendant à inculper directement ou indirectement les nommés […] ». Le fait que tant de prévenus en Finistère aient été relaxés en avril et en mai, faute de preuves, révèle non seulement les scrupules des juges mais aussi la réticence des témoins à déposer publiquement contre des rebelles présumés, soit par peur de représailles soit par sympathie avec les accusés12.
10Dans les provinces éloignées des champs de bataille de l’Ouest, certains magistrats ont pu considérer le recours à une justice d’exception contre les insoumis armés comme une réaction tragique et exagérée. En Côte-d’Or, par exemple, la jeunesse n’a offert qu’une résistance ponctuelle à la levée13. Toutefois, le tribunal criminel de Dijon siégea sans jurés le 2 avril 1793 pour juger Lazare Fondard, domestique d’une « fille ci-devant noble » de Dijon, accusé d’avoir appelé à un soulèvement armé. Il était soupçonné d’avoir commis ce crime le 17 mars dans une taverne du village de Daix, tout près de Dijon. Selon deux témoins, Fondard déclara à un groupe de jeunes gens qu’ils devaient se révolter contre les gens de la ville, que « si c’était pour un roi, à la bonne heure, mais que pour la nation il ne fallait pas se remuer14 ». Fondard fut promptement interpellé et envoyé devant les magistrats du tribunal criminel.
11En tant que serviteur d’un noble, Fondard était incontestablement en position de faiblesse. Selon la loi du 19 mars, la peine de mort s’appliquait non seulement à tous ceux qui incitaient la population à la révolte, mais également à tous les nobles, émigrés, ou « les agents et domestiques de toutes ces personnes » impliqués dans des troubles15. Cette dernière disposition touchait une corde sensible à Dijon, où vivaient de nombreux domestiques, souvent employés ou ex-employés de nobles, et qui abritait une masse considérable de gens hostiles à la Révolution16. Les autorités locales craignaient que l’opposition à la levée des 300 000 hommes prenne une tournure explosive dans les campagnes : elles redoutaient une jonction entre les contestataires urbains et les jeunes villageois. Comme le montrent les procès-verbaux du dossier, les magistrats voulaient à tout prix savoir si Fondard appartenait à un réseau de domestiques qui conspiraient pour fomenter une rébellion contre les autorités constituées. On le voit, le statut social de Fondard ainsi que la nature de son crime présumé le rendaient juridiquement vulnérable.
12À l’occasion de ce procès, on put se rendre compte que les représentants en mission n’avaient guère confiance dans le président du tribunal criminel : Jean-Edme Durande fut poussé à démissionner. Un observateur de l’époque nota dans son journal qu’après l’arrivée à Dijon des députés Bourdon et Prost, dépêchés par la Convention pour superviser la levée des 300 000 hommes, « on fit dire à M. Durande, président du tribunal criminel, qu’il voulait bien s’absenter de ce tribunal pendant la quinzaine parce qu’il n’y prononcerait probablement pas des sentences qui pourraient exciter sa sensibilité17 ». Au procès de Fondard, le premier qui se déroula sans jury en Côte-d’Or, le remplaçant de Durande et trois juges ordinaires déclarèrent l’accusé coupable d’avoir incité la population à refuser la levée. Les magistrats contrôlèrent la véracité des dépositions des témoins, selon lesquelles l’accusé avait bien prononcé les paroles en question le 17 mars, vérifièrent qu’il était bien le domestique d’une aristocrate, et appliquèrent – rétroactivement – les dispositions de la loi du 19 mars. Le lendemain, à midi, Fondard était guillotiné18.
13Conçue au départ comme un expédient provisoire, cette loi devint en fait une arme permanente du gouvernement révolutionnaire. Trois semaines à peine après sa promulgation, la Convention nationale décida d’élargir ses attributions. Le 7 avril 1793, les tribunaux criminels furent autorisés à se transporter jusqu’aux sièges de district de leur département pour y juger les rebelles présumés selon la procédure prévue par la loi du 19 mars. Parmi les seize tribunaux concernés par notre étude, quatre ont mis à profit cette disposition. En mai 1793, le tribunal de Vendée jugea des rebelles présumés aux Sables-d’Olonne, sans toutefois ordonner d’exécutions ; le tribunal du Cher se transporta à Sancoin et à Dun-sur-Auron en 1793 et en germinal de l’an II, pour y juger 13 personnes (dont 3 furent exécutées) ; le tribunal criminel du Finistère passa le mois d’avril à Brest, où il décida du sort de 162 accusés et prononça deux fois la peine capitale. Jeanbon-Saint-André ordonna à ce même tribunal de retourner à Brest en nivôse an II : il y envoya 4 personnes à la guillotine pour avoir participé à des mouvements d’insubordination dans la marine. En mai 1793, le tribunal de Dax fut transféré à Saint-Sever et à Tartas, mais les registres judiciaires du département des Landes n’ont pas consigné les actes du tribunal lors de ce séjour19.
14La loi du 9 avril 1793 avait une portée encore plus considérable. Cette mesure appliquait les dispositions de la loi du 19 mars à toute personne soupçonnée d’avoir exprimé une opinion favorable au retour de la monarchie, ou d’avoir participé à une rébellion armée, quelle qu’en soit la nature (qu’elle vise la levée des 300 000 hommes, ou non). Cette loi représentait la sanction la plus sévère prévue par les Conventionnels contre les propos séditieux. Bien qu’elle fût rarement appliquée pour de telles infractions et encore moins pour sanctionner des actes de rébellion, elle renforçait l’arsenal répressif des « clubistes » locaux montés en grade et des représentants en mission. Sous la Terreur, dans les seize départements étudiés, 14 personnes furent exécutées au titre de ses dispositions : 8 pour « propos contre-révolutionnaires », une pour sa participation à une révolte fédéraliste, et 5 pour résistance violente à la levée en masse de septembre 179320.
15Quelques jours après le vote de la loi du 19 mars, la Convention adopta une mesure législative encore plus consistante : la loi des 28 mars et 5 avril 1793 contre les émigrés. Préparée avec le plus grand soin, elle joua un rôle important dans le processus qui conduisit à la Terreur et constitue une des dérives les plus significatives du système judiciaire institué par l’Assemblée constituante. La loi du 28 mars 1793 déniait aux personnes soupçonnées d’émigration le droit à un procès par jurés. Les députés proclament que les émigrés sont « bannis à perpétuité du territoire français ; ils sont morts civilement…21 ». Ces mots, imprimés en italique dans la loi, confirmaient les nouvelles notions judiciaires inaugurées par la loi du 19 mars. Ils annonçaient une multiplication rapide du nombre des « non-citoyens », privés de leurs droits légaux en raison de leurs forfaits présumés. Dorénavant, les personnes accusées d’émigration étaient jugées par des tribunaux criminels sans jurys. De tels procès étaient de simples formalités, où l’on se contentait de vérifier les faits22. Si le nom du prévenu figurait sur la liste départementale des émigrés, et que deux témoins confirmaient son identité, il était condamné et exécuté dans les vingt-quatre heures sans appel23.
16L’impact judiciaire de cette loi peut être jaugé en examinant de près son application en Côte-d’Or, où un nombre exceptionnellement élevé d’émigrés ont été jugés et guillotinés. Jusqu’au deuxième séjour du représentant en mission Bernard de Saintes, qui débuta le 16 pluviôse an II (4 février 1794), les émigrés présumés languissaient dans les geôles du département24. Avant l’arrivée de Bernard, seules deux affaires avaient été jugées : elles avaient donné lieu à des simples peines d’emprisonnement, les juges ayant reconnu aux accusés des circonstances atténuantes25. Mais lorsque l’émissaire de la Convention débarque à Dijon, la machine à condamner se met en branle. En deux mois, du 16 pluviôse au 21 germinal, le tribunal criminel juge 14 personnes pour émigration. Neuf d’entre elles périront sur l’échafaud et 5 seront acquittées ou bénéficieront d’un non-lieu. Les 9 guillotinés sont tous des domestiques ou des parlementaires, alors que les 5 relaxés appartiennent à d’autres catégories sociales – et ce n’est certainement pas là l’effet du hasard.
17Le cas de Jean-François Ferrand, domestique à Dijon, illustre bien la forme habituelle des poursuites engagées au titre de la loi sur les émigrés. En octobre 1791, Ferrand se rendit en Suisse pour rejoindre son employeur, qui (selon l’accusé) lui avait écrit une lettre de Fribourg requérant sa présence et qui lui devait 600 livres. Un an plus tard, il était de retour à Dijon. Ni lui, ni sa femme n’obéirent à l’ordre de la Convention enjoignant à tous les émigrés de quitter la France sous peine de mort ; le 19 janvier 1793, Ferrand fut dénoncé au juge de paix et arrêté le jour même. Il passa plus d’un an en prison. Le 5 frimaire (25 novembre 1793), les magistrats du tribunal criminel soumirent l’affaire aux administrateurs départementaux. Mais ceux-ci ne remirent leur rapport obligatoire que le 1er ventôse an II (19 février 1794). Ils déclarèrent que Ferrand avait quitté le pays et était revenu le 8 novembre 1792, qu’il avait omis de quitter le territoire français durant la période prévue par la loi du 26 novembre 1792, et qu’il figurait sur la liste des émigrés du département. Onze jours plus tard les magistrats se réunirent de nouveau et, après avoir suivi la procédure formelle d’exception (qui prévoyait une déclaration du défenseur), envoyèrent Ferrand à la guillotine. L’exécution eut lieu à 14h30, l’après-midi même26.
18Comme Ferrand, d’autres domestiques ont confessé bien volontiers avoir émigré. Était-ce par naïveté, ou faute de conseils avisés ? Toujours est-il que les 6 serviteurs poursuivis en Côte-d’Or pour ce crime ont tous reconnu avoir quitté le territoire français. Aucun des accusés n’a répondu aux accusations avec autant de candeur que Jean Masson. Ce domestique de 33 ans du village de Drée fut arrêté le 14 octobre 1793. Dès le départ, il fut trop prolixe et ne put s’empêcher de raconter son histoire à un soldat arrêté avec lui pour défaut de passeport, et qui rapporta aux gardes nationaux que son compagnon « avait été avec les émigrés à Longwy ».
19L’histoire de Masson est intéressante parce qu’elle met en lumière la situation rocambolesque de nombreux villageois pris dans le tohu-bohu politique et militaire des années 1790. Masson reconnut lors de son interrogatoire qu’il s’était rendu à Fribourg en 1791 avec l’ancien curé de Drée. Au bout de dix jours, le curé lui annonça qu’il ne pouvait plus payer ses services ; il s’engagea donc chez un noble émigré et voyagea avec lui à travers la Suisse, la Prusse et l’Empire. Lorsqu’on lui demanda s’il avait porté les armes contre la République à Coblence, Masson répondit que son maître avait rejoint la 5e Brigade de Mousquetaires de l’armée royaliste, et qu’il l’avait donc servi en s’occupant de son cheval et de ses affaires. Pendant le siège de Longwy, Masson déserta le camp des émigrés et revint en France. Plus tard, il rejoignit l’artillerie de l’armée républicaine de Nice, fut fait prisonnier par l’armée du Piémont, qui (affirmait-il) l’obligea à porter les armes contre la France. Il resta chez les « Piémontais » pendant trois semaines, puis s’évada et s’engagea dans l’armée française sous les ordres du Général Brunet, qui lui remit son certificat de congé. Rentré à Drée, Masson s’apprêtait (toujours selon ses propres dires) à rejoindre les armées de la République au prochain appel, mais fut arrêté avant de pouvoir mettre ce projet à exécution.
20Cette confession spontanée, offerte par un paysan illettré d’un village du nord de la Bourgogne, ne paraît pas avoir ému les autorités. Le 14 ventôse, le tribunal, après avoir pris connaissance du rapport des administrateurs départementaux (« Masson demeure compris sur la liste des émigrés, et réputé définitivement émigré ») et avoir entendu les plaidoyers de l’accusé et de son défenseur, prononça la peine capitale. Masson mourut sur l’échafaud, comme 3 autres domestiques qui avaient reconnu les chefs d’inculpation qui pesaient sur eux27.
21Les parlementaires, pour leur part, étaient prêts à contester l’accusation d’avoir émigré. Contrairement aux domestiques, qui étaient peut-être intimidés et effarouchés par la solennité de la procédure, les ex-membres du parlement luttèrent avec l’énergie du désespoir – aidés en cela par leurs connaissances en droit et peut-être aussi des conseils judicieux. Se défendre contre l’accusation d’émigration sous la Terreur était une tâche peu enviable : les débats tournaient en général autour des certificats de résidence, les seuls documents susceptibles de disculper l’accusé. Les procès qui se jouaient sur de telles preuves étaient parfois fort embrouillés, comme en témoigne l’affaire Jean-Vivant Micault de Corbeton, un ancien président du parlement de Bourgogne.
22Le 12 novembre 1793, Micault fut arrêté à Luxeuil (Haute-Saône), où il résidait. L’une des premières initiatives de Bernard de Saintes, lors de sa seconde mission en Côte-d’Or, fut d’ordonner le transfert de Micault au Château de Dijon le 10 février 1794. Trois semaines plus tard, le tribunal criminel soumit l’affaire à l’administration de la Côte-d’Or. De la maison de justice où il était détenu, Micault rédigea une défense en cinq pages et l’envoya aux « Citoyens du directoire du département de la Côte-d’Or » – ses véritables juges. Ce texte offrait une justification de sa conduite et contestait l’accusation d’émigration28. Selon la loi du 28 mars, une telle objection devait être accompagnée de certificats de résidence délivrés par les conseils généraux des communes et vérifiés par les autorités du district et du département. Les émigrés présumés pouvaient obtenir de tels certificats en présentant huit témoignages d’habitants attestant qu’ils avaient résidé dans une ville ou un village pendant une période donnée29. C’est pourquoi Micault, dans sa déclaration de défense, indiquait les dates pour lesquelles il avait obtenu des certificats et expliquait pourquoi il ne pouvait en fournir pour les autres périodes.
23Micault affirmait pouvoir apporter la preuve qu’il avait résidé de façon continue en France. La seule période non couverte par un certificat était celle du 10 janvier au 25 février 1793 : pour cette lacune, il plaidait les circonstances atténuantes. Selon ses dires, il était arrivé à Dijon le 10 janvier 1793. Il figurait déjà sur la liste des émigrés du département depuis le 20 novembre 1792, et savait qu’il aurait besoin d’un certificat de résidence dans cette ville30. Avant de quitter Dijon, il aurait donc obtenu un certificat de résidence de la municipalité couvrant la période du 10 janvier au 20 février. Mais la loi du 28 mars annula les certificats délivrés en vertu de la législation antérieure31. C’est pourquoi, à partir du 28 mars 1793, la défense de Micaud présente des lacunes. À la mi-avril, alors qu’il est à Luxeuil, il est informé de la nouvelle loi et cherche alors à renouveler ses anciens certificats. Il se rend à Nancy où, après quelques retards, les autorités lui remettent un nouveau certificat pour cette ville, en remplacement de l’ancien. Le 8 juillet 1793, il écrit à l’administration de la Côte-d’Or, demandant le renouvellement de son certificat dijonnais par procuration. Cette lettre (ainsi que, selon lui, d’autres lettres) est restée sans réponse32. Des tentatives de mettre ses biens sous séquestre indiquent que les requêtes qu’il adressa aux autorités de Dijon ont été rejetées ou ignorées. Le 12 novembre 1793, il est arrêté à Luxeuil.
24Pour les émigrés présumés, les obstacles s’accumulaient en prison. Le 29 décembre, Micault sollicita un certificat par procuration attestant sa période de résidence à Luxeuil, approuvé par le comité de surveillance local le 11 janvier, vérifié par les autorités du district le même jour, et par le département de la Haute-Saône le 25 du mois. Mais une fois transféré à Dijon, il lui fut impossible de se procurer le dit certificat dans cette ville. Bien que Bernard de Saintes eût ordonné que les prisonniers qui avaient besoin de certificats puissent en faire personnellement la demande, le Conseil général à Dijon n’accorda pas ce droit à Micault, au motif que le prisonnier avait déjà été transféré à la maison de justice sur l’ordre de ce même Bernard.
25L’administration de la Côte-d’Or rendit son verdict final le 14 mars1794. Sa décision était fondée sur la loi du 28 mars, qui considérait comme émigrée toute personne ayant quitté sa résidence habituelle et ne pouvant prouver sa présence en France depuis le 9 mai 1792. Les autorités déclarèrent que le cas de Micault correspondait clairement à ces critères, puisqu’il ne pouvait prouver sa résidence pour deux périodes, du 31 janvier au 25 février 1793 et du 17 au 29 mai 1793. De plus, les administrateurs estimaient que le certificat de Nancy était probablement un faux, les signatures ne concordant pas avec ceux du maire et des officiers municipaux de cette ville. Le département de la Côte-d’Or refusa donc d’effacer le nom de Micault de la liste des émigrés33.
26Dès le lendemain, l’accusé rédigea une deuxième déclaration contestant l’arrêté du département. Selon lui, la décision des administrateurs était fondée sur le fait que, même s’il avait la possibilité de renouveler ses certificats, il resterait encore deux lacunes dans sa défense. Micault faisait valoir que son défenseur n’avait pas eu accès aux certificats et aux documents joints à ses demandes de renouvellement, et pouvait donc difficilement contester ces lacunes. En tout état de cause, l’accusé affirmait que la période manquante de douze jours entre le certificat délivré à Nancy (17 mai) et celui de Luxeuil (29 mai) ne justifiait pas les charges retenues contre lui. En effet, le certificat nancéen n’avait été signé par les administrateurs que le 25 mai. Ainsi la période non justifiée était seulement de quatre jours, passés à voyager – et « il n’est pas possible de prendre des certificats de résidence en route ». On ne pouvait évidemment l’accuser d’avoir émigré pendant ces quatre jours. Quant au « trou » constaté entre le 31 janvier et le 25 février, Micault répétait qu’il lui suffirait d’obtenir de la municipalité de Dijon qu’elle renouvelle le certificat qu’elle avait déjà accordé. Il estimait qu’il était injuste que d’autres prisonniers fussent autorisés à demander personnellement des renouvellements, alors que lui se voyait interdire la possibilité d’une telle démarche. Néanmoins, il s’autorisait à croire que les administrateurs ne pouvaient lui « refuser l’exercice du droit naturel à l’homme libre, de prouver qu’il n’est pas coupable d’un crime dont on l’accuse34 ».
27Le 17 mars 1794 (27 ventôse an II), les magistrats se réunirent au palais de justice. Ils donnèrent lecture de l’arrêté départemental du 14 mars, et entendirent les arguments fournis par l’accusateur public, par Micault et par son défenseur. Ils condamnèrent l’accusé à mort, au titre de la loi du 28 mars 1793. Les autorités ne perdirent pas de temps : Micault eut la tête tranchée l’après-midi même, à 15h3035.
28Le cas de Micault de Corbeton était typique de ces affaires d’émigration où le prévenu contestait le bien-fondé des accusations en se livrant à une chasse effrénée aux certificats de résidence. Mais la loi du 28 mars créait bien d’autres complications. Ainsi, les affaires impliquant des anciens parlementaires en Côte-d’Or ont provoqué des débats juridiques concernant d’autres dispositions de cette loi.
29Un premier point de litige apparaît clairement : celui de la compétence juridictionnelle. En dernière analyse, c’est l’administration départementale qui contrôlait les listes d’émigrés et jugeait de la validité des réclamations des accusés. Ainsi, les procédures engagées contre les émigrés, comme la plupart des campagnes de répression politique menées sous la Terreur, ont varié considérablement d’un département à un autre, selon le bon vouloir des autorités locales ou du représentant en mission. Dans ces conditions, l’une des stratégies offertes aux accusés était de soutenir que leur affaire ne devait pas être jugée en Côte-d’Or – où la machine judiciaire avait de toute évidence surmonté sa léthargie – mais dans un autre département.
30La loi du 28 mars prévoyait que les émigrés présumés devaient être jugés au « tribunal criminel du département de leur dernier domicile en France…36 ». Cette disposition risquant de susciter des contestations, la Convention la remplaça, le 13 septembre 1793, par un décret stipulant que tous les émigrés devaient passer en jugement au tribunal criminel du département où ils avaient été arrêtés. Mais ces directives pouvaient aisément être ignorées37. Ainsi, Jean-Baptiste Moreau, ex-avocat au parlement de Bourgogne, se vit refuser un transfert de juridiction. Dans sa plaidoirie, Moreau fit valoir qu’il avait vécu deux ans et demi dans l’Ain avant son arrestation, qu’il avait voté dans les assemblées primaires de ce département et qu’il avait été membre du jury d’accusation. Il avait même servi un temps comme substitut au tribunal. Il estimait donc que le représentant en mission Prost enfreignait la loi en le transférant du département de l’Ain, où il avait été arrêté, à celui de la Côte-d’Or. Mais les administrateurs de Dijon estimèrent que Moreau n’était plus « dans le délai de justifier de sa résidence en France ». L’accusé eut la tête tranchée sur la place Morimont le 1er germinal, quatre jours après Micault38.
31Un deuxième point de litige concernait les « réclamations » déposées par les émigrés présumés. Selon les législateurs, les personnes qui avaient déjà protesté contre leur présence sur les listes d’émigrés, mais dont les plaintes n’avaient pas encore été étudiées, devaient soumettre une nouvelle « objection » en bonne et due forme. Cette deuxième « réclamation » devait être présentée aux autorités départementales dans les quinze jours suivant la promulgation de la loi du 28 mars39. Mais qu’est-ce qui constituait une « réclamation » et selon quels critères devait-elle être appréciée ? La loi passait allégrement sur ces questions, ce qui permettait aux administrateurs, en l’absence de toute directive, de traiter les objections à leur guise. Quant à l’accusé, il n’avait aucun moyen légal de contester le sort réservé à sa requête. Les décisions de l’administration départementale étaient sans appel40.
32Dans la pratique, la « réclamation » était une déclaration présentée par la personne suspectée d’avoir émigré : celle-ci demandait aux autorités départementales de rayer son nom de la liste des émigrés. Le litige ne portait pas sur ce document lui-même mais sur le rôle des certificats de résidence par rapport à la « réclamation ». Un département pouvait rejeter la demande au motif que l’émigré présumé n’avait pas joint les certificats de résidence requis. Ainsi, aux yeux des autorités, toute réclamation devait inclure – outre le document lui-même – les fameux certificats. Et l’accusé devait se les procurer de nouveau dans les quinze jours suivant la promulgation de la nouvelle loi ! Comme on l’a vu dans l’affaire Micault, il fallait parfois plusieurs jours pour faire signer un seul document par les responsables du comité révolutionnaire, du district et du département. D’ailleurs Micault lui-même, interprétant la loi du 28 mars à la lettre, fit remarquer que la Convention ne pouvait certainement demander davantage aux suspects que de déposer leur réclamation dans les quinze jours, puisqu’un tel délai était à peine suffisant « pour demander, faire afficher, délivrer, enregistrer, viser au district et au département et déposer ces certificats41 ».
33Certains émigrés présumés de la Côte-d’Or se sont plaints d’avoir été dans l’incapacité physique d’obtenir les certificats en temps voulu. Dans l’affaire Jean-Baptiste Guyard, ex-procureur au parlement de Bourgogne, les administrateurs ont repoussé la réclamation de l’accusé au motif qu’il n’avait pas présenté ses certificats de résidence en temps voulu. Son défenseur officieux soutint, en vain, qu’une telle omission n’était pas surprenante, étant donné que Guyard était en prison à l’époque42. De même, Jean-Baptiste Moreau fonda sa défense non seulement sur la question de la juridiction choisie, mais sur l’impossibilité de renouveler ses certificats « dans la quinzaine ». Il fit valoir qu’il était alors emprisonné dans le département de l’Ain et qu’il était, de surcroît, gravement malade – comme l’avaient d’ailleurs reconnu les autorités de Bourg-en-Bresse en le laissant sortir de prison pour raisons de santé43.
34Si deux parlementaires furent guillotinés à Dijon parce qu’ils n’avaient pas fourni leurs certificats de résidence à temps, un autre fut exécuté parce qu’il déposa sa réclamation trop tôt. Le 6 ventôse l’an II, Bruno-Clément Colmont, ex-conseiller au Parlement, fut d’abord innocenté de l’accusation d’émigration par le tribunal criminel de la Saône-et-Loire44, au motif que l’arrêté du département contenait des « erreurs de fait » : en effet, Colmont avait obtenu des nouveaux certificats de résidence et avait déposé sa réclamation avant la promulgation de la loi. Mais Bernard de Saintes révoqua la décision des magistrats. Il proclama que l’arrêté des administrateurs départementaux de la Saône-et-Loire était « définitif », qu’il devait être exécuté « sans aucun recours » et que le tribunal criminel, en acceptant les certificats présentés par Colmont, avait outrepassé ses prérogatives. Bernard annula donc le jugement et renvoya l’affaire devant le tribunal criminel de la Côte-d’Or. À Dijon, les juges se contentèrent de lire à haute voix l’arrêté émis par le département de la Saône-et-Loire : le même jour, à 16h30, la tête de l’accusé roulait dans le panier. La disposition légale qui permit de le condamner fut la suivante : sa réclamation était nulle et non avenue puisqu’elle n’avait pas été jugée au moment où la loi du 28 mars fut publiée45 !
35Le tribunal criminel de Dijon ne condamna pas toujours les émigrés présumés et leurs agents. Avant l’arrivée de Bernard de Saintes, il prononça (puis suspendit) des jugements de déportation contre 2 domestiques ; 3 autres personnes jugées pour complicité d’émigration furent acquittées en pluviôse an II46. Et le 13 germinal, 2 accusés bénéficièrent d’une décision favorable des administrateurs, qui déclarèrent que l’un ne figurait pas sur la liste des émigrés et que l’autre avait encore le temps de fournir ses certificats de résidence47.
36Pour ce qui est des autres tribunaux étudiés, les affaires d’émigration étaient rarement soumises aux juges. Le Cher, le Finistère, la Gironde, les Landes, la Mayenne, le Rhône, la Haute-Saône, la Somme et la Vendée ne connurent aucune exécution capitale au titre des dispositions de la loi du 28 mars, peut-être dans certains cas parce que les émigrés y étaient moins nombreux, mais aussi parce que les autorités locales et les représentants en mission ne partageaient pas l’acharnement de Bernard de Saintes en Côte-d’Or. Tant à Versailles qu’à Bourg-en-Bresse, on note 2 exécutions pour émigration – et une seule pour chacun des départements suivants : la Creuse, le Gard, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées48.
37Relativement peu d’émigrés ont donc été poursuivis devant les tribunaux criminels. Mais il est clair que la procédure expéditive mise en œuvre pour les juger répondait plus à des impératifs politiques qu’à des considérations d’équité. Comme l’a fait observer A. Combier dans son étude sur l’Aisne, les affaires d’émigration provoquèrent des « drames trop authentiques et trop lamentables49 ». La loi du 28 mars 1793 était une mesure exceptionnelle. Elle constituait une arme de guerre judiciaire contre les ennemis intérieurs de la Révolution et un moyen de dissuader les émigrés de revenir en France pour combattre la République. Pour les Conventionnels, ce qui comptait c’était de mener une répression rapide et exemplaire. Certes, la question de savoir si l’accusé était coupable ou innocent était prise en compte mais elle était posée d’une façon qui lui était très défavorable. En vertu de la loi du 28 mars, les prévenus étaient coupables tant qu’ils n’avaient pas démontré leur innocence. Toute personne accusée d’émigration devait réfuter, preuves à l’appui, l’accusation. De plus, les citoyens pouvaient être inclus dans la liste des émigrés à partir d’un simple soupçon : la loi obligeait chaque municipalité à dresser une liste comprenant toutes les personnes qui ne vivaient plus dans la commune50 ! Ainsi, il suffisait de s’absenter de son lieu habituel de résidence en 1792 ou 1793 pour risquer de figurer sur la liste des émigrés. Et puisque les listes départementales et nationales étaient de simples amalgames des listes des communes et des districts, les fonctionnaires locaux avaient le pouvoir de fait de désigner une personne comme « émigrée ». Certains étaient certainement plus enclins que d’autres à abuser de ce pouvoir et à dénoncer des gens qui s’étaient simplement absentés. Il faut évidemment faire la part des choses : d’innombrables jalousies et rivalités pouvaient inciter un maire à nuire à un habitant de sa commune. Il n’en reste pas moins que la loi encourageait explicitement les autorités locales à dénoncer toute personne qui s’était « absentée du lieu de son domicile51 ».
38Une fois inscrites sur la liste maudite, les personnes qui souhaitaient rester en France étaient confrontées à une tâche ardue si elles étaient poursuivies par l’administration. Se procurer les certificats de résidence était un véritable parcours du combattant. Certains fonctionnaires traitaient sans doute avec diligence – voire avec humanité – les demandeurs (allant jusqu’à allonger les dates en leur faveur par exemple), mais d’autres ont dû leur mettre des bâtons dans les roues. De toute façon, l’émigré présumé qui tentait frénétiquement d’obtenir ses certificats avant la date limite se heurtait à l’inertie et aux obstacles bureaucratiques habituels. La position des réclamants était d’autant plus funeste que les autorités révolutionnaires dont la signature était indispensable n’étaient guère favorables aux gens soupçonnés d’avoir fui le pays.
39La loi sur les émigrés permettait aisément d’éliminer des ennemis politiques. En Côte-d’Or, le fait qu’elle ait été surtout appliquée à des domestiques (et, à travers eux, c’étaient leurs maîtres qui étaient visés) ainsi qu’à des parlementaires est significatif. Et à la lecture des dossiers, on a parfois la nette impression qu’elle sert à régler des comptes. Frédéric-Henry Richard de Ruffey, un ex-président du parlement de Bourgogne fut guillotiné le 21 germinal, essentiellement parce qu’il ne put obtenir un certificat de résidence des autorités de Beaune. Celles-ci, en rejetant sa demande, déclarèrent que Richard était « l’aristocrate le plus dangereux du département », un homme qui manifestait ouvertement son « incivisme52 ». Dans certaines communes, il est fort probable que les demandes de certificats de résidence furent traitées comme des demandes de certificats de civisme. La loi du 28 mars autorisait une telle dérive puisqu’elle permettait aux conseils généraux et aux assemblées de section (ces dernières dans les villes plus grandes) de refuser le témoignage de déposants estimés « suspects53 ».
40En bref, la loi du 28 mars a peut-être réalisé ses objectifs politiques, mais elle a également porté atteinte à l’intégrité éthique du système judiciaire. Elle a suscité des pratiques administratives et procédurières soumises au bon vouloir des autorités locales, qui paraissent parfois avoir décidé arbitrairement de la composition des fameuses « listes » et de la teneur des poursuites contre les émigrés présumés. Dans les affaires d’émigration, l’appareil judiciaire était clairement subordonné à l’administration : le véritable procès n’avait pas lieu au palais de justice mais devant les administrateurs du département, qui rendaient leurs verdicts sans faire face à l’accusé, sur la base exclusive de documents écrits. Leurs décisions étaient sans appel. Et surtout, la loi du 28 mars constituait une violation flagrante de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : en effet, elle considérait l’accusé comme coupable s’il ne pouvait prouver son innocence.
41Après avoir sévi contre les rebelles et les émigrés, la Convention étoffa son arsenal répressif de lois visant les prêtres réfractaires. Le 29 vendémiaire an II (20 octobre 1793), la Convention prescrivit la peine de mort pour les prêtres « sujets à la déportation », c’est-à-dire qui refusaient de prononcer le serment ecclésiastique du 27 novembre 1790 et le serment à la liberté et à l’égalité du 14 août 1792, ainsi que pour ceux qui avaient prêté serment mais s’étaient rétractés54. Cette loi marquait une intensification du conflit entre la République et les « insermentés ». Ces derniers avaient été soumis à un ordre de déportation le 23 avril 1793 mais la nouvelle loi de vendémiaire montrait clairement que cette peine ne suffisait plus aux Conventionnels55. Les prêtres réfractaires qui étaient restés clandestinement sur le territoire français après le 23 avril, et qui ne se présentaient pas aux autorités pour obtenir un passeport et quitter le pays, encouraient la peine capitale. La procédure judiciaire du 29 vendémiaire ressemblait à celle qui était prévue par les lois du 19 et du 28 mars 1793. Les membres du clergé arrêtés en armes ou portant des emblèmes contre-révolutionnaires comparaîtraient désormais devant une commission militaire et seraient exécutés dans les 24 heures. Quant à ceux qui se contentaient d’enfreindre l’ordre de quitter la France, ils devaient être conduits à la maison de justice du tribunal criminel, interrogés et exécutés « après que les juges du tribunal auront déclaré que les détenus sont convaincus d’avoir été sujets à la déportation56 ».
42Le véritable délit imputé par la Convention aux prêtres réfractaires était double : d’une part, leur refus de prêter serment signifiait qu’ils étaient des ennemis de la Révolution ; d’autre part, ils étaient a priori soupçonnés de profiter de leur présence sur le sol français pour saper les fondements de la République et préparer le retour des Bourbons. Tout comme les émigrés, on présumait qu’ils avaient l’intention de subvertir l’ordre révolutionnaire. La plupart des prêtres insoumis restés en France en l’an II ne menaient plus le type de campagnes publiques qui les avaient opposées à leurs collègues assermentés en 1792. Ceux qui continuaient le combat œuvraient de façon plus souterraine. Ils se terraient dans la clandestinité et célébraient à l’occasion des messes chez des particuliers ou « dans la forêt ». Mais dans le contexte politique créé par la guerre, tout défi à la loi était considéré comme subversif. Les prêtres réfractaires débusqués de leurs cachettes risquaient de passer rapidement en jugement. Le 26 nivôse an II, Arnaut Labée, un ex-moine passé dans la clandestinité, fut arrêté à Saint-Criq (Landes). Il reconnut avoir refusé de prononcer les serments requis en 1790 et 1792, être arrivé à Saint-Criq en mai 1792 et s’être déplacé de maison en maison « sans avoir une demeure fixe ». Il avoua également avoir célébré la messe de temps en temps chez des particuliers. Labée fut transféré au tribunal criminel des Landes et jugé le 3 pluviôse, sept jours après son arrestation. Les juges décrétèrent que Labée avait omis de prononcer les serments requis par la loi, qu’il était donc sujet à la déportation et passible de la peine prévue par la loi du 29 vendémiaire. Il fut condamné à mort57.
43Les prêtres comparaissaient parfois avec les gens qui les avaient hébergés. En fructidor an II, le tribunal de Quimper ordonna l’exécution de 3 accusés au titre de la loi du 29 vendémiaire : 2 prêtres réfractaires ainsi qu’une femme du village de Pennanéach répondant au nom prédestiné d’Anne Le Saint et qui les avait reçus dans sa maison le soir du 22 fructidor. Quelques heures à peine après l’arrivée des prêtres, la force armée arrêta tous les citoyens présents au domicile de Le Saint, y compris 3 personnes qui dormaient à l’étage. Le tribunal criminel du Finistère déclara Anne Le Saint coupable d’avoir hébergé les 2 prêtres insermentés chez elle, mais relaxa les 3 autres personnes au motif qu’elles ignoraient les intentions et l’action de leur employeur – ce qui leur évita de partager son sort tragique58.
44Les prêtres qui reconnaissaient avoir refusé de prêter serment ou s’être rétracté ne bénéficiaient d’aucune clémence, tout comme les domestiques jugés à Dijon qui avaient volontiers avoué avoir émigré avec leurs maîtres. Quant aux réfractaires présumés qui niaient les charges, il leur était encore plus difficile de se défendre que les personnes suspectées d’émigration. La situation était simple : soit ils pouvaient présenter une copie du rapport officiel attestant qu’ils avaient prêté serment devant les officiers municipaux, soit ils en étaient incapables59. Un prêtre fit valoir qu’il avait accepté les serments de 1790 et 1792 devant une assemblée de section à Toulouse en juin 1793. Mais le tribunal criminel de la Haute-Garonne rejeta cet argument, au motif que les serments ecclésiastiques devaient être prononcés en présence des autorités municipales. Toujours à Toulouse, un autre accusé fournit la preuve qu’il avait prononcé les serments requis le 4 ventôse de l’an II. Mais les juges firent observer qu’en vertu de la loi du 21 avril 1793, seuls les serments antérieurs au 23 mars 1793 étaient légalement valides. Ces 2 hommes furent guillotinés, ainsi que 3 autres prêtres jugés à Toulouse en l’an II60. De fait, dans les seize tribunaux étudiés, davantage d’accusés ont été guillotinés au titre de la loi du 29 vendémiaire que pour avoir émigré. Outre les 5 peines capitales prononcées à Toulouse, 8 personnes furent condamnées à mort à Quimper et 4 à Dax en vertu de cette loi ; 3 prêtres jugés à Nîmes, 2 à Amiens et 1 à Tarbes, Fontenay et Dijon connurent le même sort. Ainsi, sur les seize tribunaux concernés, 25 prêtres réfractaires ou leurs protecteurs ont péri sur l’échafaud (contre 17 émigrés61).
45Enfin, à la liste des gens jugés « révolutionnairement » par ces tribunaux, il faut ajouter 5 hommes qui se sont vus refuser un procès par jurés – au mépris de la loi. Ces hommes ont été jugés par des magistrats seuls pour des crimes qui auraient dû normalement être entendus par un jury. Antoine Denis, boulanger à Toulouse, a comparu devant les juges le 11 octobre 1793 : il était accusé d’avoir adultéré son pain avec du son et de la farine gâtée. Le tribunal estima que Denis devait être considéré comme un « empoisonneur public », le déclara coupable de tentative d’homicide par empoisonnement et le fit exécuter conformément aux dispositions du Code pénal en matière d’homicide. Ce jugement paraît aussi surprenant que l’argumentation avancée par le tribunal pour justifier l’absence du jury :
46Un mois plus tard, un boucher comparut devant le tribunal toulousain sans jury. Il était accusé d’avoir vendu de la viande avariée et reçut également la peine capitale pour tentative d’homicide. Toujours à Toulouse, 3 hommes accusés d’accaparement se virent refuser un procès par jurés. Dans le contexte politique et social de la Terreur, les négociants étaient souvent considérés comme des « ennemis de la Révolution » et l’accusation de spéculer sur les biens de première nécessité prenait le relais de la frustration et de la colère du peuple contre les accapareurs. Certes, la loi des 26 et 27 juillet 1793 prévoyait bien la mort pour ceux qui étaient convaincus de tels crimes63. Néanmoins les 3 négociants poursuivis à Toulouse auraient dû comparaître devant des jurés. Au lieu de quoi, les juges siégèrent seuls. L’un des accusés fut guillotiné pour avoir entreposé de la laine chez lui sans le déclarer formellement aux autorités municipales ; un autre pour avoir stocké du vin ; le troisième larron pour avoir omis de déclarer certaines marchandises et avoir sous-estimé le poids de certaines denrées64.
47Sur le fond, le recours à la justice d’exception aux tribunaux criminels résulte d’une convergence de tendances politiques nationales et locales. D’une part, les procédures et les peines appliquées par ces tribunaux sous la Terreur doivent beaucoup aux lois votées par les Conventionnels. Mais, d’autre part, le principal facteur d’exacerbation de la Terreur dans les tribunaux de province est la proximité géographique d’un conflit politique intense et violent. De fait, si l’on se réfère aux estimations de Donald Greer, près de la moitié des exécutions prononcées par des tribunaux criminels en France pendant la Terreur l’ont été par seulement sept tribunaux : six étaient situés dans des régions confrontées à une révolte armée (Ouest et Sud-Est) et le septième (Lozère) dans une zone connue pour son royalisme populaire65.
48Dans des départements relativement paisibles, comme la Haute-Saône, le Cher, la Somme, la Seine-et-Oise, la Creuse et les Hautes-Pyrénées, les tribunaux criminels ont rarement appliqué les lois contre les émigrés et les prêtres réfractaires, essentiellement parce que la volonté politique faisait défaut. Il n’y avait pas de front politique hautement « sensible » dans les environs, susceptible d’éveiller l’inquiétude des magistrats et des administrateurs. Les ennemis de la République n’apparaissaient pas comme une menace tangible et il était difficile d’imaginer que la « sûreté publique » pût être menacée par un émigré ou un prêtre du cru. Les quelques exécutions ordonnées dans ces départements apparaissent presque comme des châtiments symboliques visant à édifier le public et les élites politiques. Toujours est-il que les lois du 28 mars et du 29 vendémiaire n’y ont pas entraîné une campagne systématique contre les émigrés et le clergé réfractaire.
49C’est souvent l’arrivée du représentant en mission qui déclenchait les mesures d’exception prises dans ces départements « calmes ». Celui-ci pouvait non seulement remplacer les membres du tribunal criminel par ses propres hommes, évidemment plus enclins à recourir à de telles mesures, mais de plus il pouvait faire transférer les prisonniers directement devant le tribunal. Ainsi, à Dijon, une ville pourtant relativement à l’abri des révoltes armées, un député énergique réussit à pousser les autorités départementales à juger et à faire guillotiner 9 émigrés présumés. Dans le Cher, l’intervention de Laplanche entraîna moins d’exécutions. Sa venue à Bourges marque toutefois le début d’une politique plus répressive dans cette ville, où le tribunal criminel avait auparavant refusé d’appliquer la peine de mort pour des propos inciviques66. André Dumont dans la Somme et Jean-Baptiste-Benoît Monestier dans les Hautes-Pyrénées ont également épuré et galvanisé les autorités judiciaires de ces départements. On le voit, les impératifs politiques nationaux, incarnés par le « représentant du peuple », l’emportaient souvent sur l’inertie locale67.
50Toutefois, les émissaires chargés d’appliquer la politique « révolutionnaire » du gouvernement devaient clairement s’adapter aux conditions locales et aux groupes de pression. Même Bernard de Saintes, agissant de concert avec Bassal en Haute-Saône, dut se contenter de purger le tribunal criminel de certains magistrats impliqués dans une éphémère assemblée fédéraliste. Il n’alla pas jusqu’à inciter les hommes qu’il nomma pour les remplacer à appliquer des mesures d’exception. Dans les Hautes-Pyrénées, la marge de manœuvre de Monestier était réduite du fait de la puissance de la faction Barère à Tarbes. Bertrand Barère est intervenu en personne pour faire libérer deux anciens avocats emprisonnés par Monestier. À Amiens, les juges du tribunal criminel ont opposé une certaine résistance aux pressions de Dumont. Celui-ci avait pourtant désigné son président, mais le tribunal refusa à deux occasions de juger « révolutionnairement » malgré des arrêtés émanant du représentant68.
51Là où la guerre civile faisait rage, la fréquence du recours à la terreur par les tribunaux criminels reflétait davantage des impératifs politiques locaux. Dans des départements comme la Vendée et le Gard, les représentants en mission n’avaient pas besoin de pousser les autorités révolutionnaires à guillotiner les ennemis de la République. Les structures légales répressives qu’ils mettaient en place suffisaient. Dans ces deux départements, les conflits du début des années 1790 sont enracinés dans le terreau social : en Vendée, il y a le fossé entre les élites urbaines et le bocage traditionaliste ; et dans le Gard, l’opposition ancestrale entre la bourgeoisie protestante, qui vit du commerce de la soie, et les artisans en majorité catholiques. Les antagonismes étaient déjà vifs dans ces régions. Il ne restait donc plus aux députés comme Lequinio et Borie qu’à mettre en place les structures de la justice révolutionnaire et à laisser mijoter les tensions politiques du cru. D’ailleurs, quand la Convention abolira tous les tribunaux révolutionnaires provinciaux en germinal an II, la société populaire de Nîmes persuadera les politiques parisiens de faire une exception pour le Gard et de permettre au tribunal criminel de continuer à exercer la justice « révolutionnairement69 ».
52L’activité du tribunal nîmois mérite bien l’attention particulière que lui a accordée l’historienne Anne-Marie Duport. L’ardeur répressive de ce tribunal s’explique à la fois par l’intensité des conflits locaux et par la réaction des Conventionnels aux révoltes qui éclatent dans les provinces françaises en 1793. À l’été, le Gard est secoué par un soulèvement fédéraliste, dont les chefs contrôlent Nîmes pendant cinq semaines et envoient une force armée contre les troupes de la Convention. Mais la rébellion nîmoise, si elle est la plus conséquente en Languedoc, ne peut se comparer avec celles qui se produisent à Lyon, Bordeaux et Marseille, où la Convention instaure des commissions militaires ou des institutions révolutionnaires spéciales pour juger les rebelles présumés. Les tribunaux criminels de ces trois villes n’ont pas exécuté un seul accusé politique pendant toute la période de la Terreur. Par contraste, le fédéralisme gardois, s’il ne suscite pas la mise en place d’une commission militaire, était assez puissant pour provoquer une sévère répression lors de son échec. Celle-ci fut menée par les jacobins nîmois et s’appuya sur le tribunal criminel du Gard, affublé de l’épithète « révolutionnaire ».
53Sous la Terreur, le tribunal de Nîmes a envoyé 135 personnes à l’échafaud. Comme l’a noté Duport, l’écrasante majorité des prévenus étaient soupçonnés d’avoir participé au mouvement fédéraliste70. Parmi les condamnés à mort, on dénombre 19 notables ou officiers municipaux, 2 administrateurs du district et 9 du département, ainsi que d’autres personnes qui avaient accepté des responsabilités durant la révolte. Selon Duport, « le bilan social de la Terreur fut comparable à celui des autres départements fédéralistes, la bourgeoisie étant la plus touchée71 ». De même qu’en Vendée, les juges s’efforçaient de distinguer les meneurs des simples participants : dans les deux départements, le simple fait de d’exercer une fonction administrative en territoire rebelle entraînait automatiquement la peine de mort. Néanmoins, le tribut moral payé à la justice révolutionnaire semble – pour autant qu’on puisse l’évaluer – avoir été plus lourd dans le Gard qu’en Vendée. Le tribunal criminel de Fontenay travaillait sans précipitation, posément. Bien que les prisons fussent surpeuplées, il jugea en moyenne moins de 2 prisonniers par jour et prononça 32 exécutions du 5 octobre au 11 décembre 1793. En revanche, le tribunal criminel de Nîmes siégea deux fois plus souvent du 5 prairial au 14 thermidor an II (une période presque équivalente), et alla jusqu’à ordonner 31 exécutions en une seule journée72. Un tel empressement à trancher les têtes ne signifie pas forcément que les magistrats nîmois jugeaient à tort et à travers : il leur arrivait – comme à ceux de Fontenay – de suspendre leur jugement en attendant d’avoir de plus amples informations. Mais, à la lecture des documents, on a l’impression qu’à Nîmes les jugements n’étaient pas toujours rendus dans la sérénité. Un acte d’accusation dressé en 1794 contre 12 fédéralistes présumés contient la description suivante :
54Cette verve est certes celle de l’accusateur public et non celle des juges, mais elle reflète le ton général des débats à Nîmes. Le tribunal était, pour le moins, sensible à la pression exercée par la société populaire et par le maire Courbis, dont le beau-frère était le président du tribunal74.
55Toutefois le Gard reste une exception, et la Terreur en province courtcircuita plus souvent les tribunaux criminels qu’elle ne les convoqua. Les recherches de Greer ont montré que 1922 (11,6 %) des 16 594 personnes condamnées à mort par les juridictions révolutionnaires furent jugées par des tribunaux criminels. Dans les régions en proie à la guerre civile, ceux-ci étaient rarement chargés à eux seuls de juger les rebelles présumés. Plus souvent, ils suppléaient provisoirement les commissions militaires : ce fut notamment le cas dans de nombreux départements affectés par les guerres vendéennes75. Dans les zones plus éloignées de la guerre civile, les tribunaux ont souvent exercé une forme de terreur relativement « modérée » visant principalement des prêtres réfractaires et des émigrés. Cependant, s’ils n’ont pas constitué l’arme la plus importante – ni la plus spectaculaire – de la Terreur, les tribunaux criminels ont joué un rôle important dans sa réalisation. D’ailleurs, après Thermidor, leurs membres furent parmi les premiers à être purgés par les nouveaux représentants en mission, impatients de restaurer le personnel judiciaire et les pratiques en cours avant la Terreur.
56Sous la Réaction et le Directoire, la législation contre les émigrés et les prêtres réfractaires demeura en vigueur, légèrement modifiée par les lois votées après la chute de Robespierre. Mais la volonté politique de les appliquer avait disparu. Les représentants en mission ne stimulaient plus l’ardeur révolutionnaire des juges et des administrateurs, et ceux-ci ne pratiquaient plus la justice d’exception avec la même sévérité. La plupart des émigrés présumés ou des prêtres insermentés jugés après l’an II ont obtenu un acquittement ou un transfert de juridiction. Après Thermidor, seuls deux des seize tribunaux criminels examinés dans notre étude ont ordonné une ou plusieurs exécutions au titre des lois d’exception : 4 prêtres et 2 de leurs protecteurs furent décapités pendant la Réaction dans le Finistère, tandis qu’en Haute-Saône un prêtre ne put prouver qu’il avait prononcé le serment à la liberté et à l’égalité et périt sur l’échafaud en nivôse de l’an IV (janvier 179676).
57Cette réticence généralisée à condamner les accusés à mort apparaît clairement en Côte-d’Or : malgré le caractère automatique de la peine capitale prévue par les lois du 29 vendémiaire an II et la nouvelle loi sur les émigrés du 25 brumaire an III, le tribunal criminel s’abstint d’exécuter les émigrés présumés et les prêtres réfractaires. De germinal an III à fructidor an V, les magistrats jugèrent 15 personnes soupçonnées d’émigration. Huit d’entre elles furent acquittées, les administrateurs départementaux ayant tout simplement déclaré que les noms des prévenus ne figuraient pas sur la liste des émigrés du département77. Six autres accusés furent transférés vers d’autres départements, au motif qu’ils ne résidaient pas en Côte-d’Or78. Dans une affaire, l’administration constata que le nom de l’inculpé apparaissait bien sur la fameuse liste. Mais dans la mesure où la Convention avait récemment promulgué la loi du 12 floréal an III, qui accordait aux émigrés un délai d’un mois pour quitter le pays, les juges relâchèrent l’accusé et lui ordonnèrent de sortir du territoire national79. Les prêtres réfractaires furent traités à la même enseigne : les membres insermentés du clergé arrêtés sous la Réaction et le Premier Directoire bénéficiaient systématiquement de transferts juridictionnels, d’ordonnances de non-lieu et d’ordres de quitter le territoire français80. Enfin, avec la loi du 19 fructidor an V, le Directoire ôta toute compétence aux tribunaux criminels pour juger les émigrés et les prêtres rebelles et transféra ce pouvoir aux administrations départementales81.
58La justice d’exception reçut une nouvelle impulsion sous Napoléon. Certes, celui-ci, résolu à apaiser les antagonismes hérités des années 1790, mit fin aux mesures répressives contre les émigrés et les prêtres réfractaires. Mais l’État napoléonien réduisit encore plus le domaine de compétence des procès par jurés. En pluviôse an IX (1801), le Consulat créa dans certains départements de nouveaux « tribunaux spéciaux », appelés à juger les infractions considérées comme des atteintes à l’ordre public : vols commis sur les grandes routes, assassinats prémédités, vagabondage, vols dans les campagnes avec effraction, rassemblements séditieux, incendie, fausse monnaie. Ces nouveaux tribunaux furent institués dans 43 départements, dont 15 « étrangers » (situés au-delà des frontières de 1791). Le gouvernement s’efforçait ainsi d’endiguer la vague de désordres qui déferlait sur le pays depuis le Directoire, notamment dans les régions du Sud et de l’Ouest82.
59Mû par le désir de forger des instruments de répression plus efficaces, le gouvernement évinça le jury des tribunaux spéciaux, dont les juges prononçaient à la fois le verdict et la peine. Ainsi, cette réforme ne frappait pas seulement l’institution du jury populaire. Elle mettait en cause un principe cher aux Constituants : la séparation, en matière de justice criminelle, du pouvoir de juger les faits de celui d’appliquer les lois. Pour des tribuns tels que Chazal et Constant, une telle confusion rappelait l’Ancien Régime. Lors des débats législatifs, Chazal compara les tribunaux spéciaux aux cours prévôtales du xviiie siècle, tandis que Constant soutenait avec passion qu’ils risquaient de réveiller le spectre de la justice arbitraire, en accordant aux magistrats des pouvoirs exorbitants83. Mais leurs arguments ne prévalurent pas dans les assemblées napoléoniennes. Les législateurs se rangèrent derrière l’avis du rapporteur du projet de loi, Duveyrier, qui préconisait des mesures fermes pour éradiquer « un poison domestique, une cause intérieure de destruction, une vaste conspiration de brigandage et de crimes […]84 ».
60Outre la suppression du jury, d’autres mesures furent prises afin de rassurer les partisans d’une répression plus vigoureuse. La loi du 18 pluviôse an IX stipulait que trois des huit juges rattachés à chaque tribunal spécial proviendraient des rangs de l’armée et seraient nommés par le Premier Consul. Aux côtés de ces militaires de carrière, siégeaient les trois magistrats titulaires du tribunal criminel ordinaire ainsi que deux autres citoyens également désignés par le Premier Consul. La présence de gradés sur le banc des magistrats, même s’ils étaient en minorité, renforçait le caractère « exceptionnel » du tribunal spécial, et soulignait l’idée que les institutions de droit commun étaient incapables par elles-mêmes de mettre fin aux désordres dans le Midi et l’Ouest.
61La défense n’était pas seulement désavantagée par l’absence du jury et la présence des militaires. La mise en accusation, par exemple, n’était plus décidée par le jury d’accusation mais par les juges du tribunal spécial. Dès lors que ceux-ci avaient décidé qu’une affaire justifiait un procès, leur décision était transmise au tribunal de cassation, qui statuait en la matière85. Mais cette disposition ne changeait rien au fait que les mêmes magistrats qui dressaient l’acte d’accusation étaient chargés de prononcer le jugement final. De surcroît, les prévenus ne prenaient connaissance de la nature des accusations et des dépositions que lors du procès lui-même. L’accusé pouvait, il est vrai, contester ouvertement les déclarations des témoins lors des débats (avec l’aide de son défenseur), mais il ne pouvait se préparer correctement à une telle confrontation, puisqu’il n’avait pas accès aux documents de l’instruction préparatoire – alors que l’accusateur public avait tout loisir de les étudier à l’avance. S’il était reconnu coupable, l’accusé ne pouvait pas faire appel. Et les conséquences pénales d’une condamnation pouvaient être fatales : les tribunaux spéciaux étaient tenus de prononcer la peine capitale non seulement pour l’homicide prémédité et pour l’incendie volontaire, mais aussi pour certaines formes de vol aggravé86. Les accusateurs publics des tribunaux spéciaux disposaient d’un arsenal fourni de sanctions pénales rigoureuses et de prérogatives procédurales : on comptait donc sur eux pour condamner plus facilement qu’ils ne le faisaient aux tribunaux criminels ordinaires.
Tableau I : Tribunaux spéciaux de l’an IX Nombre d’accusés ayant reçu des peines criminelles, des peines correctionnelles et des acquittements, an IX-1811
Par département Tableau II : Tribunaux spéciaux de l’an IX Nombre d’accusés ayant reçu des peines criminelles, des peines correctionnelles et des acquittements, an IX-1811
Par année
62Bien entendu, la justice d’exception sous Napoléon offre un bilan qui varie selon les départements, et nous savons déjà, grâce aux recherches des historiens Dominique Bouguet et Gilles Landron, que les tribunaux spéciaux dans l’Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire n’étaient pas excessivement enclins à la répression87. Parmi les trois tribunaux spéciaux examinés ici, celui de la Seine-Inférieure fut de loin le plus sévère, à la mesure que cela puisse être mesuré par les taux d’acquittement : près de deux tiers des personnes accusées de crimes furent déclarées coupables, alors que le taux de condamnations est d’environ un tiers dans le Gard et le Vaucluse (voir tableau I). Ces trois tribunaux se montrèrent plus fermes vers la fin de l’Empire que sous le Consulat, acquittant 49 % des accusés entre 1801 et 1806, et 38 % ultérieurement88. La plupart des affaires jugées concernaient des vols présumés et provoquèrent des décisions très sévères de la part des juges (voir tableau III). Toutefois, les cas d’incendies, d’homicides et de fausse monnaie donnèrent lieu à moins de condamnations.
Tableau III : Tribunaux spéciaux de l’an IX Nombre d’accusés ayant reçu des peines criminelles, des peines correctionnelles et des acquittements, an IX-1811
Par crime 63Si les tribunaux spéciaux ont prononcé des peines criminelles plus volontiers que les tribunaux ordinaires, au moins dans ces trois départements, le contraste entre les deux juridictions est encore plus saisissant en ce qui concerne la sentence capitale. Les trois tribunaux spéciaux étudiés ici ont souvent envoyé les inculpés à l’échafaud. Celui de Rouen peut même être qualifié de « draconien » : de 1801 à 1811, il a condamné 150 personnes à mort, dont les deux tiers pour vol. Trente-sept pour cent de tous les prévenus jugés pour des crimes par le tribunal spécial de Rouen ont été guillotinés. Dans le Gard et le Vaucluse, les magistrats étaient bien moins sévères ; toutefois, sur 32 peines capitales prononcées à Nîmes, 17 l’ont été pour vol (11 sur 33 à Carpentras). Si ces personnes avaient été jugées pour les mêmes faits dans les années 1790, ils auraient eu droit (à quelques exceptions près) à un procès par jurés, et s’ils avaient été déclarés coupables, ils auraient reçu de longues peines de travaux forcés (« fers ») avec la possibilité de se pourvoir en cassation.
64De nombreuses personnes ont ainsi payé de leur vie la volonté de Napoléon de rétablir l’autorité répressive de l’État dans le Midi et l’Ouest du pays. Il suffit de jeter un coup d’œil sur les registres de Rouen pour se rendre compte de certaines conséquences de sa justice d’exception. En thermidor an X (1802), un homme comparut pour avoir cambriolé une maison en Seine-Inférieure et emporté un gilet, une paire de bas, un mouchoir, une paire de souliers, et six livres de pain. Le tribunal spécial le fit exécuter. Il n’eut pas davantage de pitié pour un autre homme jugé la même année, et qui avait dérobé des vêtements, des draps, des mouchoirs, des boutons d’argent, une croix en or, et une douzaine de pièces d’or89. Ces deux malheureux ne furent pas les seuls à subir un châtiment disproportionné par rapport à leur forfait : toujours à Rouen, 10 accusés furent condamnés à mort pour incendie volontaire et 98 pour diverses formes de vol90. Il arrivait, certes, que les juges omettent de retenir des circonstances qui auraient entraîné la mort91. Et, de fait, les inculpés envoyés à l’échafaud étaient le plus souvent condamnés pour des atteintes graves à la propriété (vol à main armée et cambriolage, impliquant en général des sommes d’argent ou des valeurs considérables). Mais ces considérations n’atténuent pas la disparité exorbitante entre la nature des crimes et la gravité des peines prononcées dans la Seine-Inférieure.
65Un autre type d’infraction bien moins grave relevait de la compétence des tribunaux spéciaux créés en l’an IX. Le vagabondage n’était pas un crime, mais il inquiétait les autorités, qui décidèrent de l’inclure dans la juridiction des tribunaux spéciaux (ce qui rappelle les attributions des cours prévôtales de l’Ancien Régime92). Mais comment punir les vagabonds ? À Carpentras, les juges estimèrent qu’aucune loi ne définissait le vagabondage comme un crime en soi : après avoir libéré 9 vagabonds présumés en l’an X, le tribunal n’entendit plus une seule affaire de cette nature93. Les juges de Nîmes décrétèrent également que le vagabondage ne constituait pas un délit. Mais plutôt que de libérer les accusés, ils les ont quand même jugés et ont ordonné que les « coupables » soient reconduits sous bonne garde à la commune où ils déclaraient résider « pour être mis à la disposition du maire94 ». Quant au tribunal spécial de Rouen, il condamnait les vagabonds à un an de prison, en se fondant d’une façon tout à fait spécieuse sur la loi du 24 vendémiaire an II, qui pénalisait certaines formes de mendicité – mais nullement le vagabondage en tant que tel95. Ainsi, les trois tribunaux spéciaux ont improvisé, chacun à sa façon, une réponse au vagabondage : l’un en refusant de statuer, l’autre en se déchargeant du problème sur l’administration locale, et l’autre enfin en appliquant une loi pénale prévue pour un autre type d’infraction.
66Aux tribunaux d’exception institués en l’an IX, on en ajouta bientôt de nouveaux. Le 23 floréal an X (1802), le Consulat créa des « tribunaux spéciaux » dans tous les départements de la République. Ces cours étaient principalement chargées d’entendre les affaires de « faux en écritures publiques ou privées », mais pouvaient aussi juger les personnes accusées de fausse monnaie ou d’incendie volontaire. Le gouvernement justifia ces nouvelles juridictions extraordinaires par la nécessité de « mettre un frein à cette multitude de faussaires qui inondent et menacent la société […]96 ». Délestés des juges militaires, les tribunaux spéciaux de l’an X comprenaient six magistrats : trois provenaient du tribunal criminel ordinaire et trois du tribunal de première instance. La procédure en vigueur y était identique à celle des tribunaux spéciaux de l’an IX : les accusés ne pouvaient pas lire les dépositions recueillies avant le procès ; les juges – et non pas les jurés – prononçaient à la fois la mise en accusation et le jugement, qui était sans appel97.
Tableau V : Tribunaux spéciaux de l’an X Nombre d’accusés ayant reçu des peines criminelles, des peines correctionnelles et des acquittements, an X-1811
Par département Tableau VI : Tribunaux spéciaux Nombre d’accusés ayant reçu des peines criminelles, des peines correctionnelles et des acquittements, an X-1811
Par année
67Les taux de condamnations et d’acquittements évalués pour neuf de ces tribunaux spéciaux sont à peu près identiques à ceux des procès par jurés. Comme le montre le tableau V, les accusés jugés par les tribunaux de l’an X avaient plus de chances d’obtenir une simple peine correctionnelle que ceux qui comparaissaient devant les tribunaux criminels ordinaires. On le voit, les magistrats n’étaient pas forcément plus à l’aise avec la rigidité du système pénal que ne l’étaient les jurés98. Encore une fois, la Seine-Inférieure se distingue par son zèle répressif, alors que la Gironde, la Haute-Saône et la Somme acquittent fréquemment les prévenus. Les jugements se font plus fermes durant les premières années de l’Empire, comme ce fut le cas pour les tribunaux ordinaires et ceux de l’an IX : le taux d’acquittements y diminue d’un tiers après l’an XIII (1804-1805) et les peines correctionnelles augmentent. Près de deux tiers des accusés jugés par les neuf tribunaux spéciaux comparaissaient pour « faux en écritures publiques ou privées ». Un quart d’entre eux était soupçonné d’avoir assailli des officiers de la force publique – en général des gendarmes qui escortaient des prisonniers ou effectuaient des arrestations99. Enfin, comme on pouvait s’y attendre pour une juridiction chargée principalement de juger les affaires de faux, la peine de mort et les longues peines de fers étaient rarement prononcées : le plus souvent, on y observe l’application des sentences prévues par le Code pénal pour faux (de quatre à huit ans de fers).
Tableau VII : Tribunaux spéciaux Nombre d’accusés ayant reçu des peines criminelles, des peines correctionnelles et des acquittements, an X-1811
Par crime
68Les tribunaux de l’an X ont jugé peu de femmes. Du fait de la prépondérance des hommes dans le monde des faussaires, les femmes n’y représentent que 10 % des accusés (contre 17 % des personnes jugées par les tribunaux criminels ordinaires). De plus, les juges de ces tribunaux spéciaux ont acquitté proportionnellement plus de femmes (60 %) que d’hommes (43 %)100. Aux tribunaux de l’an X en Côte-d’Or et dans le Cher, un tiers environ des accusés sont des artisans ou des petits commerçants ; le reste est constitué de cultivateurs et de journaliers (un quart), de professions libérales et de fonctionnaires (un huitième), et de quelques propriétaires fonciers, déserteurs et domestiques101.
69Dans l’ensemble, les tribunaux spéciaux de l’an X penchaient vers la clémence, tout comme les tribunaux criminels ordinaires. Les jugements draconiens sont rares, les peines sont souvent atténuées par des « excuses » accordées au prévenu. Par contre, les jugements des tribunaux de l’an IX se conforment davantage à l’image consacrée d’une justice napoléonienne rigoureuse : les exécutions pour vol à main armée sont assez fréquentes (malgré des taux d’acquittements élevés). Des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux évaluer le fonctionnement des tribunaux spéciaux. Mais il est clair que l’on ne peut saisir le fonctionnement de l’appareil judiciaire sous Napoléon (tout comme celui des années 1790) en s’en tenant à ses dispositions législatives. Débarrassés du jury, de nombreux tribunaux spéciaux présentent des taux de relaxes similaires ou supérieurs à ceux des procès par jurés.
***
70La Révolution française n’a pas inventé la justice d’exception. Celle-ci a surgi dans des sociétés fondées sur une notion du Droit : on ne saurait concevoir une « justice d’exception » s’il n’existe pas de procédure légale établie dont les normes sont susceptibles d’être violées102. Sous l’Ancien Régime, la principale juridiction extraordinaire était la justice prévôtale. Cette procédure expéditive fut créée par Louis XI, et sa compétence élargie par la suite pour inclure les crimes commis non seulement par des soldats mais aussi par des « marginaux » en général – vagabonds, « gens sans aveu », bandits de grand chemin, récidivistes103. Mais c’est bien sous la Révolution que l’embarrassante dualité de la « règle de droit » et de la « justice d’exception » est apparue clairement : la Terreur et les droits de l’homme se sont alors imprimés simultanément, et de façon indélébile, dans la mémoire humaine. Les tribunaux criminels ont également connu ce paradoxe. Plus que toute autre institution, ils incarnaient la nouvelle conception de la justice formulée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Mais pendant la Terreur, et à nouveau sous Napoléon, leurs procédures furent modifiées par les législateurs au nom d’un intérêt supérieur104.
Notes
1 Loi des 19 et 20 mars 1793 (Duvergier, t. V, p. 253-255), art. 1. Par commodité, nous l’appellerons dans la suite du texte : la « loi du 19 mars ». Jean-Clément Martin montre que cette loi était dirigée contre la Bretagne et non contre la Vendée : voir Martin (J.-C.), La Vendée et la France, Paris, Seuil, 1987, p. 28-31, et Martin (J.-C.), Contre-Révolution, Révolution et Nation en France, 17891799, op. cit., p. 170-171. Voir aussi Gueniffey (P.), La politique de la Terreur, Paris, Fayard, 2000, p. 34-35 ; Petit (J.), La justice révolutionnaire en Maine-et-Loire sous la Convention, thèse en droit, Université de Poitiers, 1966, p. 25-26.
2 Juger le monarque selon la lettre de la constitution était une affaire compliquée du fait de son immunité constitutionnelle. Néanmoins, la majorité de la Convention s’en tint à une position « légaliste » et Louis XVI lui-même formula sa défense en termes de droit. Voir les arguments de Mailhe dans Walzer (M.), Regicide and Revolution : Speeches at the Trial of Louis XVI, Cambridge, Cambridge University press, 1974, p. 93-109.
3 Ibid., p. 121, 138. Voir aussi Martin (J.-C.), Contre-Révolution, Révolution et Nation en France, 1789-1799, op. cit., p. 152 et Hampson (N.), Saint-Just, Oxford, Blackwell, 1991, p. 84-86.
4 Voir le court décret du 18 mars et la loi des 28 mars et 5 avril 1793. Le tribunal révolutionnaire, créé le 10 mars, instituait une nouvelle juridiction pour les crimes politiques – mais elle le faisait sans prétendre modifier aussi radicalement le déroulement du procès lui-même. Les prévenus comparaissaient devant un « jury », et du moins dans la version initiale du tribunal, pouvaient répondre aux accusations formulées à leur encontre.
5 Loi des 19 et 20 mars 1793, op. cit., art. 2.
6 Ibid., art. 4.
7 Ibid., art. 5.
8 Lettre du 23 avril 1793 de l’accusateur public de la Vendée au ministre de la Justice, dans Chassin (C.-L.), La Vendée patriote, 1793-1795, Paris, P. Dupont, 1893, t. I, p. 155. Le registre des jugements criminels de Fontenay fut détruit lors de la prise de la ville par les rebelles en mai 1793.
9 Concernant le statut social des personnes exécutées, voir les jugements enregistrés dans AD Vendée L 1516. La victime la plus célèbre fut sans conteste Alexis Thiérot, un ancien membre de l’Assemblée législative devenu juge au tribunal de district à Montaigu. Sur les 117 personnes jugées pour rébellion armée entre le 5 octobre et le 11 décembre par le tribunal criminel, 32 furent exécutées, 27 relaxées, et 58 détenues pour avoir participé à la révolte, ou en tant que suspects, ou encore en attendant que les enquêteurs recueillent davantage d’informations. Le 10 mai 1793, la Convention avait décrété que la peine de mort prévue au titre de la loi du 19 mars serait réservée aux « chefs » de la révolte, et la loi du 5 juillet précisait la signification de ce terme.
10 Voir l’arrêté de Lequinio du 21 frimaire an II (11 décembre 1793) dans AD Vendée, L 1516, et la lettre de Dupuy du 11 frimaire an II (1er décembre 1793), reproduite dans Chassin (C.-L.), op. cit., t. IV, p. 43-44. Voir aussi Martin (J.-C.), La Vendée et la France, Paris, Seuil, 1987, p. 206-207.
11 Deux personnes soupçonnées d’avoir fomenté des actes de rébellion armée ou d’y avoir pris part furent exécutées dans la Haute-Garonne, deux dans le Finistère, et une en Côte-d’Or. Voir AD Haute-Garonne, 7L 201 U1, 11 avril, 1793 ; AD Finistère, 67L 3, 9 avril et 22 avril, 1793 ; et AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 10 n° 44.
12 AD Finistère, 67L 2 et 67L 3, jugements du 9 avril au 2 mai 1793. Un refrain apparaît sans cesse dans ces registres : « Il n’existe aucune preuve ». L’insuffisance de preuves invoquée lors du procès du 20 avril est consignée au registre 67L 2. Toutes ces affaires concernaient la révolte armée contre la levée des 300 000 hommes.
13 Durant la première quinzaine de mars, la Côte-d’Or fut le théâtre de manifestations et d’incidents provoqués par des jeunes gens. Ceux-ci protestaient contre le fait que les fonctionnaires étaient exemptés du service militaire. Le « rassemblement séditieux » le plus conséquent eut lieu le 10 mars à Dijon : une centaine de jeunes hommes se réunirent dans un parc de la ville avant d’être dispersés par un contingent de Gardes nationaux. Voir Richard (J.), « La levée de 300 000 hommes et les troubles en mars 1793 en Bourgogne », Annales de Bourgogne, 1961, p. 213-251 et Bart (J.), La Révolution française en Bourgogne, op. cit., 1996, p. 213-215.
14 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 10 n° 44.
15 Loi des 19 et 20 mars 1793, op. cit., art. 6.
16 Bart (J.), La Révolution française en Bourgogne, op. cit., 1996, p. 249-250.
17 Bibliothèque municipale, Dijon. MS 1660 (L. B. Baudot), p. 206.
18 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 10 n° 44.
19 Chassin (C.-L.), op. cit., t. I, p. 152-157 ; AD Cher, L 1513, jugements du 29 juillet et du 23 septembre 1793, et L 1514, jugements du 10, 12, et 15 germinal an II ; AD Landes, 108L 4, 16 et 21 mai, 1793 ; et AD Finistère, 67L 2 et 67L 3, jugements d’avril 1793, et 67L 3, 24 nivôse an II. Voir aussi Robillard De Beaurepaire (E. DE), La Justice révolutionnaire à Bourges, Bourges, Pigelet, 1869, p. 10-11, 73-76.
20 Pour les affaires de propos contre-révolutionnaires jugés conformément à la loi du 19 mars, voir AD Yvelines, 42L 1, 25 septembre 1793 et 19 brumaire an II ; AD Cher, L 1514, 1er brumaire et 9 frimaire an II ; AD Hautes-Pyrénées, 2L 2, 22 floréal an II ; AD Gard, L 3038, 6 nivôse an II ; AD Landes, 108 L 4, 1er frimaire an II ; AD Haute-Garonne, 7L 201 U1, 1er septembre 1793. Le tribunal de Nîmes appliqua la loi du 19 mars à une personne accusée d’avoir participé à une insurrection fédéraliste dans cette ville (AD Gard, L 3038, 1 nivôse an II). Quatre inculpés furent exécutés à Toulouse au titre des mêmes dispositions pour avoir pris part à des révoltes contre la levée en masse (AD Haute-Garonne, 7 L 201 U1, 17 septembre 1793, 17 frimaire an II), et le tribunal de Dax exécuta un accusé pour la même raison (AD Landes, 108 L 4, 8 frimaire an II).
21 Loi des 28 mars et 5 avril 1793, op. cit., art. 1. Dans la suite du texte, nous l’appellerons simplement : la « loi du 28 mars ».
22 Dans les seize tribunaux criminels choisis pour cette étude, 3 hommes accusés d’avoir émigré furent acquittés par les jurés avant la loi du 28 mars (voir AD Haute-Garonne, 7L 201 U1, 24 décembre 1792 ; AD Gironde, 5L 53, 17 février, 1793 ; et AD Haute-Saône 368L 10, 15 février, 1793). Voir aussi le procès de Claude Mignot à Dijon, décrit au Chapitre V. En outre, 4 prévenus furent innocentés par des jurés après la promulgation de la loi, qui ôtait toute compétence au jury de jugement pour entendre les affaires d’émigration ! Voir AD Somme, L 3192, 17 avril 1793 ; AD Rhône, 39L 60, 15 juin 1793 ; et AD Hautes-Pyrénées, 2L 2, 28 brumaire et 16 pluviôse an II.
23 Loi des 28 mars et 5 avril 1793, op. cit., Section XII.
24 Sur Bernard, voir Bart (J.), La Révolution française en Bourgogne, op. cit., 1996, p. 242-243, 246250, et Biard (M.), Missionnaires de la République, op. cit., p. 459.
25 Le 9 pluviôse, les magistrats jugèrent Claude Mignot, détenu depuis le report de son procès en mars (voir chapitre v), et Jean Pageot, un domestique arrêté, comme Mignot, avant la promulgation de la loi du 26 novembre 1792. Au titre de circonstances atténuantes, les juges condamnèrent les deux hommes à quitter le territoire français, mais suspendirent cette peine « jusqu’à la paix » et ordonnèrent qu’ils soient emprisonnés comme suspects (AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 14 nos 79 et 80).
26 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 13 n° 70. Le 12 ventôse, deux témoins possédant des certificats de civisme ont identifié l’accusé.
27 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 16 n° 92. Parallèlement à l’affaire Ferrand évoquée ci-dessus, voir aussi 2LF 1, 2LF 17 nos 103 et 104 : l’affaire François Perret, qui avoua s’être rendu en Angleterre au service d’un officier du régiment de royal vaisseau, et fut exécuté le 5 germinal ; ainsi que l’affaire Jean-Baptiste Pernet, qui reconnut avoir séjourné à Genève et à Lausanne, et fut guillotiné le 2 germinal.
28 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 16 n° 101, « Jean Vivant Micault, citoyen de Dijon prévenu d’émigration », Dijon, le 19 ventôse.
29 Loi des 28 mars et 5 avril 1793, op. cit., Section VI, art. 22. Conformément à la législation de la Convention, les personnes inscrites sur les listes d’émigrés pouvaient se disculper en apportant la preuve qu’ils avaient résidé d’une façon continue en France depuis le 9 mai 1792 (section III, art. 2 et 3). Le choix de cette date s’explique par une disposition de la loi du 30 mars-8 avril 1792, qui permettait de réintégrer les émigrés revenus en France après le 9 février 1792 – une offre valable un mois après la promulgation de la loi. Le 9 mai 1792 marquait donc la fin de la période de grâce. Les émigrés qui retournaient au pays avant le 9 mai étaient en règle et n’avaient – jusqu’à nouvel ordre – rien à prouver. Ceux qui n’avaient pas légalisé leur situation avant le 9 mai devaient démontrer qu’ils avaient résidé depuis cette date en France.
30 Voir la loi des 20 et 25 décembre 1792 (Duvergier, t. V, p. 110-111), qui exigeait que les personnes soupçonnées d’émigration fournissent des certificats de résidence.
31 Section VI, art. 30. La loi du 28 mars annulait exclusivement les certificats de résidence délivrés aux personnes figurant sur la liste des émigrés – c’est-à-dire, en fait, les seuls certificats valables légalement ! Nous n’avons pu déterminer si le certificat que Mignot affirmait avoir obtenu lui fut réellement accordé.
32 Micault soutenait que si la municipalité de Dijon avait répondu à ses lettres, il aurait été informé du fait que son certificat dijonnais ne pouvait être renouvelé par procuration (une démarche qui lui avait été conseillée par les officiers municipaux de Luxeuil) et se serait rendu en personne au chef lieu de la Côte d’Or. AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 16 n° 101, « Jean Vivant Micault, citoyen de Dijon prévenu d’émigration », Dijon, le 19 ventôse.
33 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 16 n° 101, jugement du tribunal criminel du 27 ventôse an II.
34 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 16 n° 101, « Aux citoyens du directoire du département de la Côte-d’Or », Dijon, le 25 ventôse.
35 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 16 n° 101. Voir aussi le dossier de police, AD Côte-d’Or, Q 1070 (n° 2).
36 Section XII, art. 76.
37 L’impossibilité de faire appel impliquait que les autorités départementales pouvaient interpréter la loi du 28 mars à leur guise, sans risquer d’être contredits ou réprimandés par une instance judiciaire ou administrative centrale, comme le Comité de Législation.
38 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 17 n° 102. Micault de Corbeton avait aussi fait allusion indirectement au problème de la compétence du tribunal. Mais son argumentation n’avait guère de portée légale : il contestait les accusations portées à son encontre en faisant observer que son département de résidence, en le maintenant en détention, ne le considérait clairement pas comme un émigré. Voir AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 16 n° 101.
39 Loi des 28 mars et 5 avril 1793, op. cit., Section XI, art. 63. Les personnes dont les réclamations avaient déjà été rejetées ne pouvaient en déposer une autre : elles étaient obligées de quitter la France dans les huit jours sous peine de mort. Dorénavant, les personnes figurant sur une liste d’émigrés avaient un mois pour présenter une réclamation (art. 62 et 64).
40 Section XI, art. 66 : « Les arrêtés des départements qui ont rejeté ou qui rejetteront les réclamations formées par des émigrés, seront définitifs, et exécutés sans aucun recours. »
41 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 16 n° 101. Micault affirmait qu’il lui aurait été physiquement impossible d’obtenir en personne le certificat de Nancy et celui de Dijon en quinze jours.
42 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 17 n° 110. L’article 64 de la loi du 28 mars stipulait qu’à l’avenir, les personnes inscrites sur la liste des émigrés auraient un mois pour déposer une réclamation. La liste où figurait le nom de Guyard avait été affichée à Dijon le 2 frimaire. Il fut arrêté et emprisonné le 13 du même mois lorsqu’il fit une demande de certificat de résidence à Bourg. Les administrateurs départementaux à Dijon rejetèrent sa réclamation, « considérant que Jean-Baptiste Guyard ne s’étant point pourvu devant le département dans le délai d’un mois, à compter de la publication et de l’affiche de la liste sur laquelle il a été inscrit […] ». Il fut exécuté le 21 germinal.
43 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 17 n° 102.
44 Lors de son interrogatoire, Colmont reconnut s’être rendu à Lausanne en janvier 1792 afin de soigner sa femme. Lorsqu’ils apprirent la promulgation de la loi du 30 mars 1792, les deux époux sont rentrés en France. Colmont s’était donc fixé pour objectif de prouver, certificats à l’appui, qu’il n’avait pas quitté le pays depuis son retour en avril 1792.
45 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 17 n° 106. L’article 63 prévoyait que « les personnes portées sur les listes des émigrés, qui ont réclamé, et sur les demandes desquelles il n’a point été statué, et celles dont les certificats de résidence sont annulés, seront tenues de s’en pourvoir, dans quinze jours, à compter de la promulgation du présent décret ».
46 Tout en acquittant les prévenus de l’accusation de complicité d’émigration, le tribunal décréta qu’ils étaient coupables d’« opinions anticiviques » et ordonna qu’ils soient détenus en tant que suspects (AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 15 n° 85). Concernant les deux domestiques, voir note n° 25.
47 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 17 n° 105.
48 AD Yvelines, 42L 1, 6 nivôse et 26 pluviôse an II ; AD Ain, registre non-classé, intitulé « Registre des audiences, 1792, II-V, » 5 nivôse et 4 floréal an II ; AD Creuse 2L 16, 5 brumaire an II ; AD Gard, L 3039, 9 floréal an II ; AD Haute-Garonne, 7L 201 U1, 30 septembre 1793 ; AD Hautes-Pyrénées, 2L 3, 19 prairial an II. Dans les seize départements combinés, 10 personnes furent acquittées de ce chef d’accusation. Voir (outre les 3 acquittements formels en Côte-d’Or) AD Ain, registre non-classé, intitulé « Registre des audiences, 1792, II-V, » 18 pluviôse an II ; AD Cher, L 1513, 24 mai 1793 (4 accusés), AD Creuse 2L 15, 12 juin 1793 ; AD Haute-Garonne, 7L 201 U1, 24 juillet 1793.
49 Combier (A.), La justice criminelle à Laon pendant la Révolution, 1789-1800, Paris, H. Champion, 1882, t. I, p. 101.
50 Loi des 28 mars et 5 avril 1793, op. cit., Section III, art. 6.
51 Ibid. Cette notion apparaît pour la première fois dans la loi des 30 mars et 8 avril 1792 (Duvergier, t. IV, p. 110-112), le premier texte législatif instituant les listes d’émigrés. Selon cette loi, les listes devaient mentionner des propriétés plutôt des personnes. Mais les gens dont la propriété pouvait être confisquée étaient des « émigrés » présumés, ou plus exactement des « personnes qu’elle [la municipalité] ne connaîtra pas pour être actuellement domiciliées dans le département... » (art. 7)
52 AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 17 n° 109.
53 Section VI, art. 28.
54 Loi des 29 et 30 vendémiaire an II (Duvergier, t. VI, p. 298-299).
55 La loi des 23 et 24 avril 1793 (Duvergier, t. V, p. 319) ordonnait que tout membre du clergé qui n’avait pas prononcé le serment à la liberté et à l’égalité soit déporté en Guyane française, à l’exception des infirmes et des vieillards (art. 4) et des ecclésiastiques occupant des fonctions électives, administratives ou militaires (art. 6).
56 Loi des 29 et 30 vendémiaire an II, op. cit., art. 5. Les magistrats pouvaient prononcer une condamnation si deux témoins attestaient que le prisonnier était sujet à la déportation (art. 6).
57 AD Landes 108L 4, 3 pluviôse an II.
58 AD Finistère, 67L 2, 28 fructidor an II. Il s’agissait d’un « domestique à gages », d’un « aide cultivateur », et d’une « fermière en société » avec Anne Le Saint.
59 Loi des 29 et 30 vendémiaire an II, op. cit., art. 7. Au titre de cet article, les juges du tribunal criminel pouvaient refuser d’accorder à l’accusé un délai pour se procurer cette attestation.
60 AD Haute-Garonne, 7L 201 U1, 7 et 14 floréal an II, et concernant les trois autres affaires, 7L 201 U1, 17 brumaire, 7 floréal, et 2 thermidor an II.
61 Outre les 5 exécutions en Haute-Garonne, voir AD Finistère, 67L 2, 26 ventôse, 23 germinal, et 28 fructidor an II, et 23 vendémiaire an III ; AD Landes, 108L 4, 3 pluviôse, 15 ventôse, et 19 germinal an II ; AD Gard, L 3038, 16 pluviôse et 1er germinal an II, et L 3039, 2 floréal an II ; AD Somme, L 3192, 19 germinal et 1er thermidor an II ; AD Hautes-Pyrénées, 2L 2, 8 pluviôse an II ; AD Vendée, L 1516, jugement rendu au début du mois de ventôse an II (non daté) ; et AD Côte-d’Or, 2LF 1, 2LF 16 n° 100. Seuls deux des seize tribunaux criminels ont acquitté des personnes accusées d’avoir violé la loi du 29 vendémiaire : 4 hommes et 2 femmes furent innocentés à Quimper en l’an II (AD Finistère, 67L 3, 27 germinal et 12 thermidor an II, et 67L 2, 28 fructidor an II), tandis que le tribunal de Guéret exonéra 4 hommes (2L 15, 7 juin 1793 ; 2L 17, 7 et 12 ventôse an II ; 2L 18, 19 germinal an II).
62 AD Haute-Garonne, 7L 201 U1, 11 octobre 1793.
63 Loi des 26 et 27 juillet 1793. L’article 13 prévoit que « les jugements rendus par les tribunaux criminels en vertu de la présente loi ne seront pas sujets à l’appel. » Mais la loi ne stipule pas que les accusés n’ont pas droit à un procès par jurés. Voir AP t. LXIX, p. 594-595.
64 AD Haute-Garonne, 7L 201 U1, 9 brumaire, 10 brumaire, et 1er frimaire an II.
65 Voir Greer (D.), The Incidence of the Terror in the French Revolution : A Statistical Interpretation, Cambridge, Mass., Harvard University press, 1935, tableau présenté dans Jones (C.), The Longman Companion to the French Revolution, Londres, 1988, p. 115-118. Les sept départements sont : la Loire-Inférieure (276 exécutions ordonnées par le tribunal criminel), l’Orne (187), la Sarthe (146), le Gard (136), l’Ille-et-Vilaine (87), la Lozère (87), les Deux-Sèvres (80).
66 Avant l’arrivée de Laplanche à Bourges en septembre 1793, le directoire du département avait ordonné, à quatre occasions, que des accusés comparaissent devant le tribunal criminel et soient jugés « extraordinairement » pour propos inciviques. Mais à chaque fois, les juges du tribunal prononcèrent l’acquittement, au motif que le prévenu avait seulement exprimé une « opinion inconsidérée ». AD Cher, L 1513, 29 juillet, 6, 19, et 27 août 1793.
67 Sur le rôle des représentants en mission, voir Biard (M.), Missionnaires de la République : les représentants du peuple en mission, 1793-1795, op. cit.
68 Girardot (J.), Le département de la Haute-Saône pendant la Révolution, Vesoul, Société d’agriculture, lettres, sciences et arts de la Haute-Saône, 1973, t. III, p. 6, 225 ; Histoire de Tarbes, Roanne, Éditions Harvath, 1982, 2e éd., p. 197-198, 203 ; AD Somme, L 3192, les décrets de Dumont, 1er et 3 ventôse an II et les réponses du tribunal, 8 et 19 ventôse.
69 Duport (A.-M.), Terreur et Révolution : Nimes en l’an II, 1793-1794, Paris, Touzot, 1987, p. 182. Le décret de la Convention nationale fut adopté le 26 germinal an II, mais en province certains procès « exceptionnels » se déroulèrent devant des tribunaux criminels après cette date. Sur le Gard, voir aussi Lewis (G.), The Second Vendée, Oxford, Oxford University press, 1978.
70 84 % des personnes qui ont comparu devant ce tribunal étaient soupçonnées de participation ou de complicité dans la révolte fédéraliste qui secoua la région. Voir ibid., p. 276.
71 Ibid., p. 277, 282.
72 Le tribunal de Fontenay jugea 117 personnes en 67 jours entre le 5 octobre et le 11 décembre 1793 (1,75 prisonniers par jour), alors que celui de Nîmes jugea 252 personnes en 70 jours entre le 5 prairial et le 14 thermidor (3,6 prisonniers par jour). Voir AD Vendée L 1516, ainsi que AD Gard L 3039 et 3040. Le second de ces registres fournit les comptes-rendus de jugement de 31 accusés de Beaucaire, qui furent tous jugés le 29 messidor et exécutés pour fédéralisme.
73 AD Gard, L 3039, 25 germinal an II.
74 Duport, op. cit., p. 265-271. Les peines capitales prononcées dans le Gard et en Vendée étaient fondées sur des lois pénales différentes. À Fontenay le tribunal criminel, dans ses jugements contre les hommes accusés de rébellion armée, citait souvent la loi du 19 mars. Le tribunal de Nîmes justifiait ses verdicts à l’encontre des fédéralistes en se référant à trois lois, qui prévoyaient toutes la peine de mort pour les conjurations contre l’État : les dispositions du Code pénal contre les « conspirations ou complots tendant à troubler l’État par une guerre civile […] » et les lois votées par la Convention le 16 décembre 1792 et le 23 ventôse an II. Voir, par exemple, les jugements du 5, 8, 13, 28 prairial, 6 et 15 messidor an II dans AD Gard L 3039, ainsi que ceux du 27 et 29 messidor, et du 3, 7, 9 thermidor an II dans L 3040.
75 En Maine-et-Loire, par exemple, le rôle du tribunal criminel dans la répression des révoltés « ne fut jamais bien considérable » et son histoire sous la Terreur « fut celle d’un progressif effacement devant des juridictions plus exceptionnelles, donc plus expéditives : les deux commissions militaires de l’armée des Côtes de La Rochelle et de l’armée de l’Ouest ». Voir Petit (J.), La justice révolutionnaire en Maine-et-Loire sous la Convention, thèse en droit, Université de Poitiers, 1966, p. 134.
76 AD Finistère, 67L 2, 28 fructidor an II et 67L 3, 23 vendémiaire an III ; et Girardot (J.), op. cit., t. III, p. 284.
77 Voir AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 27 n° 201 ; 2LF 2, 2LF 31 228b ; 2LF 2, 2LF 35 n° 237 ; 2LF 2 ; 2LF 44 n° 306 ; 2LF 2, 2LF 45 n° 312 ; 2LF 2, 2LF 49 n° 335 ; 2LF 3, 2LF 52 n° 358b ; 2LF 3, 2LF 57 n° 382, et la loi du 25 brumaire an III, Titre V, Section I.
78 AD Côte-d’Or, 2LF 2 n° 205b ; 2LF 2 n° 281 ; 2LF 2 n° 337 ; 2LF 2 n° 348 ; 2LF 3 n° 366 ; et 2LF 3 n° 404. Voir la loi du 25 brumaire an III, Titre V, Section I, art. 6.
79 AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 35 n° 237b, et la loi du 12 floréal an III, art. 2.
80 Conformément à la loi du 20 fructidor an III, qui prévoyait que les prêtres réfractaires devaient être bannis du pays, les magistrats ont libéré 4 prêtres insermentés en l’an IV, et leur ont ordonné de quitter le territoire de la République (AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 38 n° 256 ; 2LF 2, 2LF 40 nos 269 et 271 ; 2LF 2, 2LF 41 n° 272). Après fructidor an IV, 7 prêtres furent purement et simplement relâchés (AD Côte-d’Or, 2LF 2, 2LF 49 n° 338 ; 2LF 3, 2LF 52 n° 359 ; 2LF 3, 2LF 53 nos 366, 367, et 368 ; 2LF 3, 2LF 56 n° 377).
81 Loi du 19 fructidor an V (Duvergier, t. X, p. 42-46).
82 Loi du 18 pluviôse an IX (Duvergier t. XII, p. 386-390) ; Clauss (C.), op. cit., p. 118-119 ; et l’arrêté du 4 ventôse an IX (AN AD III 53). Voir aussi Landron (G.), Justice et démocratie : le tribunal criminel de Maine-et-Loire (1792-1811), op. cit., p. 256-265 ; Moyaux (D.), Naissance de la justice pénale contemporaine : la juridiction criminelle et le jury – l’exemple du Nord (1792-1812), op. cit., t. II, p. 392-438 ; Brown (H.), « From Organic Society to Security State », Journal of Modern History 69, 1997, p. 686-688.
83 AN AD III 53, voir la déclaration de Chazal au Tribunat, 6 pluviôse an IX, et celle de Constant, 5 pluviôse an IX.
84 AN AD III 53, Rapport d’Honoré Duveyrier, 29 nivôse an IX. Les tribunaux spéciaux, justifiés comme des mesures temporaires en temps de guerre, étaient destinés à être démantelés deux ans après le retour de la paix.
85 Loi du 18 pluviôse an IX, op. cit., art. 24-27.
86 Ibid., articles 23 et 29. Ainsi, aucune clause ne permettait aux accusés des tribunaux spéciaux de consulter ces documents. En revanche, les dispositions de l’article 10 du 7 pluviôse an IX stipulaient que les dépositions des témoins devaient être lues aux prévenus mis en accusation selon la procédure ordinaire.
87 Bouguet (D.), « Une juridiction d’exception : le tribunal criminel spécial d’Indre-et-Loire (an IX1811) », Histoire de la Justice, 7, 1994, p. 89-116 ; Landron (G.), « Les tribunaux criminels spéciaux contre les tribunaux criminels avec jury (France, an IX-1811) » dans Rousseaux (X.), Dupont-Bouchat (M.-S.) & Vael (C.) (dir.), Révolutions et justice pénale en Europe : modèles français et traditions nationales, 1780-1830, op. cit., p. 189-198.
88 Pour les jugements rendus par ces tribunaux de l’an IX, voir AD Gard, 3U 1/1-3 ; AD Seine-Maritime, 7U 6-8 ; AD Vaucluse 7U 4-6. Dans les tableaux IV et VIII, la colonne des « fers » comprend aussi bien les hommes (condamnés aux « fers ») que les femmes (condamnées à la réclusion dans une « maison de force »). Les chiffres figurant aux tableaux I-IV sont basés sur ces trois départements.
89 AD Seine-Maritime, 7U 6, jugements du 27 floréal et 7 thermidor an X.
90 L’un de ces accusés fut condamné à mort pour le vol de trois pains et trois quartes de farine. Il fut gracié à la dernière minute par l’Empereur (AD Seine-Maritime, 7U 6, jugement du 29 prairial an XIII).
91 En vertu de la loi du 18 pluviôse an IX, les tribunaux spéciaux devaient prononcer la peine capitale contre les personnes coupables de vols avec violences sur les « grandes routes », ou de « vols dans les campagnes […] lorsqu’il y aura effraction faite aux murs de clôture, au toit des maisons, portes et fenêtres extérieures, ou lorsque le crime aur été commis avec port d’armes et par une réunion des deux personnes au moins. » (Voir la loi du 18 pluviôse an IX, art. 29, 8, et 9). Mais il arrivait que le tribunal spécial de Rouen ne tienne pas compte de ces circonstances (voir, par exemple, AD Seine-Maritime, 7U 6, jugements du 9 messidor an XIII).
92 Sur les vagabonds, voir Landron (G.), « Les tribunaux criminels spéciaux contre les tribunaux criminels avec jury (France, an IX-1811) », op. cit., p. 193 ; Schnapper (B.), « Compression et répression sous le Consulat et l’Empire », op. cit., p. 36-37.
93 En brumaire an X, le tribunal spécial du Vaucluse déclare qu’« il n’existe pas de loi qui autorise le tribunal spécial à infliger une peine à un individu auquel on ne peut reprocher que le vagabondage... » AD Vaucluse, 7U 4, jugement du 16 brumaire an X.
94 La décision de ne pas considérer le vagabondage comme un délit se trouve dans AD Gard, 3U 1/1, jugement du 2e jour complémentaire an IX. Le traitement réservé aux vagabonds présumés est consigné dans 3U 1/1-3, passim. Voir, par exemple, le jugement du 3 brumaire an XI : le tribunal spécial, ayant déclaré l’accusée coupable de vagabondage, « ordonne qu’elle sera traduite de brigade en brigade dans la commune des Vans où elle dit avoir habité pour être mise à la disposition du maire du lieu... »
95 Voir AD Seine-Maritime, 7U 6, jugements du 6 prairial an IX et passim. Les personnes accusées de vagabondage avaient plus de chances d’être acquittées à Nîmes qu’à Rouen : le tribunal spécial du Gard condamna 146 vagabonds présumés et en innocenta 54, alors que celui de la Seine-Inférieure en condamna 65 et en acquitta 6.
96 AN ADIII 51, « Motifs » joints à la loi du 23 floréal an X.
97 Loi du 23 floréal an X (Duvergier, t. XIII, p. 429-432), art. 2, 4, et 5.
98 Pour les jugements rendus par les tribunaux spéciaux de l’an X, voir AD Cher, 2U 1131 ; AD Côte-d’Or, 2U 91-93 ; AD Gard, 3U 2/1 ; AD Gironde, 2U 123-131 ; AD Meurthe-et-Moselle, le répertoire numérique de la série 2U ; AD Hautes-Pyrénées, U 1-2 ; AD Haute-Saône, 368L 14, 2U 5-16 ; AD Seine-Maritime, 7U 9-11 ; AD Somme, L 3197. Les chiffres figurant aux tableaux V-VIII sont basés sur ces neufs départements.
99 Une telle infraction ne relevait pas formellement de la compétence des tribunaux spéciaux de l’an X et semble leur avoir été soumise par la volonté discrétionnaire des accusateurs publics. Les tribunaux spéciaux ont entendu peu d’affaires d’incendies volontaires (sauf dans la Somme) ou de fausse monnaie. Dans les départements où un tribunal spécial de l’an IX fonctionnait, le tribunal de l’an X cédait souvent à ce dernier toutes les affaires d’incendie et de faux.
100 Sur 100 femmes ayant comparu devant les neuf tribunaux de l’an X étudiés ici, 25 reçurent des peines criminelles, 14 des peines correctionnelles, et 61 furent acquittées. Sur 858 hommes, les chiffres sont respectivement : 312 (36 %) ; 181 (21 %) et 365 (43 %).
101 Parmi les 111 accusés jugés par ces deux tribunaux spéciaux, on trouve 40 artisans ou commerçants, 14 cultivateurs, 12 journaliers, 6 propriétaires, 4 laboureurs, 14 membres des professions libérales et fonctionnaires, 8 déserteurs, 7 domestiques, et 6 divers.
102 Si l’homme naturel de Rousseau se soumet au « droit du plus fort », seul l’homme civil est susceptible de souffrir du « despotisme ». Voir Rousseau, Du contrat social, Livre 1, chapitre 3, et Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité, seconde partie, paragraphes 55 et 56.
103 Carbasse (J.-M.), Introduction historique au droit pénal, op. cit., p. 116-117 ; Cameron (I.), Crime and Repression in the Auvergne and the Guyenne, 1720-1790, Cambridge, Cambridge University Press, 1981.
104 La justice d’exception, comme l’a montré Jean-Louis Bredin, « est toujours tirée d’un intérêt supérieur : le peuple, la patrie, l’État, la Nation, la France ». Voir Bredin (J.-D.), « La France et les droits de l’Homme : du culte au mépris », communication à l’Académie des sciences morales et politiques, le 12 mars 2001.
|
|
Droit d’auteur La plupart des photographies publiées sur ce site sont la propriété exclusive de © Claude Balmefrezol Elles peuvent être reproduites pour une utilisation personnelle, mais l’autorisation préalable de leur auteur est nécessaire pour être exploitées dans un autre cadre (site web publications etc) Les sources des autres documents et illustrations sont mentionnées quand elles sont connues. Si une de ces pièces est protégée et que sa présence dans ces pages pose problème, elle sera retirée sur simple demande. Principaux Collaborateurs:
Nb
de visiteurs:7590170 Nb
de visiteurs aujourd'hui:2523 Nb
de connectés:542 | |||||||||||||||||||||||||||||





.JPG)
.JPG)
.JPG)








