| |
|
|
|
|
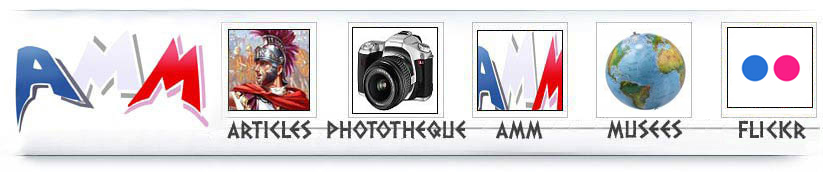
|
|
|
| |
|
|
|
|
 Etrurie Bronze Carello rituale de Bisenzio Rome MNE
Etrurie Bronze Carello rituale de Bisenzio Rome MNE


Le Carello rituale de Bisenzio Rome MNE
Historique Voir ICI
History Click HERE
A environ 4 km de Capodimonte, sur la rive sud-ouest du lac de Bolsena, s'élève le Monte Bisenzo ou Bisenzio dont le sommet et les pentes étaient habités par d'anciennes civilisations. Avant l'arrivée de l'homme, le Mont Bisenzio , comme le montrent les analyses géologiques, était l'une des nombreuses sources éruptives mineures du grand système volcanique Vulsine
La moitié du cône du cratère de la colline s'est effondrée dans le lac, tout comme l'île Bisentina, la Martana et le « Lagaccione »et une dépression orographique située derrière la montagne, dans le bassin de laquelle s'est formé un lac dont les eaux ont persisté jusqu'à il y a quelques siècles
La colline présente des flancs très raides du côté du lac et est couverte d'une forêt luxuriante dans la partie la plus haute et de champs cultivés, de pâturages et de belles oliveraies sur les pentes moins raides qui regardent vers l'intérieur des terres. Un endroit complètement inhabité, à l' exception de quelques fermes au pied de la colline.
Le Monte Bisenzo était en fait l'épicentre d'une colonie dont les origines remontent à l'âge du bronze ; elle fut continuellement peuplée durant l'âge du fer puis à l'époque étrusque. Après une période de crise à l'époque classique et hellénistique, la zone fut réhabitée à l'époque romaine, médiévale et de la Renaissance jusqu'à son déclin complet au XIXe siècle avec le transfert des derniers habitants sur le promontoire voisin de Capodimonte.
La splendeur de la ville de Visentium
Le premier établissement permanent, dont on a retrouvé des traces remontant à l' âge du bronze final (Xe siècle avant J.-C.), était situé au sommet de la montagne et consistait en des huttes de différentes tailles avec un plan circulaire ou elliptique, tout comme les urnes « en forme de hutte » trouvées dans les tombes contemporaines, qui reproduisaient les habitations proto-villanoviennes.
 |
Progressivement et sans interruption, cette petite communauté locale s'est développée en un établissement qui a atteint des dimensions significatives à partir de l' âge du fer ( Xe-VIIIe siècle avant J.-C. avancé , phase dite « villanovienne ») , comme le démontre la richesse des nécropoles environnantes.
L'établissement disposait probablement d'un débouché sur le lac, aujourd'hui submergé, ce qui montre qu'à cette époque la montagne n'avait pas son côté est donnant sur l'eau, comme c'est le cas aujourd'hui, mais était précédée d'une bande de terre d'environ 200 mètres de long qui la séparait de la rive du lac.
Une extension de la ville située dans la zone côtière entre la falaise de Punta San Bernardino et le mont Bisenzio a été émise par plusieurs chercheurs (étant donné la présence de ruines submergées). L'ensemble du territoire de la ville était donc beaucoup plus vaste que ce que l'on peut voir aujourd'hui, le littoral étant beaucoup plus proche du centre du lac qu'aujourd'hui.
 |
Dans la première phase villanovienne, l'établissement ne présentait pas de tissu urbain dense, à l'exception du plateau sur la montagne et de la terrasse artificielle un peu plus bas. L' établissement était en réalité constitué de groupes de maisons dispersées même en dehors des pentes de la montagne, dans la plaine environnante et, peut-être, dans des zones de la côte qui sont aujourd'hui submergées. Ce n’est probablement que vers la fin de l’âge du fer que les petits villages ont commencé à former un noyau unitaire, une « ville » qui a assumé un rôle hégémonique dans le peuplement de la région . Des habitations , des ateliers d'artisans, des entrepôts, des écuries, de petits pâturages et des champs cultivés avec des jardins potagers constituaient le tissu de la grande colonie.
Avec le passage au 7ème siècle. J.-C., après une longue période d'influences provenant des régions côtières les plus exposées aux stimuli égéens et proche-orientaux, les caractéristiques typiques de la culture matérielle étrusque émergent avec force dans les objets funéraires de Bisenzio . Dans la ville, les cabanes ont été remplacées par des bâtiments en briques : des pans de murs appartenant à des habitations étrusques construites en blocs de tuf avec des toits en tuiles et en tuiles, de production locale, ont été identifiés aussi bien sur le sommet de la montagne que le long des pentes (sur la terrasse artificielle) et dans les environs.
Malheureusement, le nom de la glorieuse et florissante cité étrusque est inconnu . Ce n'est qu'à l'époque romaine, en effet, que Pline l'Ancien cite pour la première fois, énumérant une cinquantaine de peuples d'Étrurie à l'époque d'Auguste, les « Vesentini » , ainsi que les « Tarquiniens, Tuscaniens, Veientani, Arretini, Falisci, Blerani, Florentini, Graviscani, Nepesini, Perusini, Vetulonienses », etc., tous d'origine étrusque. À partir du démotique du peuple, Vesentini , on a émis l'hypothèse que le toponyme latin de la ville étrusque était Vesentum , probablement incorrect puisque toutes les épigraphes latines rapportent Visentium . Ce nom est resté inchangé jusqu'à la fin du Moyen Âge. Selon certains chercheurs, le nom dériverait d' Esens (=bronze, en étrusque), tandis que, selon d'autres, de Ves (=feu, en italique) ; dans le premier cas le toponyme rappellerait l'extraordinaire capacité du peuple Bisentini à travailler le bronze, dans le second cas la « ville du feu » rappellerait les terribles événements sismiques et volcaniques dont ce territoire a été témoin depuis longtemps.
Ce sont les recherches archéologiques, commencées dans la seconde moitié du XIXe siècle et poursuivies jusqu'à nos jours, qui ont permis de constater l' intéressante similitude de Bisenzio avec les plus grandes villes côtières étrusques (Cerveteri, Tarquinia et Vulci) et aussi avec Véio , au nord-ouest de Rome, et qui nous font comprendre combien était prestigieux et florissant ce centre de l'Étrurie méridionale intérieure, bien relié aux autres grands centres commerciaux .
Outre les innombrables tombes, des portions de deux routes importantes qui reliaient Visentium aux autres centres de l'Étrurie ont été retrouvées : l'une était le pavage d'une route qui partait de Bisenzio, longeait le « Lagaccione » et se reliait à la Via Clodia près de l'actuel Piansano (exactement à Maternum ) ; une autre route, croisant la précédente, longeait le lac et, à travers le maquis de San Magno, continuait vers la ville étrusque située sur la colline de Civita sur le territoire des actuelles Grottes de Castro. Il s'agit de deux portions d'un réseau routier étrusque (et plus tard romain) efficace qui, partant des villes côtières de Vulci et de Tarquinia et traversant l'intérieur de l'Étrurie méridionale, plaçait Bisenzio au centre d'un trafic commercial dynamique.
La période de développement maximum de la ville s'étend du milieu du VIIIe au VIIe siècle avant JC, lorsque, grâce à sa position géographique, elle était devenue un centre important de distribution et d'échange de marchandises en contact avec Tarquinia, Vulci, Vetulonia, Marsiliana, Poggio Montano (Vetralla), Statonia, Falerii , La Rustica (Rome), Veio, Chiusi. À l'époque archaïque (VIe siècle), comme mentionné précédemment, il est probable que Bisenzio soit tombé sous la juridiction territoriale des riches et puissants Vulci, tandis que d'autres centres plus au sud, comme Cornossa (2,5 km à l'est de l'actuelle Marta), semblent être tombés sous le contrôle de Tarquinia.
Il n’existe pas d’estimation précise du nombre d’habitants de la ville pendant la période d’expansion maximale ; nous sommes certainement de l'ordre de milliers. En ce qui concerne la taille de la colonie , les dernières estimations des chercheurs se situent autour de 80 à 90 hectares . Des sources romaines suggèrent l'existence d'un aqueduc (peut-être de l'époque archaïque, mais malheureusement il n'y a toujours pas de certitude scientifique à ce sujet). La ville avait probablement des murs ou peut-être une double enceinte (de grands blocs carrés ont été retrouvés en divers points du territoire mais, ayant été enterrés à nouveau, ils ne sont plus visibles aujourd'hui).
À la fin de la période étrusque, vers le VIe-Ve siècle. J.-C., il y eut une contraction de la colonie visentine (peut-être due à l'exclusion progressive de Bisenzio des principaux flux commerciaux établis par Vulci, la capitale du district), dont la communauté ne se réaffirmera qu'au Ier siècle. J.-C. lorsque Visentium devint une municipalité romaine (90 av. J.-C.) et, par la suite, un village médiéval qui survécut jusqu'à son abandon définitif, survenu (il n'y a pas si longtemps) au début du XIXe siècle.
Des gloires passées et de la vie intense et industrieuse des anciens habitants, il ne reste aujourd'hui qu'un lieu agréable et inhabité, une campagne qui offre des vues à couper le souffle de tous les points de vue . Aucune trace visible des remparts de la ville, qui protégeaient autrefois la ville, rien des maisons et des magasins... Si vous prenez le sentier qui, de la route goudronnée derrière la montagne, mène à son sommet, vous atteignez bientôt l'entrée de la forêt : d'anciens chênes verts, des chênes, des châtaigniers offrent un abri frais au visiteur en été, qui ne peut qu'entrevoir ici et là quelques pierres résiduelles du passé ancien et glorieux, des pans de murs en blocs équarris, quelques grottes anciennes, une grande citerne, jusqu'à atteindre une structure rocheuse très particulière, située sur la face nord de la montagne, que les vicissitudes de l'histoire ont voulu nous laisser : un columbarium avec ses nombreuses niches creusées dans la roche et avec une fenêtre splendide et lumineuse sur le lac de Bolsena d'où vous pouvez voir, représentée comme dans un tableau d'artiste, l'île de Bisentina qui s'étend comme une déesse sur les eaux.
Le déclin de Bisenzio
Après une longue période ininterrompue de vie et de prospérité, la communauté visentine, probablement déjà en crise aux Ve et IVe siècles avant J.-C., se trouve inexorablement confrontée à la conquête romaine. Rappelons brièvement qu'après la chute de Véies (en 396 av. J.-C. aux mains du dictateur romain Mario Furio Camillo), puissant bastion qui imposa un siège de dix ans aux conquérants, et la conquête plus facile de Sutri, les Romains devinrent de plus en plus menaçants pour l'Étrurie centrale, jusqu'à ce que, en 310 av. J.-C., avec la traversée de la « redoutable » Selva Cimina, le sort des populations lacustres soit irrémédiablement scellé : destructions et pillages forcèrent les familles étrusques prospères et pacifiques à quitter les centres habités et à chercher refuge dans les bois. La destruction de Visentium se situe probablement sur le théâtre de la guerre de Vulci en 280 av. J.-C., lorsque les colonies étrusques de Civita (près de Grotte di Castro), Maternum et Verentum (dans la plaine de Valentano) furent également détruites en même temps. Plus tard, en 265 av. J.-C., la dernière place forte militaire étrusque, Volsinii -Orvieto, capitula également.
Dans les années entre 298 et 280 av. J.-C., le territoire de Bisenzio fut donc traversé par des guerres sanglantes, dues aux ambitions romaines de conquête des territoires d'Étrurie, et progressivement le prestige de la glorieuse cité lacustre s'affaiblit, jusqu'à la fondation en 90 av. J.-C. de la Commune de Visentium (nom connu par des inscriptions latines trouvées dans la région) qui résista jusqu'à la chute de l'Empire. Bien que la riche et peuplée cité étrusque qui dominait le grand lac n'existait plus, Visentium romaine était aussi un centre urbain important, florissant et doté de bonnes lignes défensives ; Les familles riches vivaient dans de grandes villas reliées par des chemins intérieurs, ainsi que par une route au bord du lac.
De la période romaine nous sont parvenus seulement des vestiges rares et dispersés, dont principalement des inscriptions épigraphiques , dont certaines portent le nom de Visentini (par exemple une inscription honorifique du Senatus Populusque Visentinus , dédié en 254 à l'empereur Valérien).
La nécropole
L'importance de la ville de Visentium se manifeste par sa nécropole, la plus grande parmi celles existant autour du lac de Bolsena : les nombreux noyaux funéraires, dispersés comme un anneau autour de la zone de l'établissement, s'étendent de la périphérie nord-ouest de l'actuelle Capodimonte jusqu'à la localité de San Magno (commune de Gradoli) ; c'est une grande bande de terre de 2 km de large et de 5,5 km de long. L’enterrement des cadavres n’était pas autorisé dans la ville ; pour cette raison les sépultures ne touchaient pas le sommet et les pentes de la majestueuse colline, où s'élevait en revanche la ville avec son arx (l'acropole) et, peut-être, avec ses temples (à la triade céleste Tinia, Uni et Menrva , respectivement Jupiter, Junon et Minerve). Très probablement, comme nous l'avons dit, il s'agissait d'un puissant mur qui séparait les maisons des nécropoles découvertes et explorées. Ce sont : Piana di San Bernardino, Bucacce, Porto Madonna, Polledrara, Olmo Bello, Piantata, Palazzetta, Poggio della Mina, Fontana del Castagno, Poggio Sambuco, Valle dello Spinetto, Valle Saccoccia, Grottes de Mereo, Poggio Falchetto , etc.
 |
Les types de tombes découvertes varient selon les périodes historiques et le statut social du défunt et les sépultures identifiées étaient également disposées en deux, voire trois couches :
Les tombes à crémation « puits » , de forme cylindrique (en moyenne 1 m de diamètre et 1,50 m de hauteur) ont été retrouvées à une profondeur de 3 à 5 mètres
 |
; Parfois, ils étaient recouverts de caisses en pierre pour protéger les trousseaux funéraires, ou ils contenaient un grand dolium, appelé « ziro », avec l'urne cinéraire et quelques objets personnels à l'intérieur. Les cendres du défunt étaient généralement placées à l'intérieur d'un vase biconique (recouvert d'une dalle de pierre ou d'un bol). Ils ont restitué les objets funéraires les plus simples et surtout les plus anciens ; en fait, le rite d'incinération caractérisait principalement la première phase villanovienne (fin du Xe-début du IXe siècle avant J.-C.). Certaines des plus anciennes urnes cinéraires ont une forme caractéristique de « cabane » avec une base ronde ou elliptique (plusieurs d’entre elles ont été retrouvées à San Bernardino) ; l'une de celles retrouvées présente une exubérance décorative notable avec l'insertion de figurines anthropomorphes sur le toit. Les similitudes entre ce type de coutume archaïque de Bisenzio et d'autres centres de l'Étrurie sont frappantes : des urnes cinéraires similaires en forme de cabane, par exemple, ont également été trouvées à Tarquinia, Vulci, Vetulonia, Saturnia, Populonia et sur les collines d'Alban.
Les tombes d'inhumation en forme de « fosse »,
 |
parfois avec une « boîte ou un coffre » en tuf ( certaines avec une boîte en bois supplémentaire ) mesurant environ 2 m x 90 cm, situées à une profondeur d'au moins 2 m, pourraient également avoir appartenu à des familles plutôt riches, comme on peut le déduire du mobilier funéraire retrouvé et, dans certains cas, de la présence d'un imposant tertre constitué d'une calotte de terre soutenue par un muret de blocs de tuf. Des groupes d'inhumations avec des sarcophages en pierre (VIe siècle avant J.-C.) délimités par des enceintes en pierre ont également été découverts, vraisemblablement dans le but de souligner le lien de parenté entre les défunts. Dans la nécropole d'Olmo Bello , en particulier, on a trouvé des sépultures féminines avec des couvercles à double pente et des sépultures masculines avec des couvercles incurvés, mais aussi certaines avec des couvercles à quatre pentes avec des sommets parfois pointus ou tronqués en forme de pyramide (ces dernières appartenant à des défunts de rang social élevé). Un détail intéressant observé dans les lourds couvercles en tuf est constitué par les évidements sur les bords, qui permettaient aux cordes utilisées pour les abaisser sur les caissons de glisser à travers. Certaines tombes à fosse carrée contenaient les cendres dans un ossuaire et étaient donc encore du type à crémation. Le rite d'inhumation a en effet commencé à se répandre dans le Villanovan évolué parallèlement à la crémation, qui a cependant persisté comme héritage d'un groupe social restreint encore lié à cette coutume, cette fois comme symbole du privilège aristocratique de l'élite. Le mobilier funéraire de ce nouveau type de tombe fait allusion au rite symbolique du banquet et met en évidence de nouvelles classes de matériaux qui dénotent une amélioration des conditions économiques et expriment un esprit novateur dans l'art de Bisentina (en particulier dans ceux du VIIIe-VIIe siècle avant J.-C.), un besoin de la part des artisans de l'époque pour des formes artistiques plus élaborées, dont certaines dénotent des contacts culturels avec les peuples du Levant méditerranéen. De très beaux buccheri, de riches objets ornementaux, des céramiques géométriques tardives d'imitation grecque, des objets en bronze et en or, dont beaucoup remontent à la phase dite "orientalisante" (fin du VIIIe-début du VIe siècle avant J.-C.), dénotent un grand savoir-faire artisanal , influencé par l'expansion des contacts de Bisenzio avec les centres de l'Étrurie côtière où circulaient des produits grecs originaux, en premier lieu avec Vulci et Tarquinia, dans les sphères d'influence desquelles il se plaça et dont le commerce favorisa la fusion de la culture étrusque avec l'esprit hellénique.
Moins nombreuses mais plus riches furent les tombes « à chambre » découvertes dans la falaise de tuf de Bisenzio (en particulier dans les zones
Le carello rituale de Bisenzio, a été trouvé dans une sépulture féminine (tombe 2) de très haut rang de la nécropole d'Olmo Bello, et il représente un exemple unique dans le monde des bronzes étrusque
Cet artefact avec son riche appareil figuratif est unique
Aussi les études ont été nombreuses sur cet objet
Il en ressort que plusieurs les chercheurs ont travaillé dur pour tenter de voir plus clair quand à l’origine et le but de cet objet
Il peut être placer au centre d’un ensemble de valeurs liées à l'idéo- d'une aristocratie naissante du Moyen Tyrrhénien au VIIIe siècle avant J.-C. Malheureusement, le les seules sources écrites disponibles dans ce sens sont basées sur une tradition historiographique qui ne remonte pas au-delà du IIIe siècle avant J.-C.
De plus ces études sztache le chariot de son contexte de découverte, omettant sa relation avec l'ensemble du mobilier funéraire
Il faut donc parvenir à saisir le motif d'un composition figurative si riche et complexe, plaçant la totalité des scènes dans le dimension du rituel.
. TOMBEAU 2 DE LA NÉCROPOLE Le carello
 |
Le chariot est constitué d'une série de barres métalliques qui forment le cadre de support du grand bassin avec un bord à rebord, qui était en fait prévu remplissent la fonction de contenant pour les huiles et les parfums que nous pouvons imaginer constituait une sorte de complément rituel à une cérémonie non spécifiée assis.
C'est sur cette structure que repose la série de figurines qui composent le l'ensemble narratif
 |
Les différentes scènes peuvent être classés en deux domaines distincts. Sur le périmètre quadrangulaire, ils trouvent placent les protagonistes du monde des hommes capturés pendant l'exécution d'activités normales comme le labour, la chasse, formation de couple où la figure féminine est plus grande que celle masculine
Dans la partie interne , une série de scènes sont représentées visant à représenter un monde peuplé principalement d'animaux domestiques et sauvages, à l'exception de pour la représentation d'un duel se déroulant sur une petite roue mobile placé presque au centre du chariot.
Pour couronner la composition, une série de douze des œillets avec des singes alternant avec des oiseaux pendent de la bande circulaire qui entoure le bassin.
(
|
|
|
Copyright © 2003-2025 MaquetLand.com [Le Monde de la Maquette] et AMM- Tous droits réservés - Contactez l'Administrateur en cliquant ici
Ce site sans aucun but lucratif n’a pour but que de vous faire aimer l’ Histoire
Droit d’auteur
La plupart des photographies publiées sur ce site sont la propriété exclusive de © Claude Balmefrezol
Elles peuvent être reproduites pour une utilisation personnelle, mais l’autorisation préalable de leur auteur est nécessaire pour être exploitées dans un autre cadre (site web publications etc)
Les sources des autres documents et illustrations sont mentionnées quand elles sont connues. Si une de ces pièces est protégée et que sa présence dans ces pages pose problème, elle sera retirée sur simple demande.
Principaux Collaborateurs:
Gimeno Claude (+)
Brams Jean Marie
Janier Charles
Vincent Burgat
Jean Pierre Heymes
|
Marie Christophe
Jouhaud Remi
Gris Patrice
Luc Druyer
|
Lopez Hubert
Giugliemi Daniele
Laurent Bouysse
|
Nb
de visiteurs:7910530
Nb
de visiteurs aujourd'hui:1594
Nb
de connectés:31
|
|
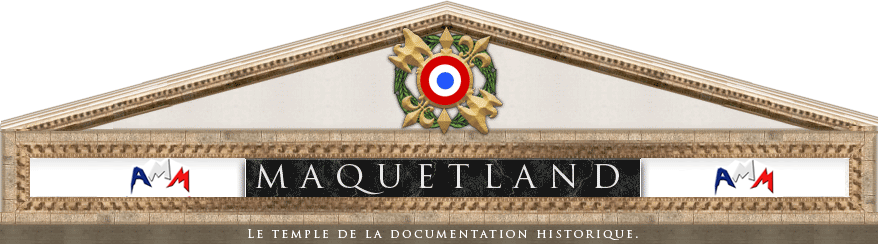
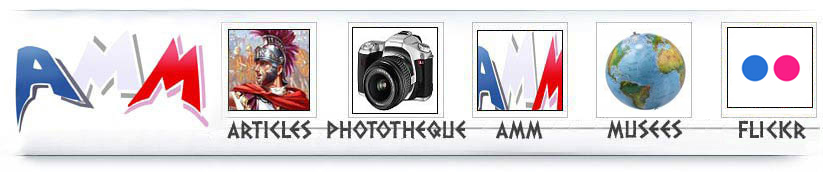




.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)






