Il était une fois un petit Navire
Loic Charpentier
2e Partie 3e Partie
 |
La marine à voile militaire atteindra son apogée durant la période à cheval sur le XVIIIème et XIXème siècle…disons entre 1750 et 1820. Cà, c’est l’opinion de Pépère . Vous trouverez sûrement des contestataires mais je vais, de ce pas, vous justifier mon propos. La propulsion à vapeur et la coque métallique sont des inventions récentes du XIXème siècle, qui ne connaissent un emploi courant qu’aux environs des années 1830…enfin, disons que ce ne sont plus des phénomènes de foire mais qu’on est encore très loin de la généralisation…surtout dans le domaine militaire où règne bon nombre d’amiraux cacochymes et quasiment séniles qui n’ont pas foutu un pied à bord depuis quinze ou vingt ans mais font la pluie et le beau temps dans les bureaux et commissions (Nota : Bien entendu, cette gérontocratie navale à totalement disparue de nos jours). Du coup, les seuls moyens de propulsion nautique sont la rame et la voile durant plusieurs dizaines de siècles.
 |
| (1) - Barque à rames – Grèce – 1500 avant JC Cette embarcation ressemble beaucoup aux barques égyptienne qui navigue sur Nil. |
Pour commencer, un poil d’histoire…
Au début, nos lointains ancêtres ne s’aventurent guère sur la flotte et si c’est vraiment nécessaire, se confectionnent un flotteur personnel avec une poignée de roseaux pour longer ou traverser la flaque d’eau auprès de laquelle ils vivent. Le flotteur se transforme en esquif en bois, en roseaux ou, comme en Mésopotamie, en terre cuite (si, si !) (Depuis lors, avantageusement remplacée par un pneu de camion ou d’engin de chantier !), en peaux tannées puis en pirogue à laquelle sont ajoutées des pagaies, premier moteur « humain » avéré. Tout çà, c’est bien gentil pour transporter quelques légumes ou même une momie dans un contexte lacustre ou fluvial mais çà limite un tantinet les possibilités.
Depuis les temps reculés, les trois zones principales du développement des navires de haute mer se situent en Méditerranée, en Europe du Nord et en Chine. Si vous le voulez bien, nous allons surtout nous intéresser au Nombril du Monde, notre Belle France ! En dehors de ses célèbres stations balnéaires, la mer Méditerranée est également le berceau de la navigation pour les civilisations installées sur ses rivages, Egyptiens, Phéniciens, Grecques, Carthaginois, Romains. Même si, parfois, les tempêtes déclenchées par le courroux de Neptune n’y sont pas piquées des hannetons, la Mare Nostrum est une mer intérieure relativement clémente, aux fluctuations de marée quasiment inexistantes, contrairement à l’Océan Atlantique. Les Egyptiens découvrent l’utilité de la rame sous la IVème dynastie (2600-2500 avant JC), plus performante grâce à son point d’appui (tolet ou sabord de rame). Le vent s’avère également très utile -quand il souffle dans le bon sens!- pour avancer sans trop se fatiguer. Du coup, les Egyptiens (one more time !) améliore un chouïa le primitif esquif en lui adjoignant un bout de bois vertical, le mât, un autre horizontal (voir deux, à l’égyptienne), la vergue, sur lequel vient se fixer une natte tressée à base de feuilles ou de roseaux fendus (les jonques chinoises utiliseront longtemps ce matériau) ou de peaux de bêtes tannées ou d’éléments tissés (Beautiful cotton of Egypt, Sir, look the quality !)…bref, une voile ! Bien que probablement plus ancienne, l’adoption de la voile, en se fondant sur de vieux bas-reliefs et des décors de poterie n’est avérée qu’aux environs de l’an 2200 avant JC, dans les eaux crétoises. Les troupes d’Agamemnon, pour aller se friter avec les Troyens, ont très probablement traversé la mer Egée sur des bâtiments à rames munis d’un mat et d’une voile d’appoint. Se dessinent, également à l’époque, deux formes de coque. La coque ronde ou ventrue et la coque longue. Au cours des siècles, on retrouvera cette distinction et les navires à coques rondes seront d’abord utilisés pour le transport des marchandises tandis que la coque longue sera plus particulièrement dédiée aux activités nécessitant une recherche de vitesse comme la guerre ou la piraterie, occupations fort prisées par l’espèce humaine.
 |
| (2) - Combat naval- Fresque de Pompéi Il faut se méfier car les artistes de l’époque avaient la fâcheuse tendance à ne pas représenter le mat avec la voilure, pourtant ces derniers existent bel et bien. |
La France & la Mer
Je vais encore me répéter mais notre bon royaume de France n’avait pas franchement une vocation maritime exacerbée ! Ceci dit, au Moyen-âge, il avait des excuses, car, au Sud-ouest et au Nord, les Goddons et les Flamands nous avaient piqué les côtes, la Duchesse Anne de Bretagne ne s’était pas encore vautrée dans un royal plumard français et les rivages méditerranéens n’étaient pas du ressort du Roi de France. Il n’y aurait pas eu l’estuaire de la Seine et un bout de côte normande, il ne lui restait que la navigation fluviale et le canotage sur le lac du Bois de Boulogne ! De surcroit, la noblesse française fièrement engoncée dans son armure et campée sur son destrier n’avait pas vraiment le pied marin. Tout cela n’est qu’affaire de gueux ! Du coup, la France sous-traitait ses activités maritimes à des spécialistes tels que les génois. Moralité : Si les Croisades firent la fortune des républiques génoises et vénitiennes, elles coûtèrent la peau des fesses aux Rois de France en location de vaisseaux, si bien que Philippe-Auguste, en 1202, jugea plus sage de ne pas participer à la Quatrième Croisade. Passons sur deux ou trois loupés pas franchement glorieux, comme la constitution d’une flotte de débarquement en Angleterre (déjà !), vers les 1215-1220, qui s’est achevée par une belle flambée de 1700 bâtiments à l’ancre, flambée organisée par nos habituels camarades de jeux anglo-flamands, ou encore les 14 000 morts de la flotte franco-provençale de 300 navires, constituée à la va-vite à Aigues-Mortes et envoyée se faire étriller à Saint-Sébastien par Roger de Doria, amiral de Sicile et d’Aragon.
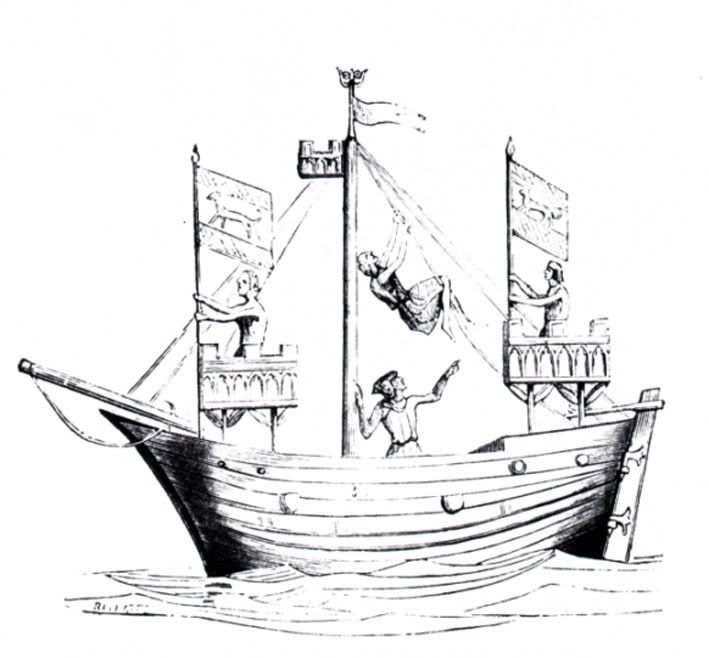 |
| (3) Sceau de la ville de Damme en Flandre – XIIIème siècle Les archives sur les navires sont quasiment inexistantes, hormis ce genre de sceaux. A noter les châteaux avant et arrière, séparés de la coque, véritables donjons pour archers ainsi que l’épaisseur du mât qui comporte généralement une grande hune militaire pour archers. Les trous dans la coque sont destinés à gréer des avirons de galère. |
Vers la fin du XIIIème siècle, Philippe Le Bel décide de s’équiper d’une flotte de guerre « permanente » et, pour ce faire, fait construire sur la rive gauche de la Seine, en face de Rouen, un arsenal baptisé « Le Clos des Galées », chargé de construire, d’entretenir, d’armer et d’avitailler une flotte de vaisseaux royaux. Les galères seront basées à Rouen, tandis que les autres vaisseaux stationneront à Harfleur. Cette structure fonctionnera 120/130 ans avant que, pour changer, les Anglois n’y foutent le feu, en 1419, durant la Guerre de Cent Ans qui en dura cent-trente, comme chacun sait. Si le fonctionnement de cette structure fut, question pépettes, une véritable danseuse pour un royaume au tiroir-caisse désespérément vide, elle eut l’avantage de rapprocher deux techniques de constructions navales différentes car, bien entendu, les architectes et le personnel chargé de la fabrication des galères étaient, eux, d’origine méditerranéenne.
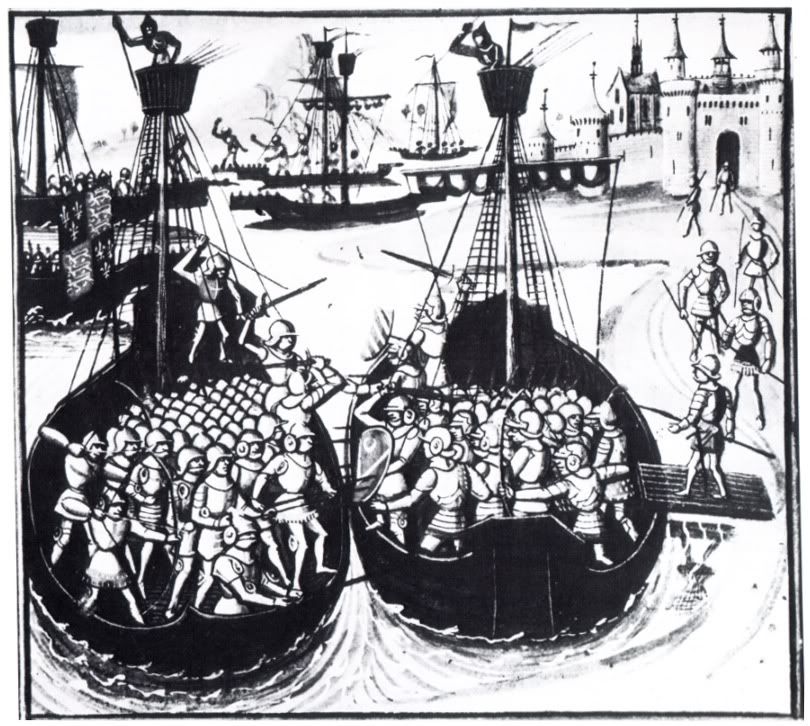 |
| (4) - Bataille de l’Ecluse – 1340 La flotte française s’était enchainée dans l’estuaire de la Zwyn, actuelle frontière belgo-néerlandaise. Les navires étaient si proches de la rive que les Flamands, alliés aux Anglais, prendront la flotte à revers par la terre ! Les dignitaires français du Royaume s’étaient abstenus de venir soutenir le moral de l’escadre. |
Passons rapidement sur la guerre de Cent Ans, conflit terrestre durant lequel le royaume, dirigé par des souverains souvent incompétents voir carrément fous, collectionnera les déculottées mémorables, les victoires insignifiantes et quelques désastres navals comme la bataille de l’Ecluse, avec une nouvelle couche de 15 000 trucidés. Réduite à sa portion congrue, la France ne doit, provisoirement, sa survie qu’à l’arrivée opportune d’une certaine Pucelle et, définitivement, quelques décennies plus tard, à la banqueroute de la trésorerie britiche, rincée par des décennies de dépenses militaires, et aux prémices d’une guerre fratricide de succession au trône d’Angleterre, la Guerre des Deux Roses, entre les Maisons d’York et de Lancastre.
 |
| (5) - Bataille de La Rochelle – 1371 Comme à l’Ecluse, on s’arrose de flèches et on se bat au corps à corps. Les bateaux ronds ne sont que des châteaux-forts flottants et l’artillerie navale est encore loin. |
Le XVème et le début du XVIème siècle ne révèlent toujours aucune attirance particulière de la France pour le domaine militaire naval qui continue à louer les services des Génois, tels que les Grimaldi (Comme un ouragan…tralala…zim…boum) et les Doria, dès qu’il s’agit de s’aventurer sur la Grande Bleue.
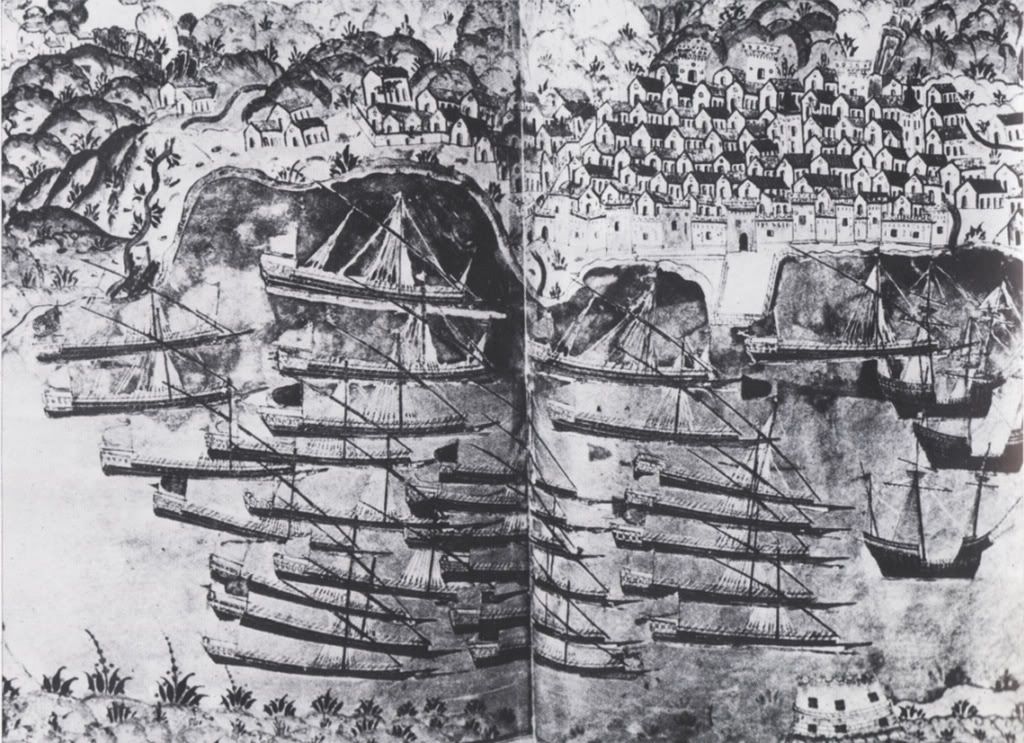 |
| (6) - Flotte turque de Barberousse en rade de Toulon – 1543 Après s’être assuré de l’appui des Turcs, François Ier déclare la guerre à l’Espagne à l’Espagne de Charles Quint, rassemble une malheureuse poignée de bateau français mais reçoit un renfort de 174 galères ottomanes qui passeront une année sur les côtes françaises à renvoyer les Espagnols et les Italiens à l’abri de leurs jetées. |
Pourtant, dans les années 1550, un arsenal est installé à Marseille et la flotte du Ponant aligne jusqu’à 35 à 40 galères. Mais ce n’est qu’un feu de paille qui ne résistera pas aux conflits religieux. A la fin du XVIème siècle, ceux-ci, en sus de vider allègrement les caisses de l’Etat, provoquent l’émigration d’une précieuse population de deux cent mille marins français vers des cieux plus cléments. Début XVIIème, le Cardinal de Richelieu met un peu d’ordre dans la pétaudière que constitue l’organisation de la hiérarchie navale française et prend lui-même le titre d’Amiral de France. Mais, force est de constater que les ports de l’Océan sont ruinés et les quelques unités existantes délabrées. On fera venir des architectes et des corps de spécialistes hollandais pour former la main d’œuvre française. Les trois arsenaux de l’Atlantique, le Havre, Brest et Brouage disposeront d’un personnel permanent. Le Cardinal prévoit également une flotte de 45 bâtiments au Ponant (Atlantique et Mer du Nord) et de 30 galères au Levant (Méditerranée). En attendant, il est obligé de louer une flotte de bâtiments aux Anglais et aux Hollandais pour régler le problème de La Rochelle !
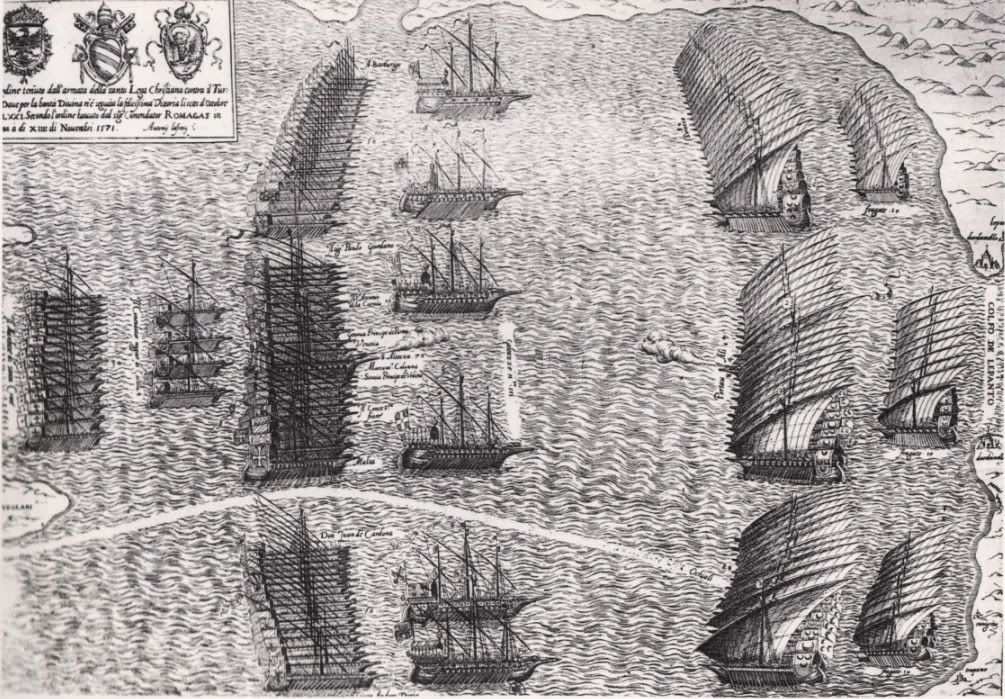 |
| (7) Bataille de Lépante – 1571 La France ne participe pas à cette bataille navale qui marquera la fin de la progression en Méditerranée de la flotte turque. La Sainte Ligue réunit l’Autriche, l’Espagne, la Papauté, Venise, Gènes, Malte et la Sicile. Les gros bâtiments, en tête de la flotte de la Ligue, à gauche, sont des galéasses, sorte de compromis entre la rame et le vaisseau à voile. |
Néanmoins, en 1635, au début de la guerre de Trente ans, la France dispose de 38 vaisseaux et 18 unités de moindre importance au Ponant et de 13 vaisseaux et 12 galères au Levant. On s’attaque même à produire quelques grosses unités, jaugeant 2000 tonneaux et armés de 72 canons, certes de véritables sabots instables et fort peu marins mais c’est toujours plus valorisant que les grosses barques de 200/300 tonneaux dont on devait se contenter jusqu’alors. Ceci dit, si la haute noblesse française condescend à accepter les charges de Chefs de l’Armée Navale du Roi ou de Lieutenants-Généraux, c’est juste pour faire joli sur la carte de visite car ce sont les capitaines et les pilotes qui s’attellent aux tâches maritimes. Il y eu quand même quelques faits d’armes à porter au crédit de la marine royale. Ainsi, Maillé-Brézé, général de galères à vingt ans, et accessoirement neveu de Richelieu, bat par trois fois la flotte espagnole avant de terminer sa carrière proprement embroché à l’âge de 27 ans. A la disparition du Cardinal, le 4 décembre 1642, la France disposait à Toulon de 65 vaisseaux et 22 galères.
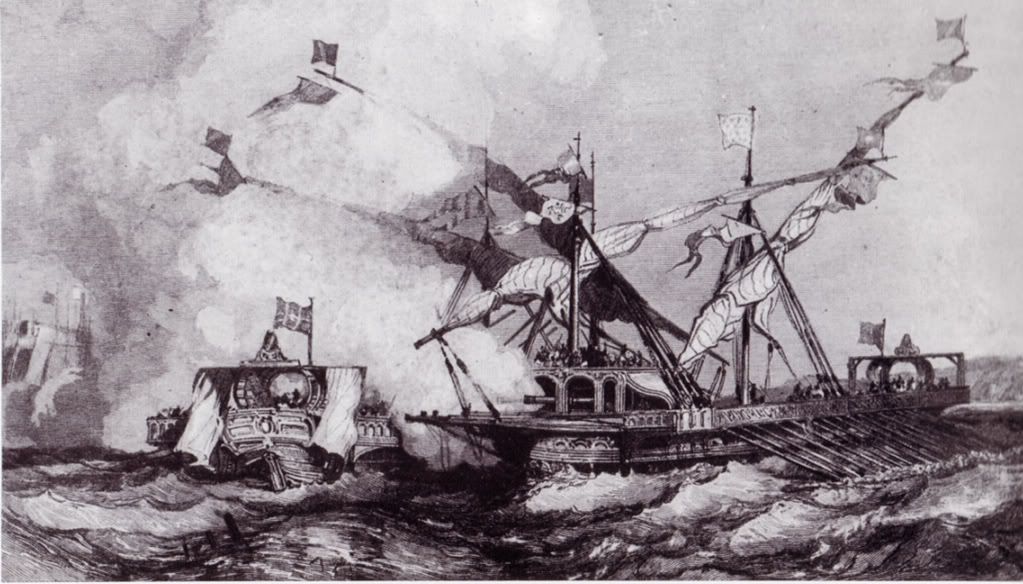 |
| (8) Combat de Vado (Gènes) – 1638 La dernière grande bataille navale entre galères. Les galères françaises affrontent 15 galères espagnoles. |
Un cardinal chasse l’autre mais Mazarin n’y connait que pouic à la marine et la flotte française héritée de Richelieu périclite rapidement, faute de doctrine coloniale pour les Antilles et le Canada et du désintérêt pour le commerce maritime en général. Exit l’italien !
En 1661, Louis XIV prend son avenir en main avec, dans les valises, un Contrôleur Général des Finances répondant au doux nom de Jean-Baptiste Colbert…Cà vous dit vaguement quelque chose ? Colbert n’est pas noble mais issu d’une famille bourgeoise. Il est vilain comme un pou, méchant comme une teigne, radin comme votre banquier et aussi franc qu’un âne qui recule mais se débrouille comme un chef avec son souverain un tantinet mégalo. Le temps de tester son pouvoir auprès du futur Roi-Soleil en s’occupant du cas Fouquet qui se la pétait grave et le voilà tenant les rênes de l’Etat. « L’Etat, c’est Moi ! » qu’il disait not’ bon Roy, c’était sûrement vrai sauf que notre peu sympathique JBC n’y était pas pour rien ! En gros, on peut résumer la période Louis XIV & Colbert par… « A toi, la lumière, le faste, la renommée, la légende, à moi, le taf et l’ombre…de toute façon, je ne suis pas photogénique ! »
 |
| (9) Portrait de JB Colbert Finalement il n’est pas si vilain que çà ! |
En attendant, en 1662, la marine royale est dans ses trente-sixièmes dessous ! Les magasins des arsenaux sont vides, il reste 20 vaisseaux, au mieux, les marins, pour gagner leur croute, se sont cassés à l’étranger et la chiourme (j’y reviendrai !) des galères regroupe à peine 800/900 hommes, tout juste de quoi à armer six galères, ce qui ne fait pas lerche ! Ce n’est pas mieux pour la marine de commerce qui aligne péniblement 800 bateaux, autant dire une misère ! Par comparaison, les Anglais ont lancé 70 vaisseaux entre 1649 et 1654, disposent de 4000 navires marchands tandis que les Pays-Bas alignent pas moins de 16 000 bâtiments au commerce !
Sous l’impulsion de Colbert, la marine de guerre française bénéficiera enfin d’un véritable statut qui perdurera, sous certains aspects, jusqu’après la Révolution. Le développement du commerce, à l’époque, avec l’existence des colonies, passe manifestement par les voies maritimes, suffit de voir les profits qu’en tirent nos voisins comme l’Angleterre, la Hollande ou l’Espagne. Pour faire fructifier une flotte marchande nationale, il faut la liberté des mers et donc des navires armés pour la garantir. C’est tout simple mais il aura fallu près de sept siècles pour que l’idée fasse son chemin dans notre beau royaume de France qui bénéficie quand même de deux façades maritimes des plus conséquentes !
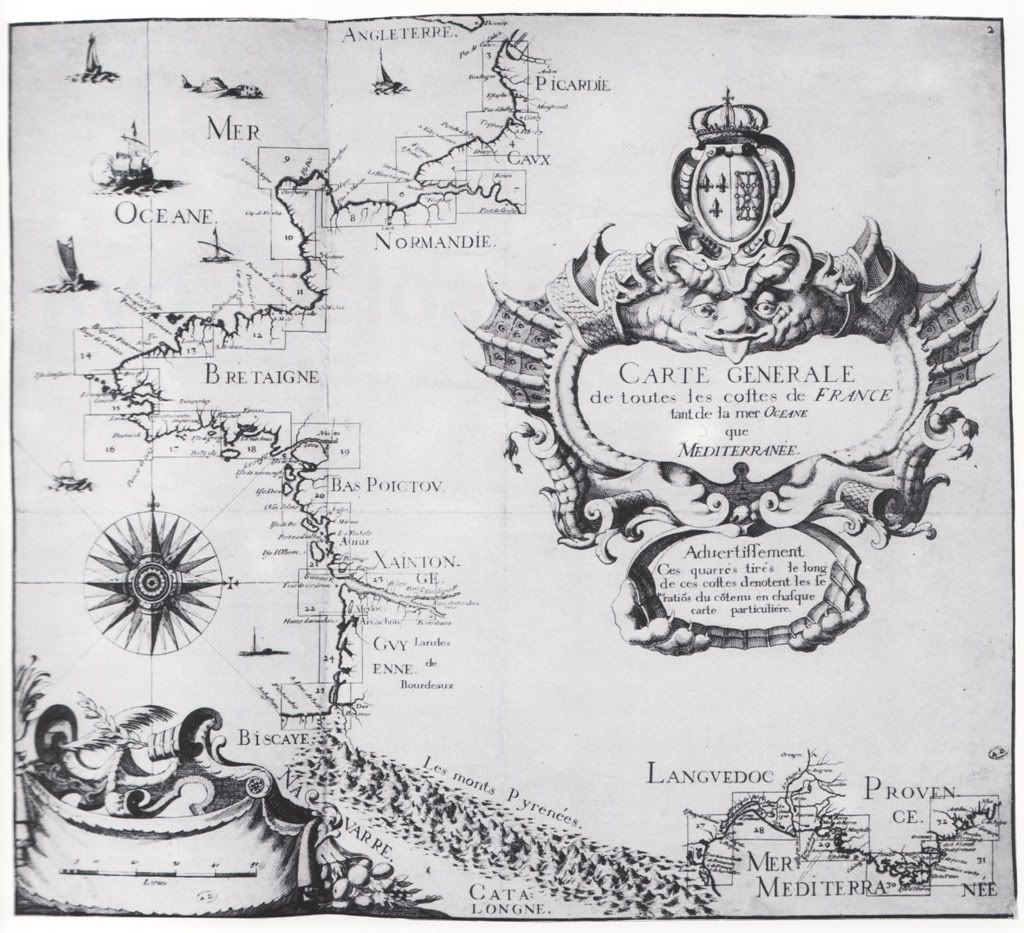 |
| (10) Carte des côtes de France au début du règne de Louis XIV. |
Résumons, nous sommes déjà dans la seconde moitié du XVIIème siècle, la France se décide enfin à s’équiper d’une marine militaire digne de ce nom qui, en raison de sa particularité géographique, se décline en deux flottes distingues, la flotte du Ponant ou océane à l’Ouest et celle du Levant ou méditerranéenne au Sud-Est. Nous allons d’abord nous intéresser à cette dernière.
(I) La flotte du Levant et les Galères du Roy, splendeur & puanteur
Va quand même falloir qu’on se dépêche de causer un tantinet de la galère car elle ne va pas tarder à disparaître du catalogue de la marine après avoir, l’air de rien, sillonnée les routes maritimes durant plus de vingt-trois siècles !
Déjà, on va rectifier une bourde classique…la galère est un terme, datant du XVIème siècle after JC, à usage exclusivement militaire !...Du coup, sur le plan archéologie marine, on a réussi, tout au mieux, à retrouver deux épaves de « galères » antiques…ce qui, vous l’avouerez, ne fait pas bézef.
Mais c’est totalement faux ! Tenez, pas plus tard que l’été dernier, mon beau-frère, Marcel, a plongé sur une superbe épave de galère grecque bourrée d’amphore, au large de Cassis !
...Bourrée de quoi ?...d’amphores ?...C’est bien tout le problème, mon pôv’ monsieur ! Une, ce n’est pas une galère mais une « barque longue », comme disaient les Anciens, ou une « galée », terme générique moyenâgeux qui se rapporte aussi bien aux navires marchands qu’aux navires militaires…Deux, c’est justement grâce aux amphores que transportaient ces navires marchands qu’il est encore possible de tomber sur ces antiques épaves, car, au cours des siècles, l’amoncellement de leurs cargaisons a protégé le bois de la carène coincé entre le sable des fonds et lesdites amphores. Comme sur les navires militaires, il n’y a pas de marchandise, vous avez tout compris !
Nota : Comme mon propos traite principalement de bâtiments du XVIIème siècle à usage militaire, çà tombe bien, je vais pouvoir utiliser le terme de galère.
Au XVIIème siècle, les flottes de galères, maltaises, ottomanes, vénitiennes et, dans une moindre mesure, espagnoles règnent sur la Méditerranée. Les grandes pages de l’histoire des galères ont déjà été écrites comme la célèbre bataille de Lépante, vieille de bientôt un siècle (1571), au cours de laquelle, à proximité des côtes occidentales grecques, les galères et galéasses de la Ligue austro-hispano-malto-vénitiennes (ouf !) ont affronté les galères ottomanes. Comme je viens de l’évoquer un peu plus haut, la France, bon an, mal an, y entretient une flotte qu’elle confie le plus souvent à des commandements génois et, hormis quelques faits d’armes plus ou moins célèbres (cf. le neveu du Cardinal), y joue quasiment les abonnés absents. Un problème qui n’a rien d’anodin, sévit en Méditerranée, la piraterie barbaresque. A l’époque, le terme barbaresque qualifie peu ou prou toutes les contrées et peuples sous la domination ottomane, l’actuel Maghreb avec notamment les ports d’Alger, de Tunis et de Tripoli, les côtes grecques ou dalmates (les Balkans). Depuis François Ier, rien que pour enquiquiner l’Autriche, le Royaume joue ami-ami avec l’Empire turc, ce qui ne l’empêche pas de se faire taxer régulièrement des cargaisons et de braves marins par les perfides Barbaresques, affichant leur totale indifférence quant aux bonnes relations entretenues par la maison-mère, Constantinople, avec la France. A la fin du XVIIème siècle, près de 8000 français sont en esclavage de l’autre côté de la Méditerranée. La flotte de galères du Levant aura donc pour tâche principale, en temps de paix, de sécuriser les voies maritimes, principalement côtières, d’escorter les convois marchands et de mener des missions de douane.
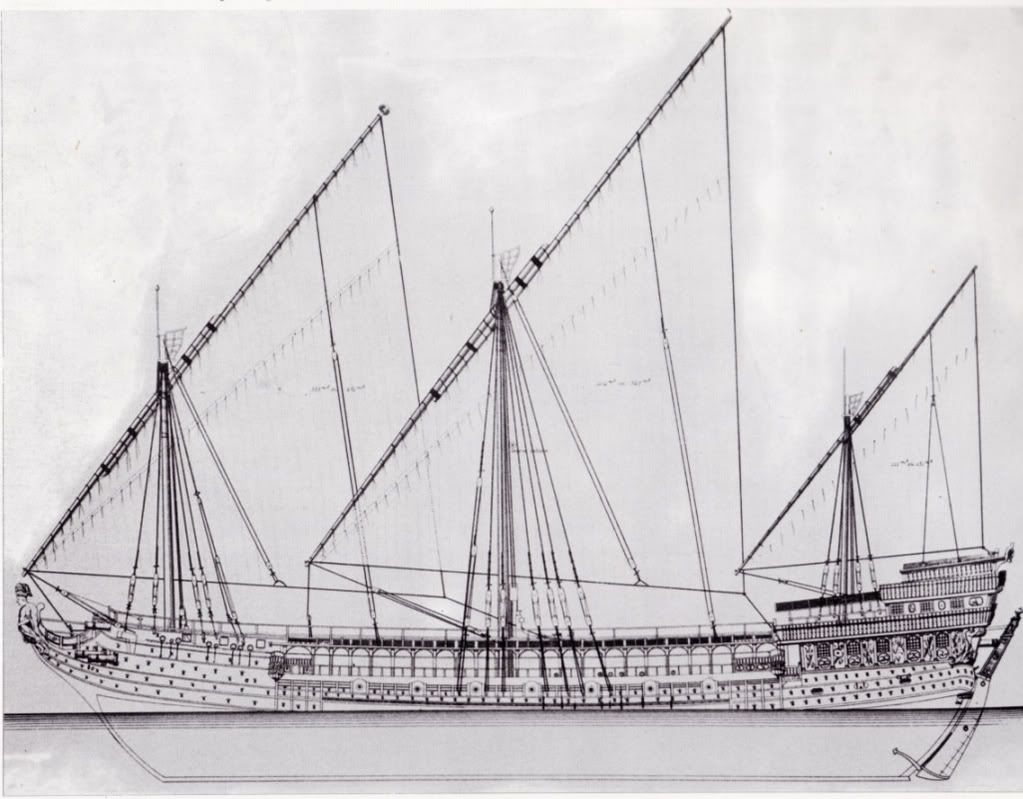 |
| (11) Croquis d’une galéasse Curieusement, cette galéasse, baptisée La Royale – on ne prête qu’aux riches- est attribuée à la flotte française du milieu du XVIIème siècle. Il semble néanmoins que la France n’ait jamais armé de galéasse. Ce croquis a au moins le mérite de représenter ce type de bâtiment hybride, associant l’artillerie de bordée des vaisseaux et la palamente des galères. Son armement aurait été de 50 canons et son équipage de 700 hommes dont 300 rameurs. |
Quand Colbert retrousse ses manches, en 1662, il reste six galères en train de pourrir sur les quais de Toulon car le port phocéen avait été abandonné depuis la Guerre de Trente ans (1618-1648). La flotte du Ponant est scindée en deux entités avec budgets, administrations, état-major et équipages distincts, Les vaisseaux sont regroupés à Toulon et Marseille voit son arsenal s’agrandir et revenir les galères. La flotte est « royalisée », toutes les galères et les emplois du corps (des Galères) sont dorénavant propriétés du Roi – jusqu’alors les galères étaient des armements privés loués par le pouvoir royal en temps de guerre-, les commandements sont attribués sur commission royale. Comme Colbert n’est pas radin ni Ministre des Finances pour rien, il constitue le corps des « officiers de plume », dénommés ainsi pour les distinguer des « officiers d’épées », qui sont chargés de la gestion des budgets et des payes. Dorénavant, l’Etat-major et les commandants de vaisseau ou de galère ne pourront plus taper dans la caisse pour satisfaire leurs besoins personnels. Dix ans plus tard, la France alignera 22 galères flambant neuves face à l’Espagnol durant la guerre de Hollande.
Mais, au fait, c’est quoi une galère, à l’époque du Roi-Soleil ?
La rame est fort intéressante en l’absence de vent et par mer calme, de plus, elle permet d’utiliser (en théorie) la ligne droite pour rejoindre un point défini. La Méditerranée, mer intérieure en zone tempérée « chaude », est coutumière des calmes plats en période estivale. Par contre, la vitesse reste limitée, sous peine d’endommager le « moteur », en l’occurrence, les rameurs. Cà aussi c’est un autre problème car plus le navire est important, plus il faut de rameurs et il ne reste plus beaucoup de place pour du fret ou des canons. De toute façon, le fait d’accumuler des rameurs n’améliore pas vraiment la vitesse de pointe. Autre problème, la propulsion à la rame implique un certains nombre de contraintes mécaniques, telle que la disposition de la nage par rapport à la surface de l’eau. Il n’est pas possible d’installer les rameurs à 5 ou 6 m de haut, l’angle de nage impliquerait des rames monstrueuses, totalement non manœuvrables…déjà, comme çà, vous allez voir, ce n’est pas de la tarte ! Du coup, sur une galère à plein lest, les rameurs sont installés, par temps calme, sur des bancs situés à 1,50/1.55m du niveau de la mer (voir croquis). Pour couronner le tout, à la période qui nous intéresse, les dalots d’évacuation d’eau sont disposés à 32 cm (le pied français de l’époque est plus grand que le pied britiche !) au-dessus de la ligne de flottaison. Passez la journée complète dans le pédiluve de votre piscine municipale, après y avoir préalablement balancé un kilo de gros sel, et vous aurez une vague idée de l’ambiance où baignaient les rameurs ! Cette conception particulière des galères implique des restrictions d’emploi en fonction des conditions climatiques. A l’instar de nos saisons touristiques actuelles sur la Côte d’Azur, les flottes de galères sont à la mer de Mai à Septembre et, sauf nécessité impérieuse, restent au mouillage l’autre partie de l’année. Seules les galères de Malte naviguent toute l’année.
Par tacite convention, on distingue deux types de galères occidentales, les galères extraordinaires et les galères ordinaires.
Les Galères extraordinaires sont des bâtiments de commandement et de prestige. Au XVIIème siècle, il en existe trois modèles. Ce sont des modèles uniques ou en nombre très limité durant leur temps d’activité.
La Réale est théoriquement la galère sur laquelle embarque un souverain royal, généralement représenté par son Général des Galères. Ni Louis XIV ni Louis XV ne poseront le moindre doigt de pied sur le pont de leur Réale. Plusieurs Réales se sont succédées dans la flotte du Levant mais, durant une période donnée, il n’en existe qu’une en activité. Elle est manœuvrée par une chiourme répartie par équipe de 7 rameurs sur 30 à 32 bancs de nage de chaque bord. Le nombre de bancs est défini selon la volonté du roi. Comme c’est avant tout un navire de prestige destiné à mettre en évidence la puissance du royaume, çà ne mégotait pas sur la longueur du bâtiment (environ 55m) et sur sa décoration.
La Capitane est l’équivalent de la Réale pour les états non royaux tels que Venise, Florence, Gènes ou Malte. A contrario, les royaumes comme la France n’ont pas de Capitane. Selon la nationalité, les dimensions et le nombre de bancs de nage de 28 à 31 sont sensiblement similaires à la Réale ou à la Patrone de France.
La Patrone, galère du Lieutenant-Général, numéro deux de la hiérarchie de l’Etat-major des Galères, et des officiers-généraux, chefs d’escadre. La vogue est également répartie sur 28 à 32 bancs, toujours selon décision royale, mais il n’y a que six rameurs par rame.
Les galères ordinaires constituent la force navale. Elles sont réparties en escadre de cinq à six unités, sous l’autorité d’un chef d’escadre. La différence principale avec les galères extraordinaires réside dans le nombre de bancs de rame. La galère ordinaire comporte 26 bancs de 5 rameurs par bord.
A la fin du XVIIème, les galères ordinaires françaises mesurent 46 m de long dont un éperon de 6m, à l’avant, pour une largeur de l’ordre de 6 mètres, et un faible tirant d’eau de 2m. A l’époque, l’architecture navale définit la longueur d’un navire de guerre en additionnant un écartement défini entre chaque sabord ou, dans le cas de galère, chaque banc de rame puis ajoute au résultat obtenu des longueurs prédéterminées correspondant à la proue et à la poupe du bâtiment. La hauteur des mats et la largeur du bâtiment sont en rapport de la longueur. Pour les galères, le rapport largeur/longueur est 1 :8. Une galère ordinaire pèse 300 tonnes et sa largeur hors tout est de 25 m, rames incluses.
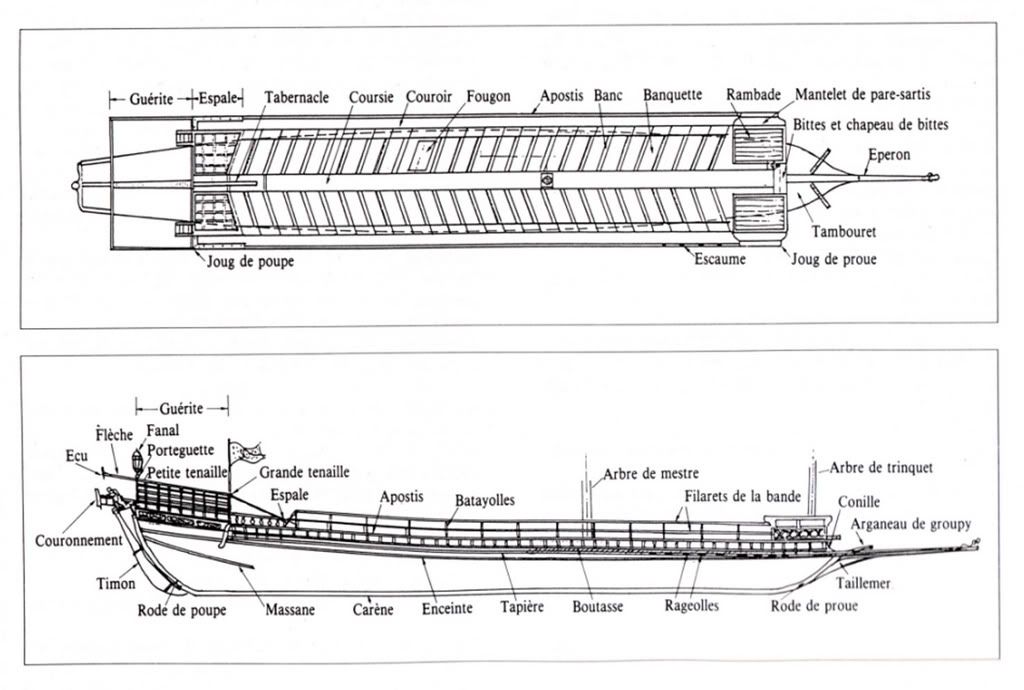 |
| (12) détails d’une galère ordinaire |
On ne peut décrire les galères royales sans évoquer leur décoration. Noblesse oblige, la Réale de France est la plus somptueuse de toutes. Sans atteindre le luxe invraisemblable de sa pendante ottomane où le plancher du carrosse (château de poupe) est recouvert d’une plaque d’argent d’un seul tenant, les semelles des officiers et du général des Galères (quand il est à bord, autant dire rarement) foulent de somptueux tapis. Le brocart et le velours enrichis de broderies d’or et chargés de fleur de lys garnissent les bordées de poupe. Le tendelet du carrosse est couvert d’une tente à rayures blanches et bleues ou rouges et bleues suivant un rituel très précis. La tente de quarante mètres qui abrite la chiourme aux escales est, elle aussi ornée de fleurs de lis. L’étendard du Royaume est de couleur blanche fleurdelisée (Le « drap de lit » dont se moquent les Anglais) mais les galères arborent un pavillon rouge spécifique. Seul, le Général des galères, en sus de sa marque personnelle au grand mât (mestre), dispose d’un pavillon particulier blanc rehaussés de lis d’or et des colliers de l’Ordre. Les pavillons et étendards sont de dimensions impressionnantes et pourraient servir de voilure à de petits bâtiments. Bien entendu, proue et poupes sont recouvertes de sculptures dorées à l’or fin, et dégoulinent de cariatides, tritons et autres Neptunes. Sur la Réale, la coque est rehaussée de fleur de lis. Vous rajoutez les uniformes chamarrés, les perruques poudrées et vous avez une vague idée du luxe ostentatoire de ces navires. A l’occasion de certaines cérémonies ou festivités, même la chiourme endosse un uniforme en velours et damas de couleur rouge. Sur la Réale d’Espagne, les six premiers rangs de la chiourme sont munis d’anneaux et de chaines en argent ! La construction d’une Réale, aux alentours de 1675 coûtait 110 000 livres et le budget décoration s’élevait à 170 000 livres ! Cette débauche de richesses n’est pas là que pour faire joli mais est surtout étudiée pour proclamer la puissance du souverain et de son royaume et refroidir les velléités agressives de voisins turbulents. En Méditerranée, les galères sont d’abord la vitrine ambulante du Roi et, si nécessaire, une arme de guerre.
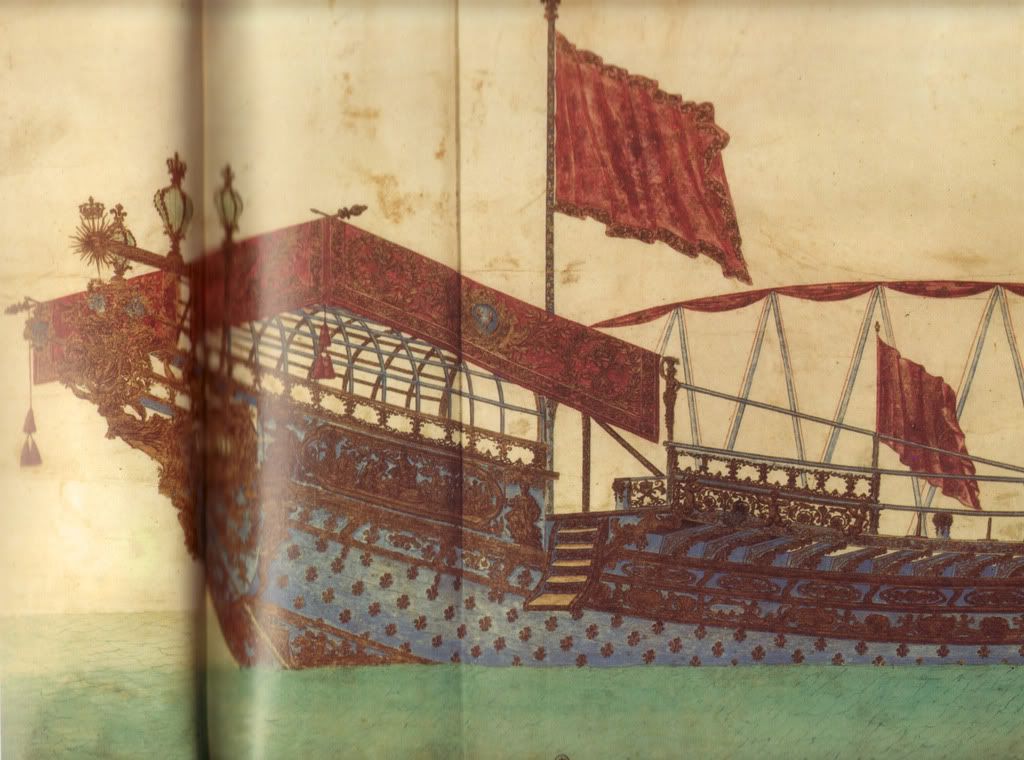 |
| (13) Décoration de poupe d’une Réale |
 |
| (14) Fête des Galères à Marseille. Comparez la décoration avec celle de la Réale à l’armement (image 17) |
La Chiourme
C’est la dénomination de l’équipe de rameurs d’une galère. A l’apogée du corps des galères, durant le règne de Louis XIV, dans les années 1690-1700, l’armement de quarante galères nécessite 12 000 rameurs. Ils restent bien encore quelques « bénévoles », généralement de pauvres hères qui s’engagent comme rameurs volontaires payés mais ce ne sont que des cas particuliers. En réalité, depuis le XVème siècle, la principale main-d’œuvre provient des esclaves et des condamnés. Officiellement, hormis dans nos colonies, il n’y a pas d’esclaves sur le territoire métropolitain mais une pirouette sémantique permet d’en exclure les esclaves acquis sur les marchés méditerranéens comme Venise, Livourne, Majorque ou Malte. Comme cette « main d’œuvre » est achetée hors du royaume en tant qu’esclave « estranger », elle reste esclave en abordant les côtes de France…c’est simple, non ?...Cette population est pudiquement dénommée « les Turcs » mais, en réalité, d’origine très diverse comme des Albanais, des Dalmates, des Grecques ou même des populations russes des rivages de la Mer Noire, vendues par les Tartares aux Turcs On effectue une tentative avec des esclaves africains, originaires de Guinée, mais ils ont la fâcheuse tendance à décéder rapidement de pneumonie. Les survivants sont envoyés couper de la canne à sucre aux Antilles. Les esclaves constituent, suivant les époques, entre 20 et 25% de la chiourme.
Le gros de la chiourme est fourni par les tribunaux et les conseils de guerre, vivement incités à prononcer de nombreuses condamnations aux galères (10 ans minimum !). Cà coute moins cher que l’achat de lots d’esclaves et çà a l’avantage de débarrasser la société d’un bon nombre de perturbateurs, filous et petits voyous. Néanmoins, les bandits de grands chemins et les criminels étant envoyés à la roue ou à la potence, la population pénitentiaire des galères est surtout constitués de vagabonds indésirables, d’auteurs de petits larcins, de sodomites ou réputés tels, de nombreux déserteurs et de trafiquants de sel à la petite semaine (les faux-saulniers) – la grande gabelle ou impôt sur le sel varie, souvent d’une manière très importante d’une région à l’autre, incitant les populations limitrophes à améliorer leur maigre quotidien en traficotant quelques livres de sel occasionnellement. A partir des années 1680, nombre de protestants refusant de rentrer dans le giron de l’église apostolique et romaine seront condamnés aux galères. On y trouve donc une population de condamnés à des peines plus ou moins longues, quand elles ne sont pas définitives, qui se distinguent par les « parements » de l’habit de galérien.
De nombreux écrits on détaillés de long en large les misères endurées par la chiourme. Si leur vie à bord est loin d’être pavée de pétales de rose, il faut néanmoins tempérer cette approche misérabiliste. La vie des marins « libres » des vaisseaux n’est guère plus réjouissante. Ils reçoivent presque autant de coups de bouts (corde pour les Terriens) que les galériens, les punitions sont extrêmement sévères voir mortelles et les conditions de vie à bord tout aussi déplorables, un matelot avec toutes ses dents est une exception. Même le petit peuple des villes et la paysannerie ne sont guère mieux lotis, à l’époque. Bien sur, passer dix ans de sa vie à ramer, dans le meilleur des cas, enchainé dans un espace confiné humide et malodorant, n’est pas vraiment une sinécure mais bon nombre de galériens condamnés à terme y survivront. En plus, les batailles navales entre galères étant passées de mode, ils avaient plus de chance de ne pas mourir coupés en deux par un boulet ou transpercés par des éclats de bois
 |
| (15) Dessins de tenues tardives de galériens – 1848 |
Avec cinq rameurs par rame et une palamente (ensemble des rames) de 51 rames (sur les galères ordinaires, à bâbord, la dixième rame à partir de la poupe est supprimée pour laisser place au fourneau de cuisine), la chiourme est constituée de 255 hommes (448 rameurs sur la Réale) auxquels il convient de rajouter une demi-douzaine d’officiers, les pilotes, comite, sous-comites, remolat, timoniers, équipage et enfin, un contingent de 100 soldats. Ce qui fait une population de 455 individus coincés sur moins de 300 m2 ! Je n’ose même pas évoqué la Réale où, sur une surface à peine plus grande, peuvent se côtoyer 670 hommes ! Un mot résume bien l’ambiance de vie à bord des galères royales, le grouillement ! Il y a bien un sous-pont pour le stockage des vivres et du matériel, mais, hormis son carrosse -le château arrière des galères- réservé à l’Etat-major et la rambade qui domine la batterie d’artillerie à l’avant, le franc-bord d’une galère à pleine charge culmine à moins de deux mètres au-dessus des flots par temps calme.
 |
| (16) Galère ordinaire à la vogue Ce dessin restitue bien la foule, il n’y a pas d’autre terme, qui encombre le pont d’une galère. |
Une galère embarque environ un mois et demi de vivres et 25 000 litres d’eau douce, quantité à peine suffisante pour une période d’une semaine de mer sans escale d’aiguade (ravitaillement en eau). La ration quotidienne d’eau par rameur est de sept litre.
 |
| (17) Réale à l’armement dans le port de Marseille La galère extraordinaire s’apprête à prendre la mer et ses luxueuses décorations sont réduites au stricte nécessaire. Le remolat, responsable de la palamente, vérifie l’état des rames. A quai, les galères sont amarrées par la poupe. |
La vogue.
Ce terme désigne la technique de manœuvre des rames. Au XVIIème siècle, la plupart des flottes de galères méditerranéennes ont adopté la vogue à la scaloccio ou à la galoche (de l’espagnol galocha). Cette technique consiste à faire manœuvrer une rame par une équipe de plusieurs rameurs. Elle est plus simple (tout est relatif !) à mettre en œuvre avec une chiourme non professionnelle et constituée de détenus.
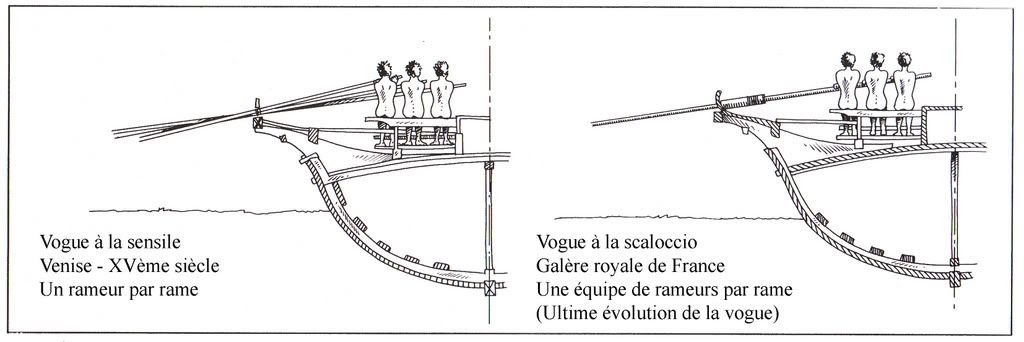 |
| (18) Evolution des vogues |
Les équipes de rameurs sont de cinq, six ou sept hommes par rame selon que la galère est ordinaire ou extraordinaire. La rame mesure 12m, dont environ trois mètres à l’intérieur du navire, et pèse 120 kg dans une galère ordinaire contre 14,50 m et plus de 160 kg dans une Réale. Elle est équilibrée par un lest en plomb fixé dans sa partie « intérieure ». Le diamètre de la section manœuvrée par la chiourme est de 50 cm ce qui nécessite la mise en place de poignées de manœuvre (manilles) pour les rameurs, sauf pour le vogue-avant qui se tient à l’extrémité de la rame.
Vu du dessus, le pont d’une galère ressemble à un squelette de poisson dont les arêtes, constituées par les bancs de nage seraient inversées. La palamente tourne le dos à l’avant du bateau.
Avant leur intégration à la chiourme, les galériens sont envoyés quelques semaines dans une école de nage où on leur inculque les rudiments de la manœuvre de la rame. C’est le comite, l’équivalent du maitre d’équipage des vaisseaux, qui a la responsabilité d’organiser la chiourme. Ce n’est pas tâche aisée car il lui faut équilibrer les équipes de galériens pour chaque rame et chaque bord. Sur la même rame, la disposition des rameurs s’effectue en fonction de leur expérience et de leur force physique. Les moins performants se retrouvent au plus près du bord, position où ils sont littéralement recroquevillés, jusqu’au vogue-avant, le chef de rame, le seul à manier la rame par son extrémité. C’est également le seul, même s’il porte anneau au pied, à ne pas être enchainé au banc de nage, sauf en cas de combat.
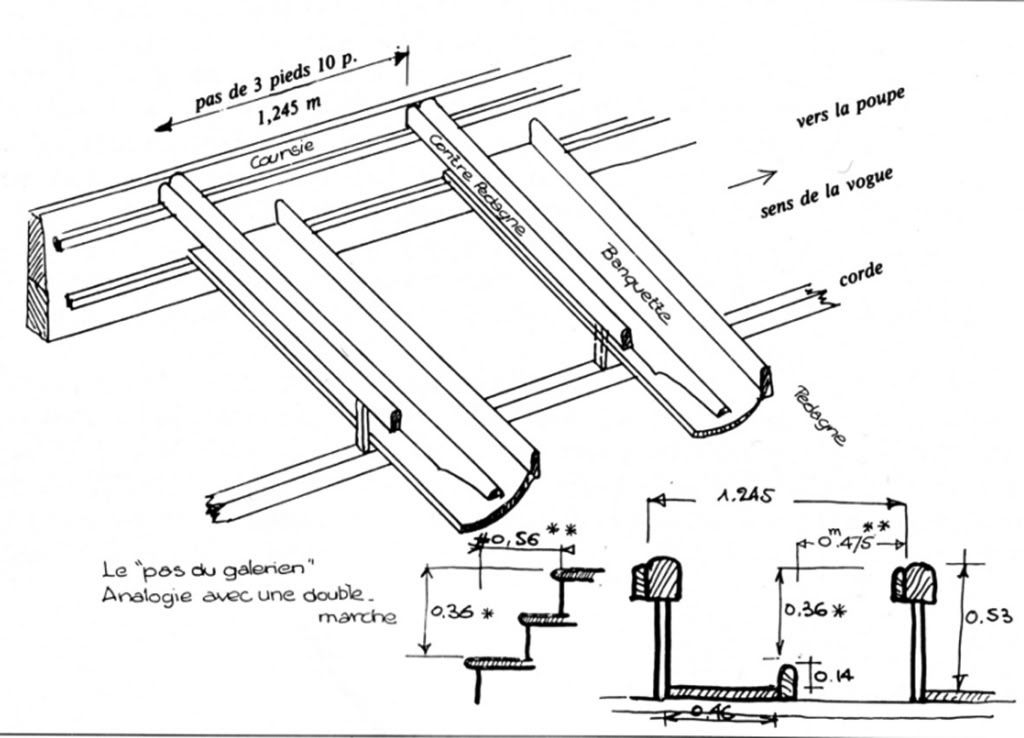 |
| (19a) – Banc de galère |
Contrairement à votre dernière promenade en barque sur le Lac du Bois de Boulogne, la vogue n’utilise pas ses bras pour ramer mais ses jambes. D’abord, ils seraient bien enquiquinés pour utiliser leur bras car ils sont serrés comme des sardines en boite et il leur faudrait à peu près quatre-vingt centimètres pour les écarter or ils ne disposent que de 45 cm. Les galériens rament donc bras tendus et, physiquement, ressemblent plus à une bouteille de Perrier qu’à Schwarzenegger dans « Connard le Barbant », avec leurs poitrines étriquées et leurs cuisses de coureurs cyclistes professionnels. La manœuvre consiste à monter les « marches d’escalier » constituées par la pédagne, la contre-pédagne fixée sur le banc précédent, voir ce banc lui-même durant la vogue extrême, la passe-vogue, ordonnée en cas de d’attaque ou…de fuite (cf. dessin ci-dessous), à se laisser « tomber » vers l’arrière puis à recommencer. Les bras, toujours tendus, n’appliquent qu’un mouvement vertical, de l’ordre de 20 à 30 cm, pour plonger ou sortir la rame de l’eau.
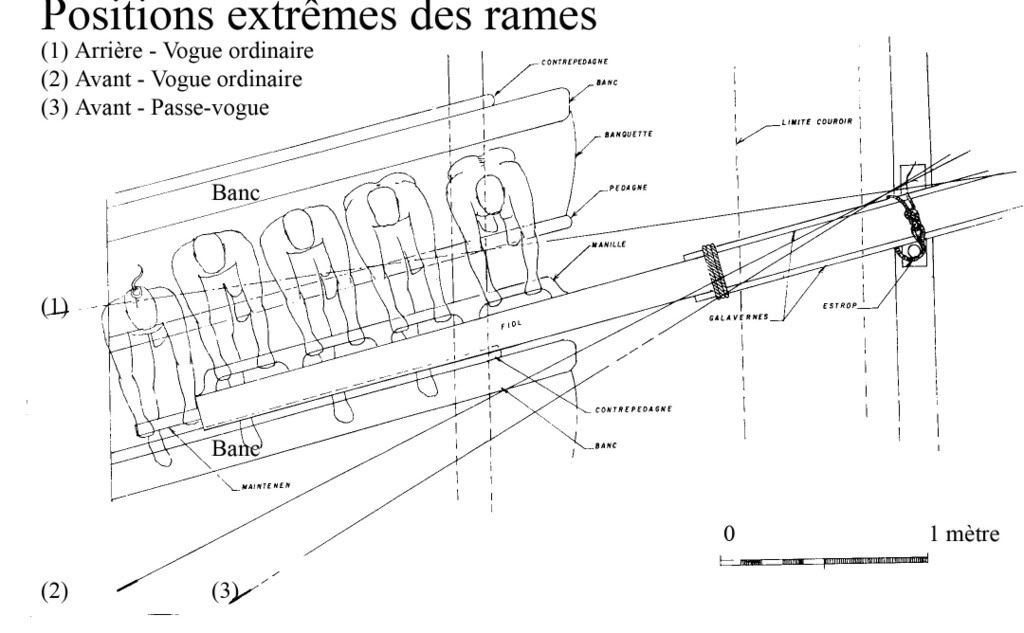 |
| (19b) Poste de travail à 5 rameurs d'une galère ordinaire |
Les cadences de nage vont de 20 à 28 coups de rame par minute mais à cette dernière cadence, au bout d’un quart d’heure, la chiourme est rincée. C’est le comice qui donne la cadence au sifflet – il vaut mieux oublier les images hollywoodiennes d’un gros noir musclé tapant comme un sourd sur des tambours. Pour économiser la chiourme, la vogue nage par quartier. Le quartier de proue, constitué des douze bancs avant, sur une galère ordinaire, rame durant une heure ou une heure et demi – deux ou trois ampoulettes (sabliers) d’une demi-heure, tandis que le quartier de poupe, les quatorze bancs de l’arrière, se reposent et mangent. Puis le quartier de poupe prend la relève. L’air de rien, la vogue par quartier, par temps favorable, permet de tenir une vitesse de l’ordre de quatre nœuds (un peu plus de 7 km/h) durant une dizaine d’heures. La vogue tout avant durant laquelle l’ensemble de la chiourme rame offre une vitesse qui dépasse rarement 5 nœuds (8 km/h). A la vogue, une galère est incapable de manœuvrer avec un vent contraire de 10 nœuds (18 km/h), ce qui n’est pourtant pas grand-chose, et s’empresse de chercher abri dans une crique en attendant que çà se tasse.
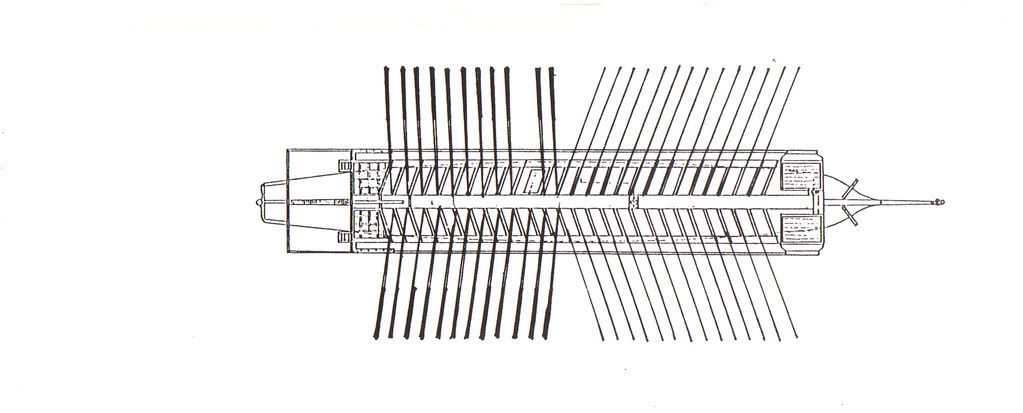 |
| (20) Vogue par quartier Le quartier de poupe rame et le quartier de proue se repose. |
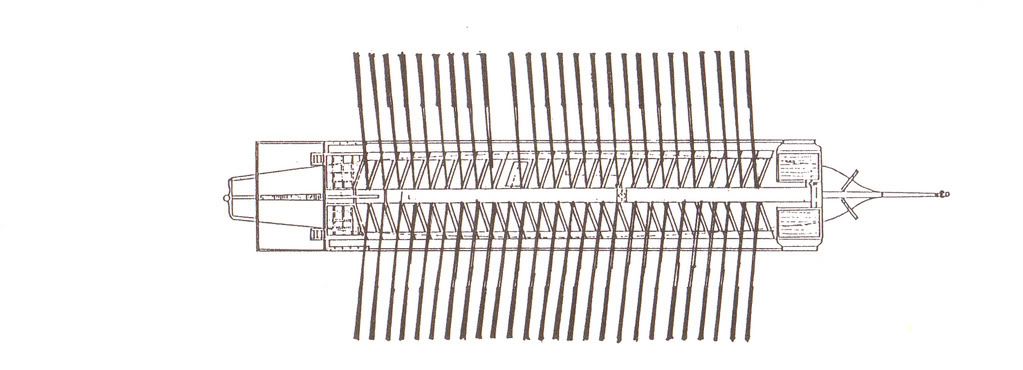 |
| (21) Vogue tout avant Les deux quartiers rament. |
La voile
En réalité, durant une croisière, dont la moitié de la durée est déjà consacré aux escales, la vogue n’est pratiquée que 30% du temps. Le reste de la navigation s’effectue sous voiles seules (50%) ou à la vogue sous voiles (20%), durant laquelle la chiourme se contente de donner, par quartier, des coups de pelle pour compenser la dérive de la galère.
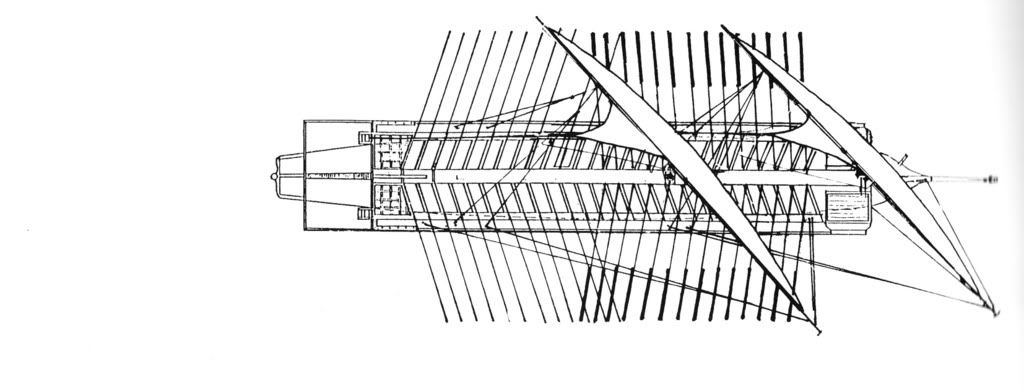 |
| (22) Vogue sous voile La vogue assiste la voile si le vent faiblit. Sur le croquis, c'est la vogue de proue qui est de service. |
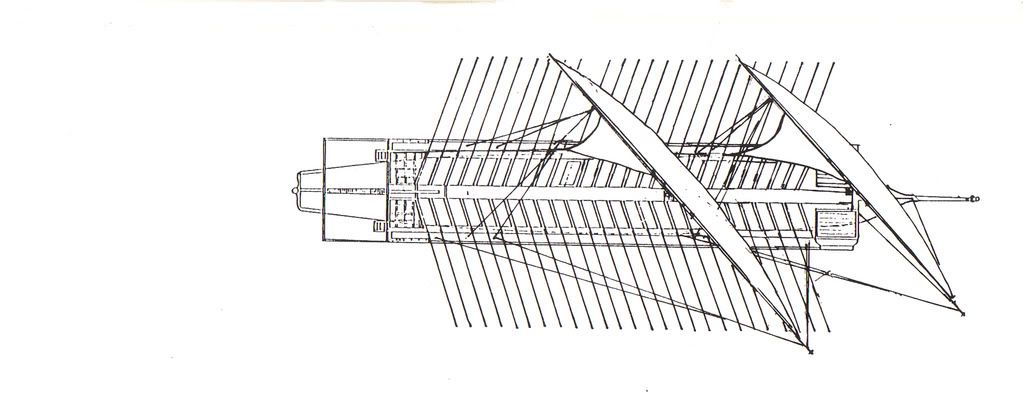 |
| (23) Galère sous voile Toutes les rames sont relevées. |
Le problème avec une galère sous voiles, c’est sa voilure latine (qui n’a rien de latine, vu qu’elle est probablement d’origine grecque mais ce n’est pas grave !). Sur une galère ordinaire, les deux voiles déployées représente 900m² de voilure et 1200m² sur une Réale ou une Capitane !...Heureux propriétaires de pavillons, observez le terrain qui vous a quasiment ruiné, plus celui de votre infâme voisin et vous aurez une vague idée de la surface que çà représente sur un truc qui fait 6 mètres de large ! La conception du gréement latin nécessite de placer l’antenne – c’est la vergue interminable, plus de 30m de long sur une Réale ou une Patrone, qui soutient la voile – à l’opposé de la direction où la brise souffle. Le responsable de la voilure n’a pas intérêt, le matin, à se tromper de côté car, comme il n’y a ni cabestan, ni guindeau sur les galères, la manœuvre de changement d’amure nécessite une bonne centaine d’hommes par antenne, l’antenne avec sa voile pèse 2 tonnes, et met la galère dans une position très délicate…Alors quand qu’il s’agit de changer d’amure les deux voiles, çà tourne au cauchemar. Pour éviter ce genre de corvée, on se contente souvent de déployer le trinquet, quand ce n’est pas le petit trinquet, une voile de dimension modeste, gréée sur le mat avant (trinquet).
 |
| (24) Galère ordinaire & vaisseau hollandais. Le trinquet de la galère est gréé mais vu le calme plat ambiant, son utilité est purement artistique. |
 |
| (25) Vaisseau hollandais. Comparez la différence de conception entre la galère au ras des flots et le vaisseau haut sur l’eau. L’artiste a bien mis en valeur ces différences de structures. |
Une galère sous voiles est loin d’être ridicule puisqu’elle peut atteindre, semble-t-il, une vitesse de 12 nœuds (un peu plus de 21 km/h), ce qui est légèrement inférieur aux 15 nœuds, dans de bonnes conditions, atteints par les nouvelles frégates apparues au XVIIIème siècle. Il ne faut pas oublier que ces performances ne sont réalisables qu’avec des bâtiments à l’état neuf car une coque couvertes d’algues transforme vite le bolide en bigorneau cacochyme. On en causera dans le chapitre consacré aux vaisseaux.
Par vent arrière, la construction de son gréement latin lui permet d’exploiter toute sa voilure disposée en « oreilles de lapins ». Petite réserve, cette allure amène la galère à enfourner de l’avant mais, par mer faiblement formée, çà ne va pas chercher loin et nécessite juste une bonne surveillance. L’allure idéale, comme pour les vaisseaux, est un vent de trois-quarts arrière. Cependant, comme le pont des galères est quasiment au ras de l’eau, le bâtiment a tendance à fortement s’incliner sous l’effort consenti par sa voilure. Pour compenser l’inclinaison, la chiourme sous vent, du bord opposé au sens du vent, se serre le plus possible vers le centre du navire pour faire contrepoids et ses rames (3 tonnes de part et d’autre) sont également partiellement rentrées. En bref, pour ceux qui ont navigué, on se retrouve avec un dériveur moderne et son équipage au rappel. J’ai longuement cherché une gravure d’époque illustrant mes propos mais c’est le désert complet. Il faut dire que pour pouvoir la croquer, l’artiste se doit d’embarquer, car cette allure se pratique rarement près de la jetée d’un port, et là, évidemment, si on n’a pas trop le pied marin et de surcroit les narines sensibles, vaut mieux éviter ce genre d’aventure.
L’armement.
C’est ce qui provoquera la mise au rencart des galères royales, au milieu du XVIIIème siècle. Il y a bien eu des tentatives au XVIème et XVIIème siècle pour installer un pont au-dessus des rameurs et y disposer des canons comme sur les vaisseaux, ce sont les galéasses. La France n’en a jamais produit et elles tenaient plus de la grosse barge armée qu’il fallait remorquer que du coursier des mers.
Hormis l’armement individuel de la troupe, mousquets, grenades, hallebardes, piques, haches, épées et sabres, une galère n’embarque que cinq pièces d’artillerie, dignes de ce nom, et une série de pierriers ou d’espingoles – canons miniatures généralement d’une livre de calibre- qui tirent de petits boulets ou des boites à balles pour le combat rapproché. Les canons de bronze sont installés dans la rambade, à l’avant de la galère, et ne tirent que dans l’axe du
(II) Les serviteurs d’Eole, vaisseaux et autres coques de noix.
Cà y est, la peinture est sèche !...C’est reparti pour la deuxième couche ! …Je reprends donc la barre de mon pensum maritime.
Pour continuer, une resucée d’histoire…
Revenons un chouïa sur la période succédant à la Guerre de Cent Ans et même, pour faire plaisir à Gilles (Lostinaos), évoquons, durant ce long conflit, la période Charles V qui règne de 1364 à 1380. Sous son impulsion, le titre d’Amiral de France, confié à Jean de Vienne, n’est plus un vague titre sans pouvoir réel mais devient une véritable charge opérationnelle. Il a la responsabilité des constructions et celle, avec l’Escadre, de la police des mers. Le Clos des Galées de Rouen, qui périclitait aimablement, est réactivé. Harfleur dispose d’une flotte de vaisseaux en état de prendre la mer. Les Anglais voient l’accès de leurs Cinque Ports - ils sont huit, dans la réalité- qui abritent la flotte de guerre, se faire si sérieusement malmenés par les attaques des navires français qu’ils commencent à avoir la pétoche. Charles V valide son ticket de sortie en 1380 et le trône revient à Charles VI, monarque complètement timbré mais çà ne l’empêchera pas de régner 42 ans ! Jean de Vienne réussit quand même à tenir la flotte à bout de bras, monte des opérations de soutien en Ecosse, envisage même d’envahir l’Angleterre en rassemblant une flotte à L’Ecluse – pas superstitieux pour deux écus, le bougre !- mais, comme la vie est mal faite, est expédié se coltiner avec les Turcs et se fait proprement embroché du côté de l’actuelle Bulgarie, en 1396. Cà arrange bien les bidons des Anglais qui nous piquent Harfleur en 1415 et font une jolie flambée du Clos des Galées en 1419. Fin de l’épisode maritime, tout le monde redescend à terre ! D’autant plus que le pauvre Charles VII, successeur du maboul, se retrouve à la tête d’un royaume à peine plus grand que la résidence secondaire de votre patron et même pas en bord de mer ! Après arrive la Jeanne qui, à force de compter ses moutons, finit par voir la Vierge et vous connaissez la suite…
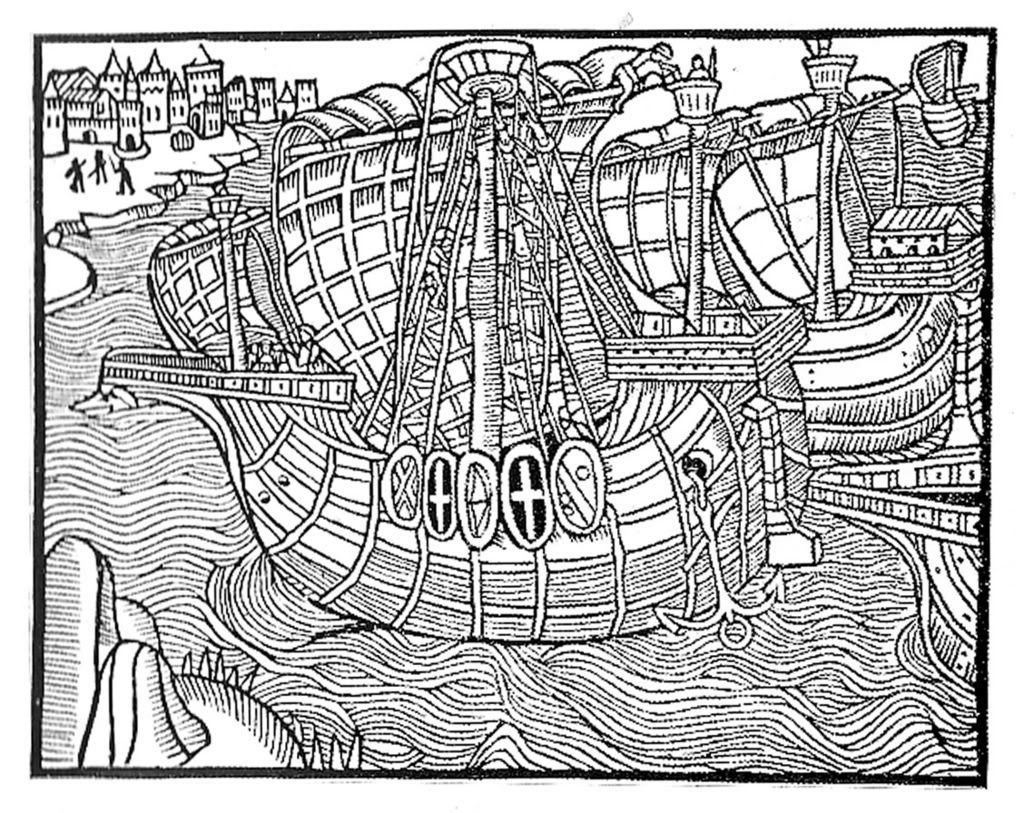 |
| (33) Vaisseau - gravure sur bois du XVème siècle. |
Le navire est équipé de trois mâts, grées chacun avec une voile carrée. L’imposant mât central supporte une grande hune militaire destinée à accueillir des archers ou des arbalétriers. L’artillerie est encore absente de la panoplie du parfait petit vaisseau militaire. Les Vénitiens ont bien inauguré avec l’emploi de « pots à feu » mais comme il y a plus de risque de mettre le feu au bâtiment que de causer de réels dégâts chez l’ennemi, on a vite laissé tomber. Les vaisseaux de l’époque sont des châteaux-forts flottants qu’on prend d’assaut à l’instar des forteresses terrestres. Les dimensions des navires s’accroissent mais la technique de construction est encore perfectible et les constructeurs, méfiants, utilisent des contre-couples pour renforcer la coque, ce qui leur donnent cet aspect rosette de Lyon dans son filet, comme chez votre charcutier préféré. De même, quitte à réduire ses performances véliques, la voilure est ralinguée à l’aide de filins.
Comme je vous sens particulièrement au fait des termes maritimes, je ne vais pas tarder à vous faire un petit rappel de base.
Nous voilà déjà à la fin du XVème siècle, le strasbourgeois Gutenberg -Hopla !- nous concocte la presse d’imprimerie et le Génois Christophe Colomb s’en va taper un peu de pognon à la Cour d’Espagne pour armer une flottille, contre la promesse un peu folle de ramener du lointain Levant de l’or et des épices, en passant par le Couchant. Le premier termine fauché et le second se plante totalement sur sa destination mais c’est l’aube de la Renaissance et de la grande aventure au large.
 |
(34) La Santa Maria, vu par les artistes de l’époque. Même avec un billet de faveur, je refuse de traverser l’Atlantique sur une barcasse pareille ! |
Cà ne rate pas, tandis que l’Espagne, les Pays-Bas, l’Angleterre et même les Portugais arment des flottes de commerce et commencent à ramener, qui de l’or, qui des produits exotiques, la France reste plantée à surveiller le pis de ses vaches ! L’armement au commerce reste du domaine privé. C’est comme çà qu’un Français fonde, en 1405, le Royaume des Canaries, escale d’importance sur la future route de l’Amérique du Sud, royaume qu’on refilera vite fait à la Castille ! Une colonie française s’installe dans l’estuaire de l’Amazone mais ses membres meurent assez rapidement rongés par les fièvres ou becquetés par les populations locales.
En plus, le Pape s’en mêle et partage abusivement la Terre en deux moitiés. Au sud des Acores, c’est pour les Portugais, au nord, pour les Espagnols, les autres, Français râleurs, Anglais schismatiques et Bataves excommuniés, sont priés d’aller jouer ailleurs ! Ah oui, et la liberté des mers, j’en fais quoi ? Si çà, ce n’est pas un marché de dupes ? Résultat, les cancres du banc du fond attribuent des « lettres de courses » à des corsaires opportunistes qui vont faire fructifier leurs fonds de commerce aux dépens des flottes de commerce espagnoles et portugaises, tandis que les gouvernements s’assoient aimablement sur le traité papale et sponsorisent, à tour de bras, des expéditions style « Nature & Découverte ».
L’apathie française perdure jusqu’aux années 1530, puis Cartier explore les côtes de Terre-Neuve et l’estuaire du Saint-Laurent. Champlain y fonde le Québec et en 1541, François Ier annexe le Canada. Les Français font amis-amis avec les nations indiennes des Hurons et des Algonquins mais se prennent le chou avec les Iroquois qui, alliés aux Britanniques, nous le feront payer cher deux siècles plus tard. Cela dit, le Canada, c’est froid, gelé – pas fameux comme climat pour les épices !- et en dehors des pelleteries (les fourrures), çà ne rapporte pas bezef. Jacques Cartier ramène, tout fiérot, de l’or et des diamants…manque de bol, ce n’est que du cuivre et du mica !
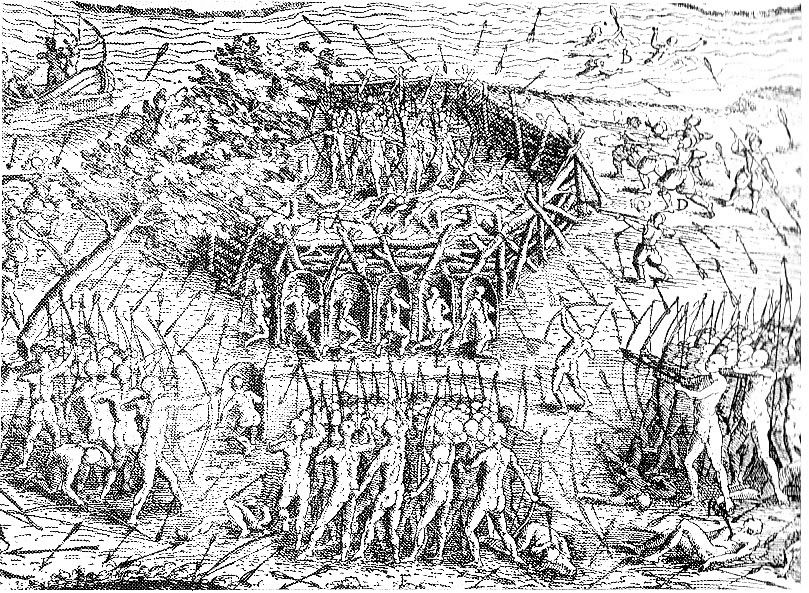 |
| (35) – Ma cabane au Canada… (Line Renaud – 1392 – 20..) Un parti d’Iroquois retranchés aux prises avec les Français et leurs alliés indiens. Dans l’imagerie populaire, le « bon sauvage » est toujours à loilpé même si la froidure fait pêter les cailloux ! |
C’est au cours du XVIème siècle que la flibuste, terme d’origine hollandaise qui désigne la piraterie dans la mer des Antilles, commence à s’installer du côté des Iles, alléchée par l’odeur du pognon qui circule sur les flots…Mais on en reparlera un peu plus tard, quand ils auront droit à leur heure de gloire.
Le développement du commerce maritime transocéanique influence la construction navale car il n’est pas possible de se frotter à la navigation hauturière avec les bouchons qui se produisaient jusqu’alors. Il faut également pouvoir ramener des cargaisons importantes afin de rentabiliser les voyages. Les coques s’agrandissent, la voilure se perfectionne et la mâture gagne en hauteur pour y rajouter de nouvelles voiles et profiter aux mieux des différentes allures de vent rencontrées. En quelques années, la silhouette des navires évolue. Mais çà tâtonne quand même pas mal, on rajoute des mâts qui s’avèrent superflus, on empile des châteaux de proue et de poupe démesurés préjudiciables à la stabilité des navires et sensibles à la prise au vent.
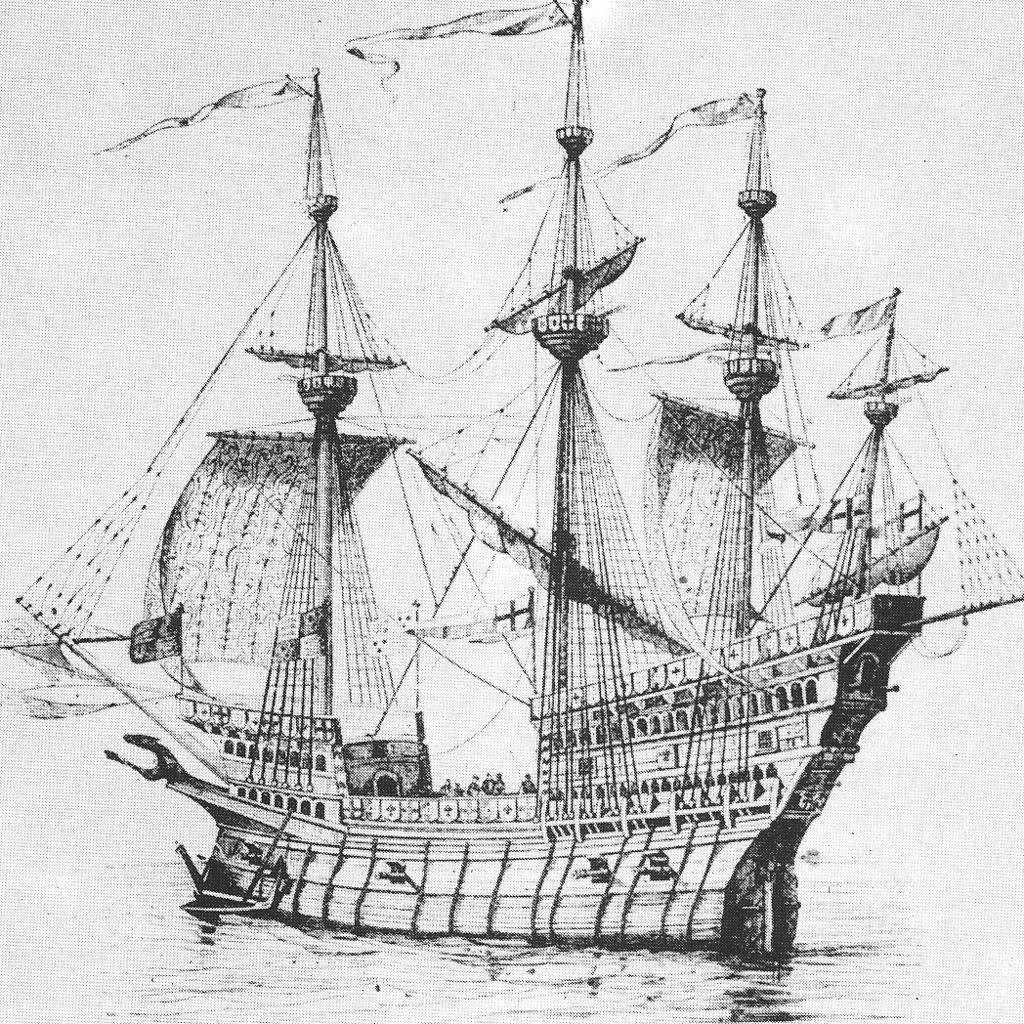 |
| (36) Vaisseau anglais sous Henry VIII - début XVIème siècle (1520) |
. Le roi d’Angleterre empruntera ce vaisseau pour rallier le Camps du Drap d’Or organisé par « Anchois Pommier » - vieille blague de potaches en culottes courtes…Mon premier est un poisson, mon second, un arbre fruitier, mon tout, un Roi de France…Anchois-Pommier (François Ier). Ce navire dispose d’une artillerie de bord mais elle se limite apparemment à quatre pièces de chaque bord. La voilure est disposée sur quatre mâts, dont deux situés sur le château arrière et le mat de beaupré, celui qui pointe vers l’avant et qui surplombe la figure de proue, est muni d’une civadière (c’est la voile). La coque est encore ceinturée de contre-couples(les pièces de bois verticales représentées sur la coque) et la bordée garnie de boucliers.
La gravure ci-dessous, un peu plus tardive dans le siècle, révèle bien la tonture importante (cintrage longitudinal) des navires de l’époque. Elle a pour but d’offrir une proue élevée à l’attaque de la vague et, conjuguée avec la bouge (cintrage latéral des ponts), facilite l’évacuation des paquets de mer embarqués, par les dalots découpés dans les murailles du bâtiment. Dans l’esprit des architectes de marine de l’époque, la tonture s’adapte harmonieusement à la forme arrondie du creux des vagues. Elle donne aux navires de l’époque, avec l’importante élévation des châteaux, un curieux air de fer à cheval flottant.
 |
| (37) Flotte de galions du XVIème siècle - gravure hollandaise. |
Le développement de la piraterie sur les routes commerciales et la prolifération de lettres de courses attribuées aux corsaires -on se déclare la guerre pour un oui ou un non- obligent les bâtiments au commerce à embarquer de l’artillerie de bord et les navires transportant des cargaisons précieuses, comme les galions espagnols chargés de ramener le pillage des trésors et mines d’or des Amériques, offrent l’aspect de véritables vaisseaux militaires.
Le galion est un concept plus ou moins espagnol qui découle de l’union un peu contre-nature de la lourde caraque, le château-fort flottant du Moyen-âge, avec l’agile caravelle de faible tonnage pour répondre aux exigences de la navigation hauturière transocéanique et aux contraintes de l’artillerie embarquée. Il conserve un château avant mais de dimensions plus réduites et une longue dunette arrière, dispositions hérités de la caraque, il comporte quatre mâts. Si, effectivement, pour l’époque, il apporte un certain nombre d’innovations, ce n’est pas la révolution technique que certains, de nos jours, veulent y voir. Il y aura des galions de toute nationalité car l’Angleterre et la Hollande, autres grandes nations maritimes, ne restent pas les deux pieds dans le même sabot et le galion n’est que l’évolution logique de deux siècles d’architecture navale occidentale. D’ailleurs, lorsque que la Grande Armada, flotte de 130 navires principalement constituée de galions militaires, se prend sa célèbre déculottée en 1588, dans la Manche, il semble bien que les Anglais avaient quelques coudées d’avance, technologiquement parlant, notamment en ce qui concerne l’artillerie embarquée. Cette expédition est destinée initialement à porter secours à Marie Stuart, Reine d’Ecosse catholique, qui se fait proprement décolletée par Elisabeth I, l’anglicane, en 1587. Du coup, hormis pour venger la pauvre suppliciée, elle n’a plus vraiment d’objectif précis sauf, peut-être, installer une hégémonie espagnole sur les mers occidentales et, éventuellement, débarquer 30 000 soldats en Grande-Bretagne -Puisque qu’on vous dit que depuis le coup de bol d’Hastings en 1066, c’est loupé d’avance ! Cumulant la malchance, l’escadre déconfite, après sa défaite dans la Manche, se met en tête de retourner dans ses atterrages espagnols en faisant le tour de la Perfide Albion par le nord et l’ouest, pour des raisons de vents. Elle rencontre une monumentale tempête en mer d’Irlande qui coule à peu près tout ce qui peut encore flotter ! Amen !
 |
| (38) Combat naval entre la flotte anglaise et l’Invincible Armada en 1588 |
Et la France, me direz-vous, que fait-elle pendant ce temps-là ? A vrai dire, pas grand-chose ! François Ier, durant son règne, sponsorise suffisamment les Guerres d’Italie, les châteaux de la Loire et Léonard de Vinci pour ne pas pouvoir engager trop de sous dans une Marine Royale, d’où la sous-traitance aux Turcs de notre protection en Méditerranée, évoquée dans le chapitre précédent. Ah si !...Pour changer, il y a aussi un énième projet de débarquement en Angleterre, suite à la prise de Boulogne par les navires d’Henry VIII, et quelques opérations navales sur les côtes anglaises jusqu’à la signature d’un traité de paix en 1546. Quand François Ier meurt, en 1547, la Bretagne est maintenant rattachée au Royaume, un port est en construction au Havre et les chantiers français ont lancé leur premier vaisseau, La Grande Françoise, jaugeant 1500 tonneaux.
Son successeur, Henri II, fait naitre de grands espoirs, dès 1549-50, en projetant une flotte de 40 galères au Levant et de 50 vaisseaux au Ponant pour enquiquiner le Roi d’Angleterre. Cependant le commandement reste confié à des Génois. Mais, en 1555, la rencontre malencontreuse de son œil avec la lance de Montgomery, au cours d’un tournoi, abrège son règne. A partir de là, les souverains se succèdent, François II – période d’essai d’un an non reconductible pour cause de décès-, Charles IX a dix ans à son couronnement - du coup, c’est Môman, Marie de Médicis, qui pilote le bateau France – et 24 ans, à sa mort. En 1574, Henri III, avec ses bilboquets et ses Mignons, hérite d’un royaume fort mal en point entre les luttes opposant catholiques et protestants et celles d’influence, mais toutes aussi mortelles, avec la Maison de Guise. Les affaires vont même tellement mal que personne n’a eu le temps, depuis la mort d’Henri II, de regarder vers le large. De toutes façons, les caisses de l’Etat sont vides et c’est ce que constate Henri IV lorsqu’il récupère la clé du coffre en 1589, après qu’un certain Clément, moine fanatique de son état, ait assassiné son prédécesseur. Son Premier Ministre, Sully, aura une phrase célèbre, « Labourages et pâturages sont les deux mamelles de la France » qui résume assez bien l’approche terrienne de la politique de l’Etat. Néanmoins, c’est durant le règne du Bon Roi à la poule au pot hebdomadaire que Marseille devient la plaque tournante du commerce méditerranéen.[BREAK=Dis, Monsieur, dessine-moi un vaisseau !]
Dis, Monsieur, dessine-moi un vaisseau !
Ce n’est qu’au cours du XVIIème siècle que le vaisseau adopte ses formes définitives ou presque. Les navires au commerce n’en sont que des copies plus ou moins ventrues. Il faudra attendre la course au thé et les clippers du XIXème siècle pour que la marine marchande développe sa propre architecture maritime. Les tâtonnements des architectes navals et les incongruités techniques font la célébrité de quelques ratés spectaculaires comme celui du Vasa (ou Wasa), orgueil de la flotte suédoise, tellement chargé dans les hauts et si mal équilibré qu’il tire sa révérence, en 1628, lors de son voyage inaugural, à un mile du quai de départ ! Au cours de l’enquête diligentée, les responsables se défilent aimablement en expliquant qu’ils ont bien remarqué des trucs bizarre, lors de l’armement, mais comme le Roi tenait fermement à voir son vaisseau-emblème prendre la mer dans les plus brefs délais…bref, vous avez compris… ce n’est pas moi, c’est Lui ! A posteriori, ce naufrage est une véritable aubaine pour les historiens de marine car les restes de l’épave, immergée sur un haut-fond proche du port, ont été renfloués dans les années 1960/1970 et font les beaux jours de musées suédois.
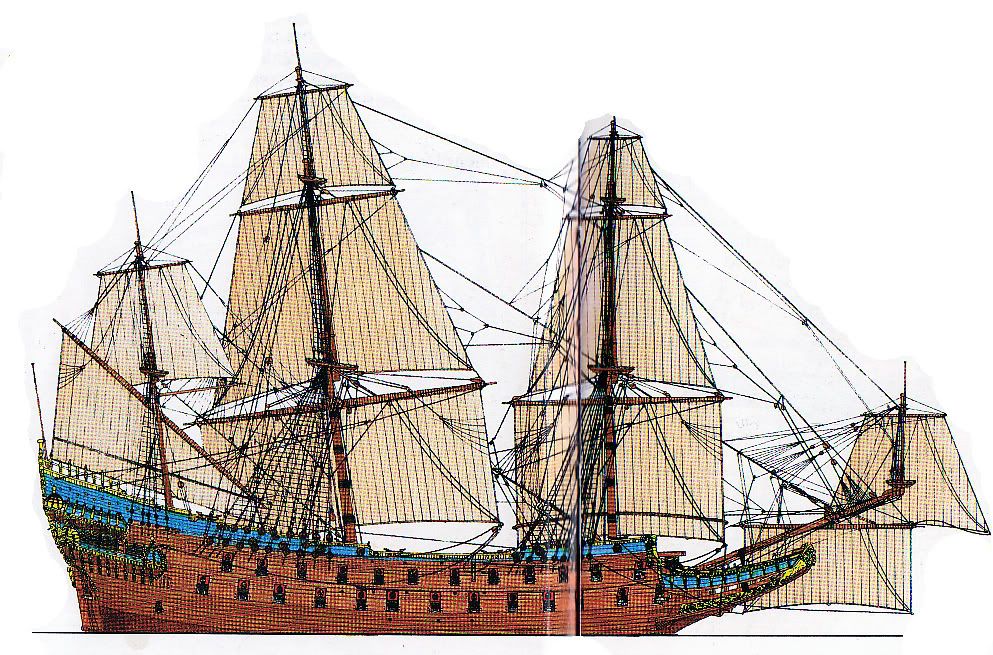 |
| (39) Le Vasa - croquis couleurs |
 |
| (40) Voyage inaugural et naufrage du Wasa - Stockholm – 1628 |
En France, il faut attendre la fin du XVIIème siècle, sous le règne du Roi-Soleil, pour qu’on se décide à établir une Bible technique de la construction des navires. Jusqu’alors, les technique de fabrication se transmettent oralement, nombre d’artisans sont illettrés, et par le geste technique, du maitre à ses apprentis ou du père à son fils. Ce qui occasionne quelques loupés bien franchouillards, comme le vaisseau, La Couronne, un deux-ponts de 74 canons,beau comme un camion, assez bon marcheur maistellement instable qu’il ne sera aligné dans aucun combat et sera désarmé huit ans après le démarrage de sa construction, entamée en 1637.
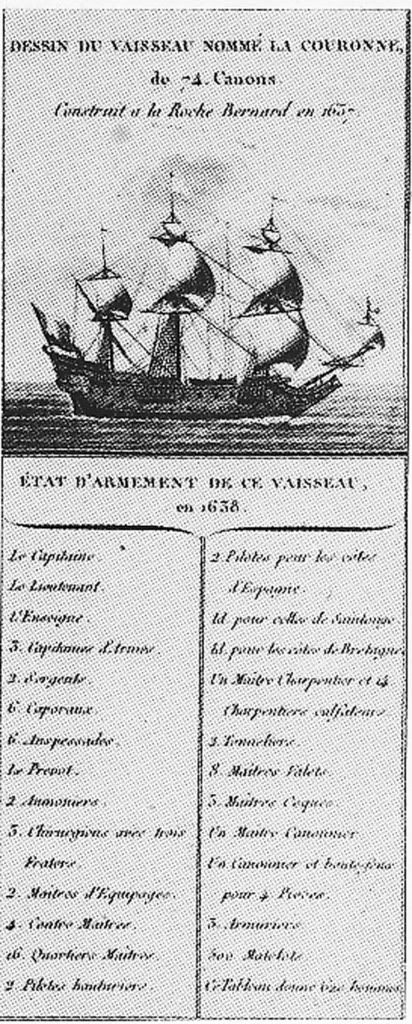 |
| (41) Armement de la Couronne - 1638 |
La véritable référence des vaisseaux est, bien évidemment, d’origine anglaise. C’est le Sovereign of the Seas, le premier véritable trois-ponts, lancé, lui aussi, en 1637. A la différence de son contemporain français, c’est une vraie réussite technique, sa décoration est tellement somptueuse et son armement est si important que les Hollandais, pas trop copains avec l’Angleterre, à l’époque, l’avaient respectueusement surnommé « le Diable doré ». Il a quand même un défaut non négligeable. Sous le poids des ornements, dorures de tout poil, et de son armement, il a la fâcheuse tendance à trop s’enfoncer dans les flots, risquant de noyer sa batterie basse en cas de mer un peu formée.
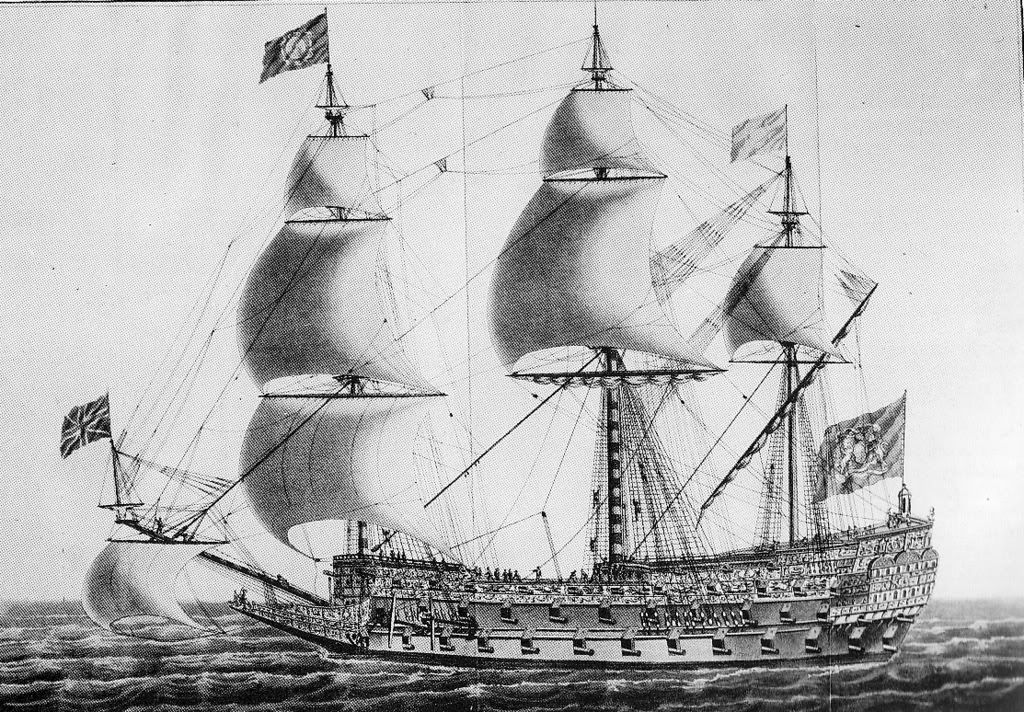 |
| (42) Sovereign of the Seas – 1637 |
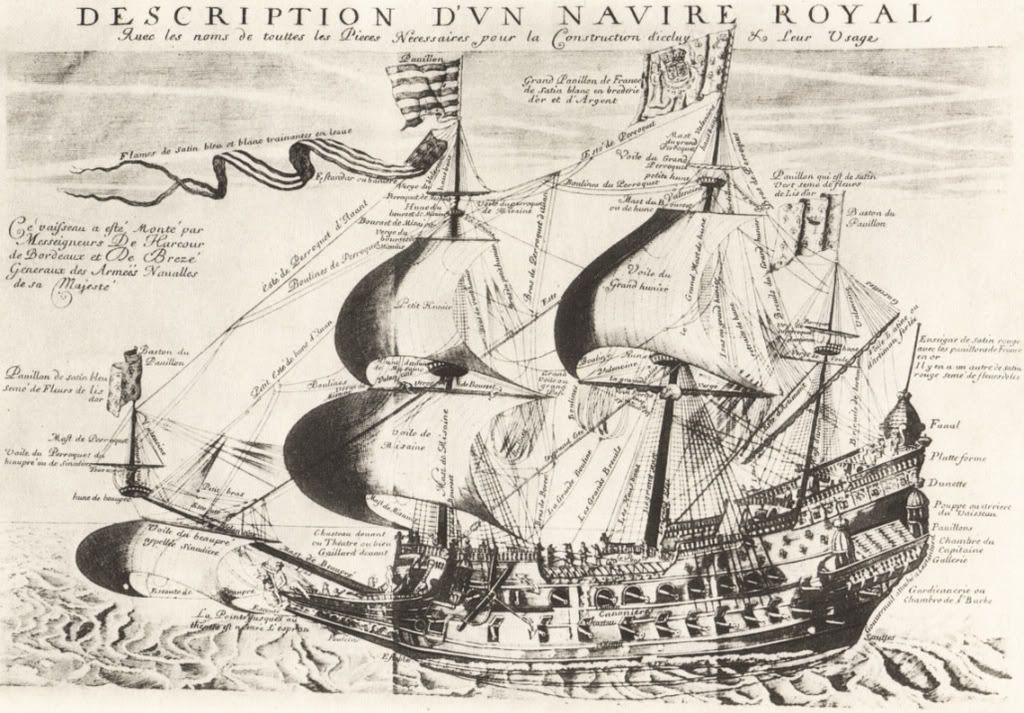 |
| (43) Description d'un navire royal - Hydrographie du Père Fournier - 1667 |
Ce vaisseau à deux-ponts est une parfaite synthèse de l’architecture navale du XVIIème qui perdurera durant près de deux cent ans à quelques évolutions près. Il y a encore pas mal de choses à améliorer mais la construction navale a trouver son fil conducteur.
La mâture
Le choix de la mâture est fixé à trois mâts, en réalité quatre. Le seul mât non vertical est le mât de beaupré qui pointe vers l’avant. Il n’est jamais pris en compte dans le décompte des mâts…hop ! Circulez ! Donc, les trois mâts sont, à partir de l’avant, le mât de misaine, le grand mât et, tout à l’arrière, le mât d’artimon. La taille des mâts, notamment celle du grand mât, va se mettre à dépasser la longueur du navire, de l’ordre de 60 m, et encore vous ne voyez que la partie émergeant de la coque, les pieds de mâts, hors l’artimon sur certains gros bâtiments, descendent jusqu’à la quille. Les plus grands mats atteignent 70 m de haut ! Il existe bien quelques sapins de dimensions exceptionnelles dans nos belles forêts « françouaises » mais de cette hauteur-là, çà surpasse la recherche du trèfle à quatre feuilles ! De surcroit, un tronc unitaire d’une telle taille offre une trop grande souplesse et une trop grande fragilité intrinsèque pour les contraintes qu’il va subir. Enfin, où c’est-y que je le case dans le joli bateau en tant que mât de rechange ?...Et je fais comment pour le remplacer en pleine mer ? …Ah, on fait moins le malin ! Les mâts sont donc constitués d’éléments séparés. Comme le marin est débrouillard, il conçoit un dispositif fort ressemblant à la mise en place de la baïonnette sur un canon de fusil, le chouquet, une sorte de casquette en bois à la visière percée qui vient chapeauter le sommet du mât inférieur et maintenir l’élément supérieur. Vous rajoutez des clavettes et le tour est joué !
Cette disposition se généralisera dans la première moitié du XVIIIème siècle et simplifiera la tâche des charpentiers. Le mât est constitué de plusieurs éléments. Le bas-mât qui prend appui sur la quille, traverse les différents ponts à travers le puit de mât et culmine à une trentaine de mètres de haut. La section suivante est le mât de hune et l’ultime tronçon, le perroquet. On verra également apparaître un quatrième tronçon, le cacatois mais, au final, cette ultime voile sera gréée directement sur le troisième tronçon rallongé, le perroquet. Au milieu du XIXème siècle, des monstruosités, comme le Valmy, lancé en 1847, seront à nouveau équipés d’un mât de cacatois.
 |
| (44) Croquis d'une frégate - Antoine Roux - Détails des mâts Sur cette superbe esquisse de l’artiste, j’ai honteusement rajouté des commentaires. En rouge, la dénomination de chaque mât En bleu, celle des différentes sections de mâts En vert, la particularité de l’artimon qui n’a pas de hunier. |
Le bas-mât est surmonté d’une hune, plate-forme multi-usages servant à la manœuvre, l’observation et de poste de mousqueterie lors de combats rapprochés. La hune de grand-mât, initialement circulaire, a les dimensions d’un spacieux studio parisien, pas loin de 5m de long sur plus de 7m de large. Durant le Premier Empire, les hunes françaises seront bordées de rambardes en toile.
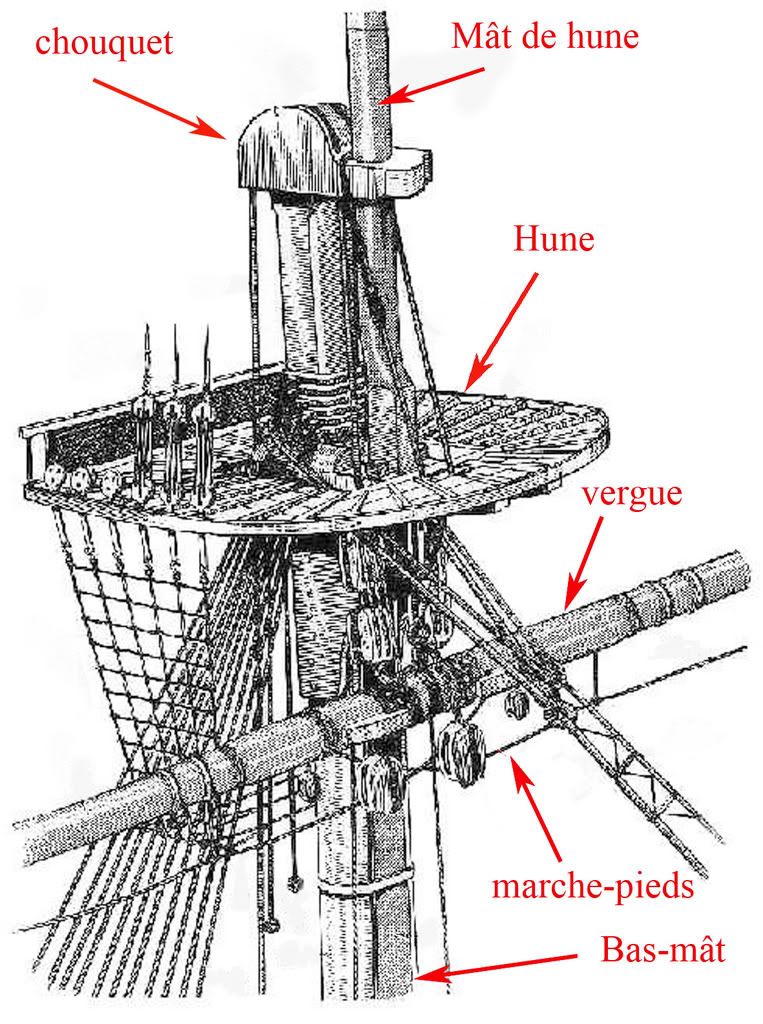 |
| (43) – Détails d’une hune – XVIIIème siècle. |
L’astucieuse disposition des mâts en éléments séparés a l’avantage de les rendre télescopiques et selon les conditions de mer et de vent, ils peuvent être descendus. Par gros temps, cette manœuvre réduit la casse et la prise au vent, tout en abaissant le centre de gravité du navire. Dans cette configuration, on dit que les mâts sont calés.
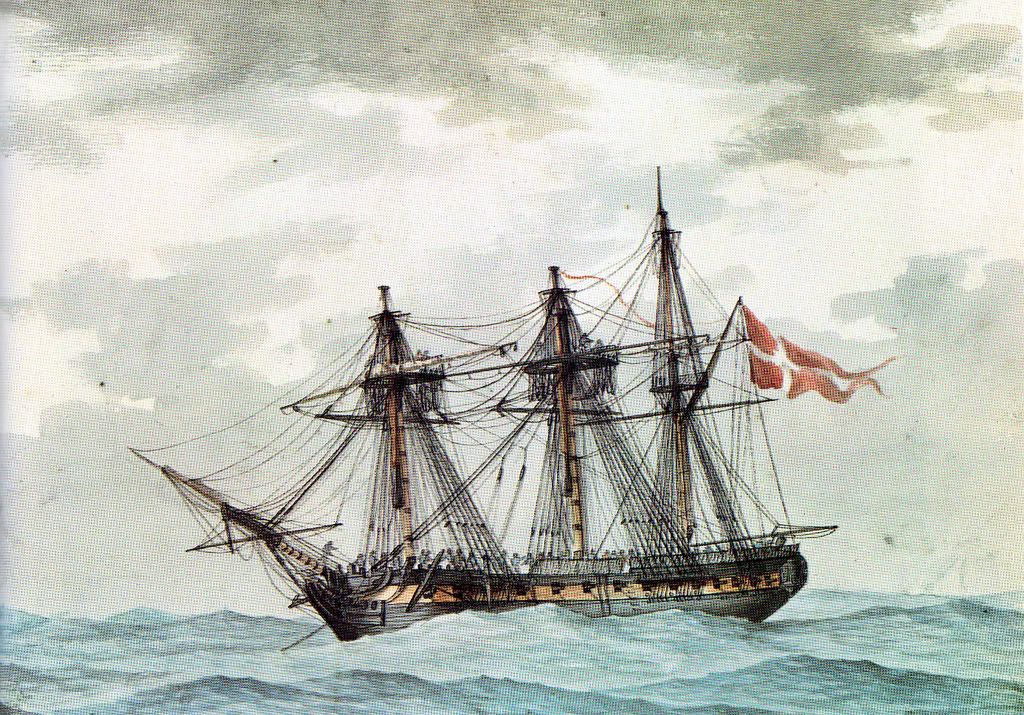 |
| (44) – Corvette suédoise à l’ancre par grosse houle, avec les mâts calés – Aquarelle d’Antoine Roux – 1799 |
La section des bas-mâts devient si importante qu’ils ne sont plus réalisés à partir d’un unique tronc d’arbre mais constituer d’un assemblage d’éléments longitudinaux, le tout étant collé et cerclés, au départ, par des ligatures en cordages puis par des bagues en fer. Neuf arbres sont nécessaires pour réaliser le bas-mât du grand mât, près d’un mètre de diamètre, d’un vaisseau de 74, dans les années 1780 !
 |
| (47) Hune et bas-mât du Rivoli (1812) Cette photo de maquette du Musée de la Marine met en évidence les cerclages de fer et de cordage du bas-mât. |
Le mat de beaupré, l’unique mât non vertical, est implanté suivant un angle de 30-35°. Ce mât a un rôle particulier car l’expérience fait apparaître une nécessité, implanter une voile d’évolution le plus en avant du navire, c’est une voile qui est au vent ce qu’est le gouvernail à l’eau. D’où la mise en place de ce prolongement caractéristique des navires à voiles de l’époque. Je détaillerai dans le prochain chapitre, les atermoiements survenus dans le choix du gréement de ce mât
La voilure
Maintenant que nous avons des mâts, nous allons y rajouter des voiles, çà peut toujours servir, n’est-ce-pas ?
Les bâtiments militaires, vaisseaux, frégates, corvettes et bricks sont dénommés à phare carré. Cette appellation désigne le type de gréement. Vous allez me dire qu’il ne faut pas être grands experts navals pour remarquer que les voiles ont une tronche nettement carrée. En réalité, ce n’est pas exactement ce détail qui définit le type de gréement mais plutôt la disposition du mât le plus en arrière, l’artimon. Il existe une autre disposition, le phare barque mais elle concerne principalement des navires à usage commercial, développés au cours du XIXème siècle et quelques voiliers-école de construction tardive. Un des derniers trois-mâts carré célèbre, à « usage militaire » sera le corsaire Seeadler, commandé par le Comte von Lükner, qui écumera l’Atlantique et le Pacifique, en 1916-1917 et finira sa carrière malencontreusement échoué sur un atoll polynésien. ! J’ai mis « usage militaire » entre guillemets, parce qu’au départ, c’était un bâtiment au commerce américain, réaménagé en corsaire pour la Kriegsmarine...Pardon la Kaiserliche Marine, pour faire plaisir à Maitre Alain!
 |
| (48) SMS Seeadler Comme vous pouvez constatez, les voiles sont franchement rectangulaires mais ce type de gréement est bien classé « carré ». |
Pour en finir avec cette classification un peu rébarbative, il suffit juste de savoir qu’un gréement barque, ne comporte aucune voile perpendiculaire à la quille sur le mât d’artimon.
 |
| (49) Exemple de trois-mâts barque (Le Sagrès II) |
Mais revenons à nos moutons !...Comme un bon dessin vaut mieux qu’une longue explication, j’ai eu la chance de tomber, dans le même bouquin, sur une autre esquisse d’Antoine Roux, représentant la frégate sous une autre allure, qui permet de passer en revue la quasi-totalité des voiles d’un trois-mâts, à deux ou trois trucs près. Comme précédemment, je l’ai annoté des différents noms de voile.
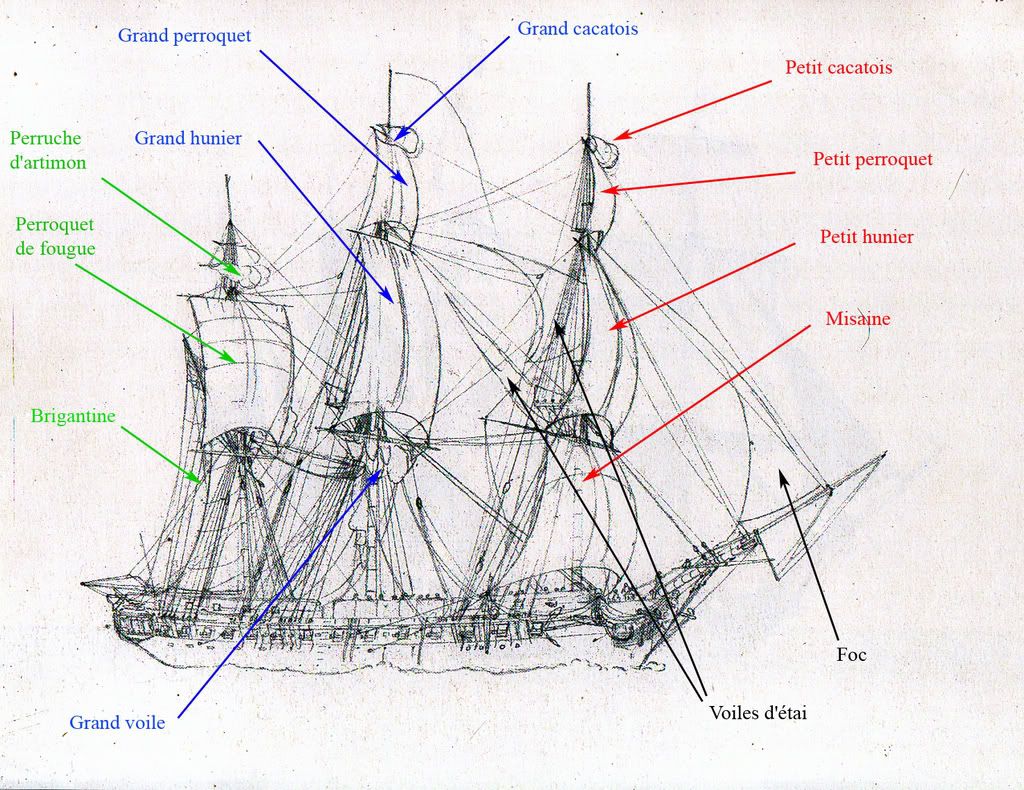 |
| (50) Croquis d'une frégate - Antoine Roux – voilure |
Il peut y avoir plusieurs focs, trois au maximum, sur le mât de beaupré, avec des dénominations distinctes et également des voiles d’étai entre chaque mât.
On distingue deux type de voiles, les voiles disposées perpendiculairement à la quille, comme le hunier, la grand-voile ou la misaine et celles dans l’axe longitudinales du navire, focs, étais et artimon. Vous noterez l’attachement des marins à donner des noms de volatiles exotiques aux voiles hautes, perroquet, cacatois (qui n’est autre que le cacatoès), et perruche. Les voiles perpendiculaires sont trapézoïdales et s’élargissent vers le bas. Les plus grandes sont munies de bandes de ris avec des garcettes pour diminuer la surface de la voile – on remarque bien les bandes de ris sur le perroquet de fougue, repéré en vert. D’où l’expression « prendre un ris dans la grand-voile » qui n’a aucun rapport avec le célèbre l’Oncle Ben’s. Les dimensions et le poids de ces voiles ne permettent pas de les affaler sur le pont avec leurs vergues (les grands bouts de bois sur lesquels elles sont gréées), en conséquence, les gabiers grimpent dans la mâture, se répartissent sur les marchepieds, prennent appui sur la vergue pour éviter de retomber trente mètres plus bas et brassent la voile, soit en totalité, soit selon une bande de ris, qui comportent des « ficelles », garcettes, pour attacher la partie de voile remontée à la vergue. Ce brasseyage peut avoir l’aspect « grosse caguade » de la grand-voile sur le croquis au-dessus, ou « brassé serré » avec la voile soigneusement liée à sa vergue. Les voiles, jusqu’au milieu du XVIIIème siècle ont un aspect « popoche » assez prononcé, mais leur fabrication évolue vers un profil plus tendu.
Vous allez laissez aux peintres inventifs et à Hollywood, l’aspect d’un bâtiment « toutes voiles dehors », avec des voiles à chier partout. Il y a effectivement une tripotée de voiles mais c’est pour rendre marchant le voilier sous les différentes allures de vent. Dans la réalité, on limite l’emploi au maximum de voiles nécessaires et on évite surtout qu’elles se bouffent le vent entre elles ! Si par exemple, par vent arrière, vous vous mettez à déployer toutes les voiles, un, vous allez déventer les autres placées plus avant, deux, le bâtiment aura tendance à lever le cul et à engouffrer la flotte par l’avant. Donc, vous êtes un capitaine expérimenté et vous exploitez vos voiles de l’avant. Heu…Oui, certes, mais çà risque de manquer de surface vélique !...Je ne vous ai pas tout dit, le marin prudent a prévu le coup et, au moyen de vergues horizontales télescopiques - des bouts-dehors- rajoutées sur les vergues principales, peut adjoindre des voiles supplémentaires, les bonnettes. En résumé, plus il y a de vent, plus la mer est formée et moins il y a de voiles hautes. Au mieux, vous risquez la casse.
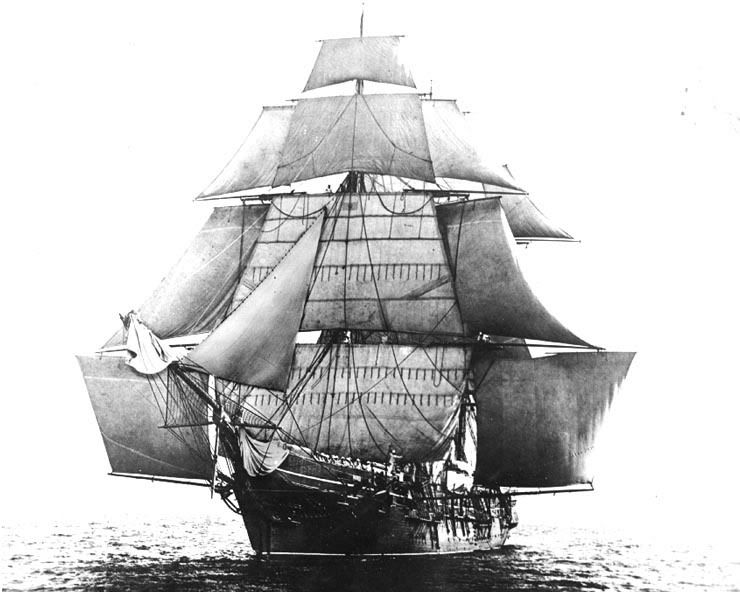 |
| (51) USS Monongahela naviguant sous bonnettes - 1862 Comme les peintres de l’époque ont un peu oublié de représenter cette configuration, j’ai du me rabattre sur un bachot américain de l’époque de la Guerre de Sécession. Les bonnettes ne sont utilisées que par petit temps (mer calme et petit vent sympathique !). |
Les deux enquiquinements maximum, le beaupré et l’artimon.
Nous venons de résumer la disposition des voiles dont la fonction est d’emmagasiner le maximum de vent, quand il n’y en a ni trop ni pas assez, pour faire progresser le navire. Il nous reste à voir, les voiles directrices, ou d’évolution, celles tout à l’avant et tout à l’arrière. On s’est vite rendu compte que les voiles carrées s’étaient super pour prendre le vent mais que, du coup, le navire marchait n’importe comment. Comme sur ce genre de bâtiment, on n’a pas de rameur pour compenser et que le gouvernail d’étambot n’est pas une godille, il a bien fallu trouver des solutions techniques.
Le beaupré.
C’est donc le seul mât non vertical qui équipe l’avant du navire. Il est destiné à y gréer la voilure la plus éloignée, celle qui fait un peu office de chien de tête dans un attelage de traineau. Au départ, comme ce mât est tout sauf pratique, on va lui coller une vergue basse transversale munie d’une voile, la civadière, qui passe son temps à se tremper les pieds dans la flotte et à se faire masquer !
On poussera même le vice jusqu’à gréer une deuxième vergue, la contre-civadière, qui, en dehors de rajouter du boulot supplémentaire, n’apporte pas grand-chose de mieux.
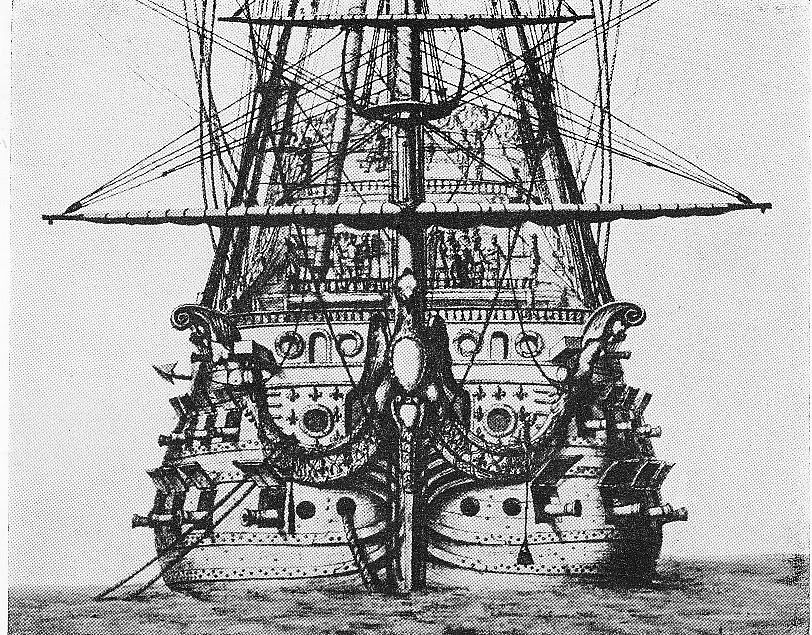 |
| (52) Avant d'un vaisseau et vergue de civadière - Atlas de Colbert – 1665 |
Il reste une solution, rajouter un mat supplémentaire vertical sur cette « rallonge » que constitue le mât de beaupré. Techniquement, ce n’est pas le pied car il ne faut surtout pas accroitre le volume avant de l’étrave. Alors, on se met à bricoler un truc pas possible, le perroquet de beaupré ! C’est vilain au possible, çà casse facilement…et, bof, ce n’est pas non plus une trouvaille technique immortelle.
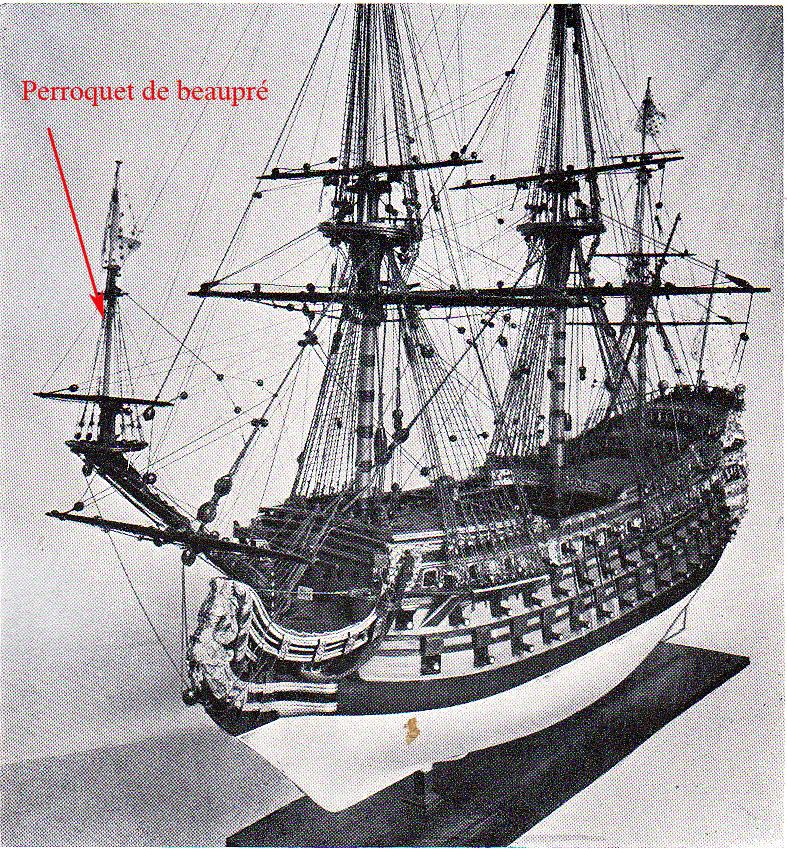 |
| (53) Perroquet de beaupré - Vaisseau Le Louis XV - Maquette du Musée de la Marine. |
On finira par trouver la solution, vers les années 1720, sous la forme de voiles longitudinales triangulaire, la famille des focs, grées sur des haubans disposés entre le mat de misaine et le beaupré, qui lui se verra rajouter une rallonge, le bout-dehors de beaupré.
L’artimon
Je vous ai résumé l’évolution du beaupré, passons à l’extrémité arrière, le mat d’artimon. C’est une voile directionnelle, destinée à faciliter les virements de bords. En principe, une voile latine, comme celle qui équipe les galères, correspond bien à cette fonction. Le problème c’est que ce type de gréement oblige à des manœuvres pas possibles quand il s’agit de changer d’amure (côté). Si cette voile se retrouve du côté au vent du mât, placée entre le vent et le mat, elle va bêtement envelopper ce dernier dans sa toile. Il faut donc basculer l’ensemble voile et antenne du côté opposé au vent. Cà prend un temps fou, çà nécessite une main d’œuvre importante et çà masque une partie de la grand-voile. Ce qui, par parenthèse, vous explique pourquoi les équipages des galères n’étaient pas des grands fanatiques de la navigation toutes voiles dehors, d’autant plus que les surfaces de voilure des galères étaient beaucoup plus importantes.
 |
| (54) Détail de l'artimon à la française (1) - Arrivée des Français à la Désirade - Début XVIIIème |
Sur les gréements carrés, la première solution technique consiste à réduire la surface de voilure au strict nécessaire, en supprimant la partie qui « coince » lors des changements de bord mais, pour des raisons inexpliquées, la totalité de l’antenne, qui ici s’appelle une orse, est conservée. Comme de toute façon, à cet endroit-là, on ne grée pas de voile qui se ferait, de toute façon, bouffer le vent par l’artimon, c’est encombrant mais guère gênant.
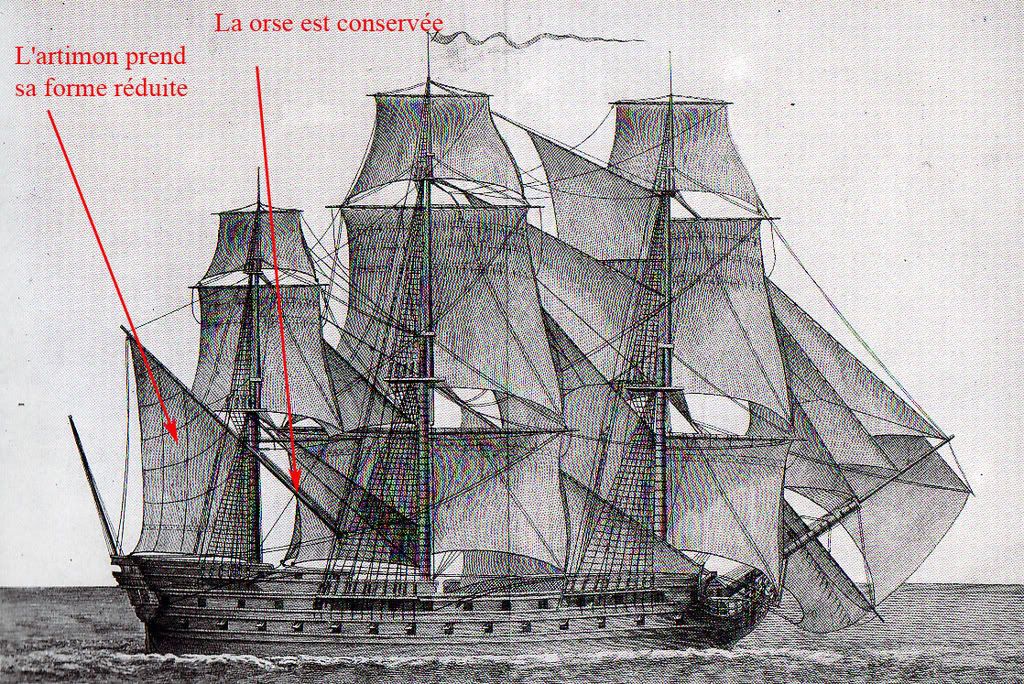 |
| (55) Détail de l'artimon à l’anglaise (2) - Gravure d'un vaisseau de 74 parue dans l'Encyclopédie |
La deuxième étape, vers la fin du XVIIIème siècle, consiste à couper ce tronçon de vergue inutile et à réaliser un dispositif à fourche, la corne, qui permet au gréement d’artimon de roter librement autour du mât. C’est une bonne idée mais la partie inférieure de la voile se met à flotter comme un drapeau dès qu’il s’agit de changer d’amure par bon vent. L’ultime évolution sera l’adoption de la bôme ou gui, vergue inférieure qui met un peu de discipline dans tout ce pataquès. Du coup, cette voile change de nom et se dénomme dorénavant la brigantine, à la charnière des années 1800.
 |
| (56) HMS Victory au mouillage - peinture de Gardner |
Le Victory et le brick, à l’arrière plan, matérialisent parfaitement la nouvelle disposition de la brigantine d’artimon. A noter, cependant, que le Victory a eu droit à un réaménagement, car datant de 1765, il comportait initialement, si ma mémoire est bonne, une orse complète.
Pour maintenir toutes ces structures, grimper dans les hunes et manœuvrer les voiles, le marin, roi du bout de ficelle, met en place tout un réseau complexe de cordages, de manœuvres et de poulies. Evidemment, chacun d’entre eux à sa dénomination précise mais comme je n’ai pas l’intention de vous rédiger un lexique de marine, je vais juste vous indiquer que tout ce qui est fixe, comme les haubans s’appelle une manœuvre dormante, tout ce qui peut se haler ou se choquer, comme les écoutes de voile, est désigné manœuvre courante.
Pour clore ce chapitre sur le gréement, je vous glisse encore une peinture de Gardner – il a beau être anglais, çà a de la gueule !- qui se situe vers la fin du XVIIIème. Probablement d’avant la Révolution car la frégate française arbore le pavillon et la flamme de guerre « drap lit », comme disent les Brits, jamais avares de compliments, en désignant notre ancien pavillon royal. Le Français comporte encore une civadière sous le beaupré et l’Anglais, un artimon dit « à l’anglaise ».
 |
| (57) Combat naval - Peinture de Gardner |
La coque
Récapitulons, nous avons quatre mâts, une bonne douzaine de voiles et un énorme tas de ficelles. Nous allons essayer de caser tout çà quelque part ! Si déjà c’est sensé aller sur les flots, vaudrait mieux prévoir une construction qui flotte.
Si les mâts sont en sapin, la coque, elle, est construite en bois de chêne. La construction d’un vaisseau nécessite trois à quatre mille fûts de chêne. Autant dire que pour construire une flotte de vaisseaux, les forêts royales sont mises en coupe réglée. Dès le secrétariat de Colbert, les fonctionnaires des Eaux et Forêts arpentent les chêneraies pour sélectionner les troncs les mieux adaptés et ceux offrant des formes particulières.
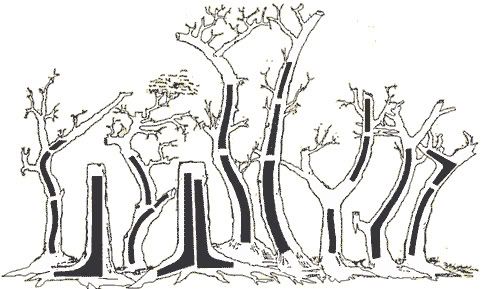 |
| (58) Troncs de chêne de formes remarquables. |
Assez rapidement, on stocke à l’avance, les troncs coupés qui subissent, pour les sapins, des trempages prolongés dans de grands bassins –fosses aux mâts-, pour en exprimer la résine et conserver leur souplesse, et pour les troncs de chêne, un séchage en plein air sous des préaux ouverts à tous vents. Le bois sec n’a pas tendance à travailler, une fois mis en place, et il produit, à l’impact des boulets, moins d’éclats et d’esquilles, dangereux projectiles qui sont cause de nombreuses blessures graves voir mortelles. Mais ces deux procédures, le trempage et le séchage, gourmandes en temps, ne sont pas toujours réalisables et durant certains conflits de longue durée, comme les guerres de la Révolution et du Premier Empire, il faudra se résoudre à utiliser du « bois vert ». La complexité de la construction des vaisseaux et le nombre de corps de métiers nécessitera la création des arsenaux nationaux, qui seront, pour l’époque, les premiers exemples d’entreprise technico-industrielle de grande dimension.
Comme nous sommes sur un site de maquettistes, ouvrons la jolie boite offerte par Tonton Marcel et attaquons le montage de la coque. L’épine « ventrale » du vaisseau est la quille qui se termine, à l’avant, par l’étrave ou coltis, à l’arrière par l’étambot.
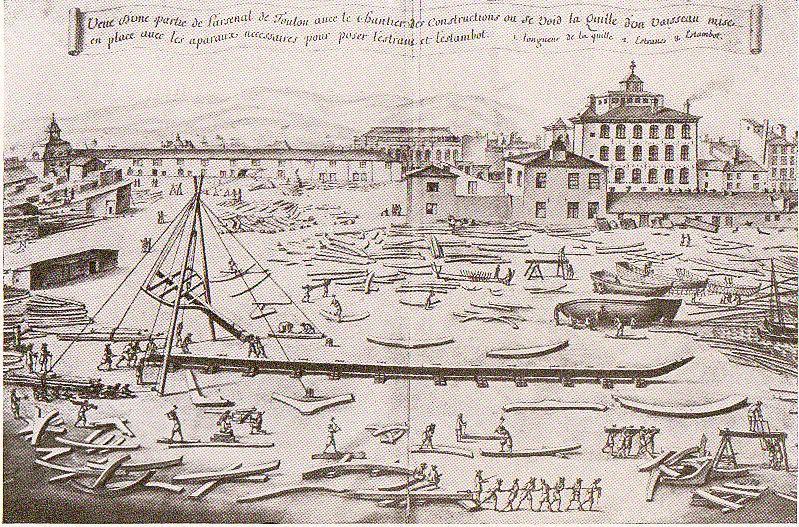 |
| (59) - Mise en place de l'étambot d'un vaisseau - Arsenal de Toulon - Bibliothèque du Service Hydrographique de la Marine. Avouez que çà ressemble curieusement au capharnaüm qui règne sur votre établi préféré. |
Entre l’étambot et le coltis, on dispose des couples qui sont au navire ce que sont les côtes à la cage thoracique. A la fin du XVIIIème siècle, sur le vaisseau de 74 type Sané, les couples sont larges de 70 cm et la maille, espace entre les couples, est de 12 cm, en général, selon le type de bâtiment, elle n’excède pas 50 cm. A la hauteur des mats, les couples sont doublés. Le couple dans la plus grande largeur du navire est dénommé maitre-couple. Des bordés horizontaux viennent se fixer de part et d’autre des couples. A l’intérieur, c’est le vaigrage, à l’extérieur, le bordage. La muraille d’un vaisseau, bordage hors de l’eau, atteint facilement 70cm d’épaisseur, voir les dépassent.
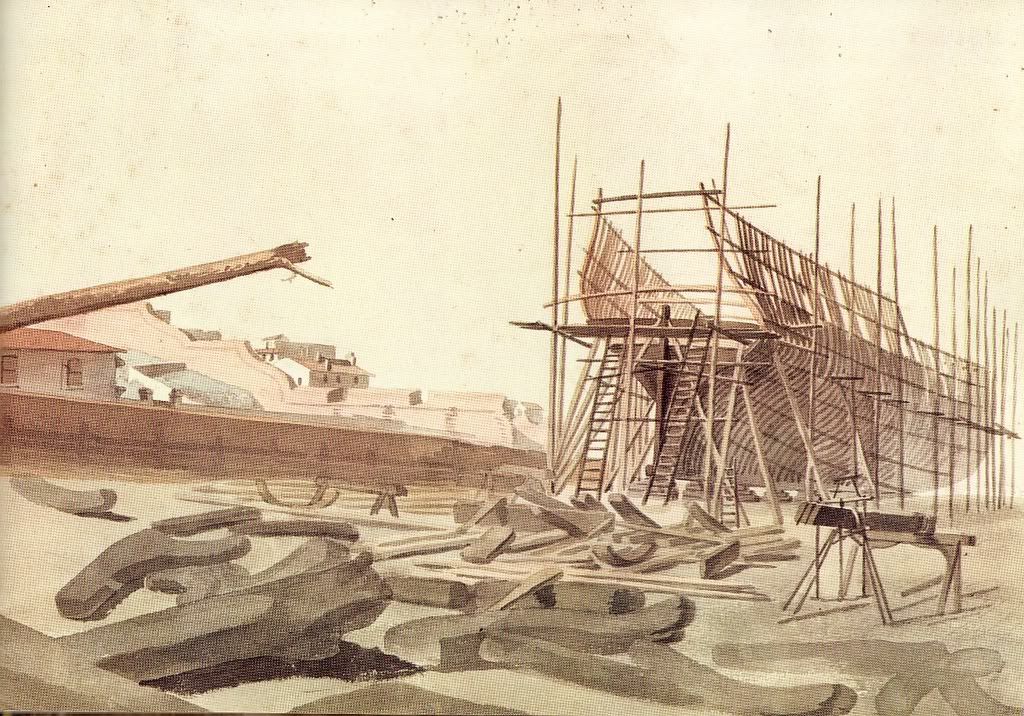 |
| (60) - Chantier naval de Marseille - Aquarelle d'Antoine Roux – 1809 |
Une curiosité, le navire est construit la proue dirigée vers la mer. Disposition assez rare pour l’époque où les bâtiments sont généralement lancés par l’arrière. Pour les marseillais curieux, ce chantier était installé à l’extrémité gauche du Vieux Port, à l’emplacement actuel de l’échangeur du tunnel. C’était le chantier Plan-Fourmigier et il semble qu’une rue du coin porte ce nom-là.
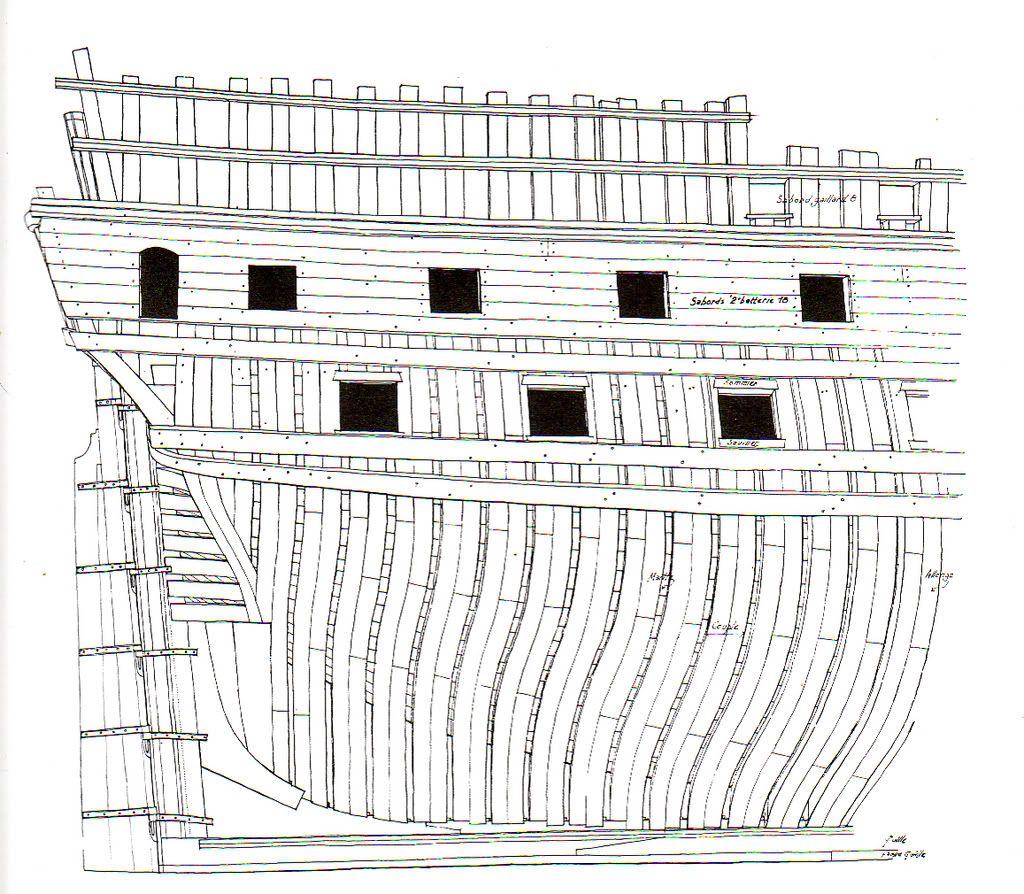 |
| (61) Détails de construction de la poupe d'un 74 |
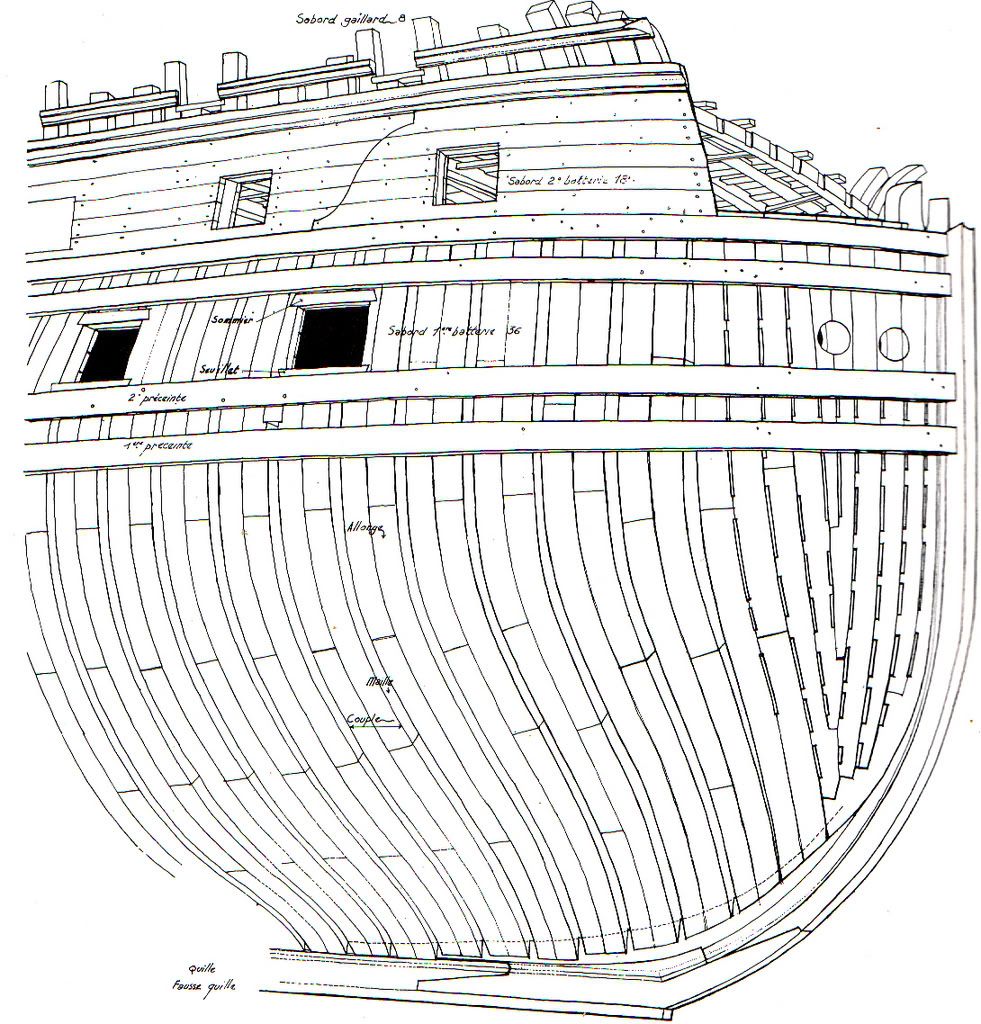 |
| (62) Détails de construction de la proue d'un 74 |
Sur les deux croquis ci-dessous, les bordées extérieures ne sont pas encore en place. Elles permettent d’avoir une idée de la technique de construction.
Sur les grands bâtiments, la technique nordique de la construction à clin a été abandonnée. Cette disposition consistait à superposer les virures – suite de planches longitudinales - comme les tuiles d’un toit. Elle améliorait l’étanchéité de la coque mais n’était plus exploitable en raison des épaisseurs employées et de l’apparition des sabords d’artillerie. C’est d’ailleurs encore un coup des Anglais, durant le XVIème siècle. Les planches sont donc posées, selon la technique méridionale du bordé à franc-bord, bout à bout dans la longueur et se succèdent tranche à tranche en hauteur. Pour étanchéifier l’ensemble, les ouvriers utilisent de l’étoupe qu’ils insèrent dans les coutures (l’interstice séparant deux planches) et de la braie que vous connaissez mieux sous le nom de goudron.
Pour installer les ponts et éviter que les couples, en travaillant, s’écartent, on dispose transversalement des baux ou barrots. Ce sont de solides poutres de bois qui viennent se relier aux couples. Cà assure la cohésion de la construction et permet au navire de garder sa forme initiale, ce qui, vous l’avouerez, est indispensable sous peine de terminer la croisière à la nage.
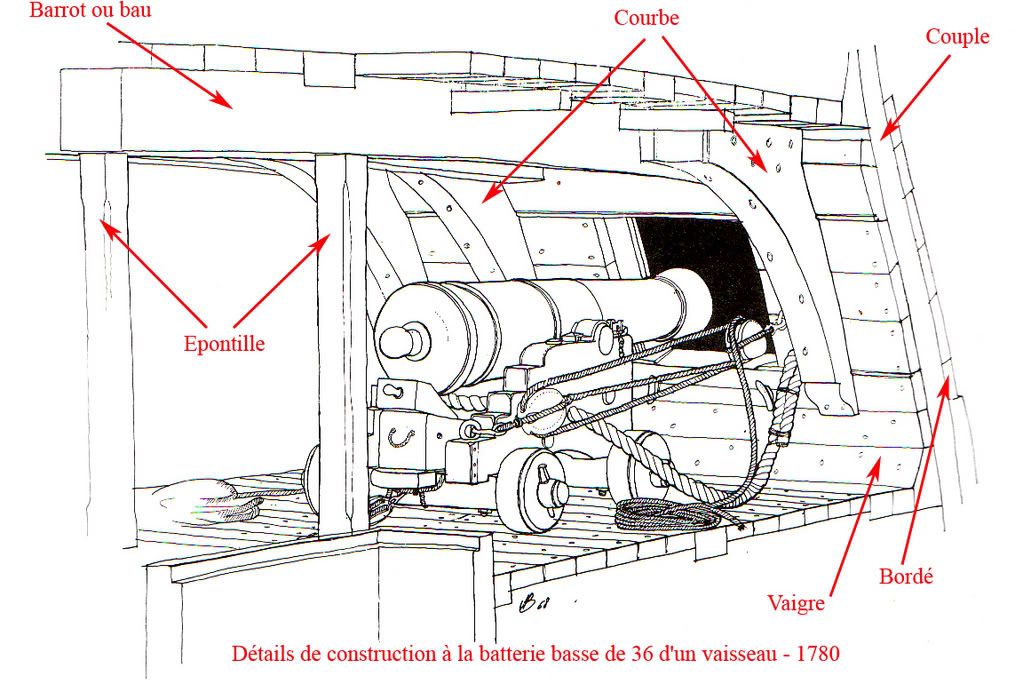 |
| (63) Détails de construction – poste d’une pièce de 36 en batterie basse – 1780. |
Très rapidement, la longueur des vaisseaux est définie par le nombre de sabords, leurs dimensions et leur écartement. Seules, les dimensions ultimes de la poupe et de la proue sont, en théorie, laissées au bon soin et à l’inspiration du constructeur ou de l’architecte. Comme la construction en bois montre ses limites, dépassée la soixantaine de mètres, l’inventivité affiche vite les siennes.
Dans la Royale, le règlement de 1762 fixe les dimensions précises des sabords en fonction du calibre. Elles resteront en vigueur jusqu’à la fin de la marine de guerre en bois.Prenons un exemple :
Canon de 36 à la première batterie, la plus basse. Le sabord fait 100 cm de large pour 92 de haut, la distance bord à bord entre chaque sabord de 36 est convenue à 2,29 m. Donc sur un bâtiment percé à 15 (sabords) dans sa batterie basse, çà nous donne : 15 x 100 + 14 x 229 – Oui, c’est ce truc enquiquinant des arbres et des espaces de votre fiston en CE 1!-...résultat, 1500 + 3206 = 4706, soit plus de 47 mètres pour obtenir un rectangle flottant ! Si nous voulons obtenir un truc à peu près naviguant, il faut rajouter de 3,50 à 3,90 m entre le dernier sabord et l’étambot et le double, 7 à 8 m, entre le premier sabord et l’étrave. Je reprends mes 47 mètres, je lui ajoute les données ci-dessus…47 + 3,50 + 7 = 57,50 mètres et pas loin de 59 mètres avec les données maximales. En réalité, un vaisseau ayant tendance à avoir une forme évasée vers le haut, les plus grandes longueurs se situent entre 61 et 64 mètres, à la hauteur du troisième pont et du gaillard sur un trois-ponts à la fin du XVIIIème et au XIXème siècle.
La largeur tient également compte, à la fois, de l’artillerie embarquée car une pièce de 36 à un recul de 4 m et des qualités nautiques souhaitées du vaisseau qui impliquent un rapport de largeur/longueur de l’ordre de 1:4, soit une largeur de l’ordre de 16 m au maitre-bau.
Une autre dimension prise en compte est le creux, c’est la distance séparant le plancher de la batterie la plus basse de la quille. Entre la fin du XVIIème et le milieu du XVIIIème, il évoluera de 5,60 m à 8,12 m. Durant la même période, la mâture s’est élevée et s’est alourdie, nécessitant l’abaissement du centre de gravité du bâtiment. Pour la même raison, la hauteur des batteries basses est limitée à 1,60/1,70m sous barrots, les poutres transversales. Dans le feu de l’action, l’énumération du nombre de tronches fracassées sur ces redoutables obstacles nécessiterait un gros volume à elle toute seule ! Cà va de la grosse bosse douloureuse à la fracture du crâne mortelle.
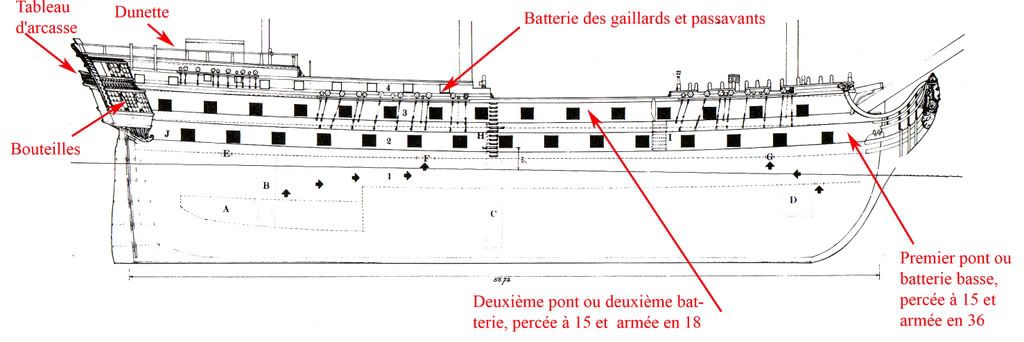 |
| (64) Le Pompée - Deux-ponts de 74 de type Sané - Lancé en 1790, rayé de l'active en 1793 |
On peut facilement matérialiser l’évolution des dimensions avec un vaisseau à trois-ponts type, le Royal Louis, dont quatre exemplaires seront construits entre 1668 et 1780. Comme nos bons Roys avaient la fâcheuse habitude de se refiler le même prénom, je les ai numérotés.
Royal Louis (I) – 1668 – 2400 t – L : 52,97 – l : 14,30 – creux : 6,74 – 120 canons
Royal Louis (II) – 1692 – 2600 t – L : 57,20 – l : 15,60 – creux : 7,47 – 110 canons
Royal Louis (III) – 1759 – 3000 t – L : 61,75 - l : 16,73 – creux : 7,96 – 116 canons
Royal Louis (IV) – 1780 – 3000 t – L : 60,12 - l : 16,25 – creux : 7,96 – 110 canons
Au tout début du XIXème siècle, les plus grands trois-ponts français ont été lancés sous la Révolution et le Consulat. L’Océan construit à Brest en 1790 et le République Française, à Rochefort en 1802, affichent 63,86 m de long, 16,25 m de large, 8,12 m de creux et portent 118 canons selon le règlement de 1786.
Au début du XVIIème siècle, les vaisseaux se distinguent par une proue assez basse encombrée d’un château avant et par une poupe élevée. Cette disposition nécessite l’emploi de ponts en escalier fortement inclinés dans l’axe longitudinal.
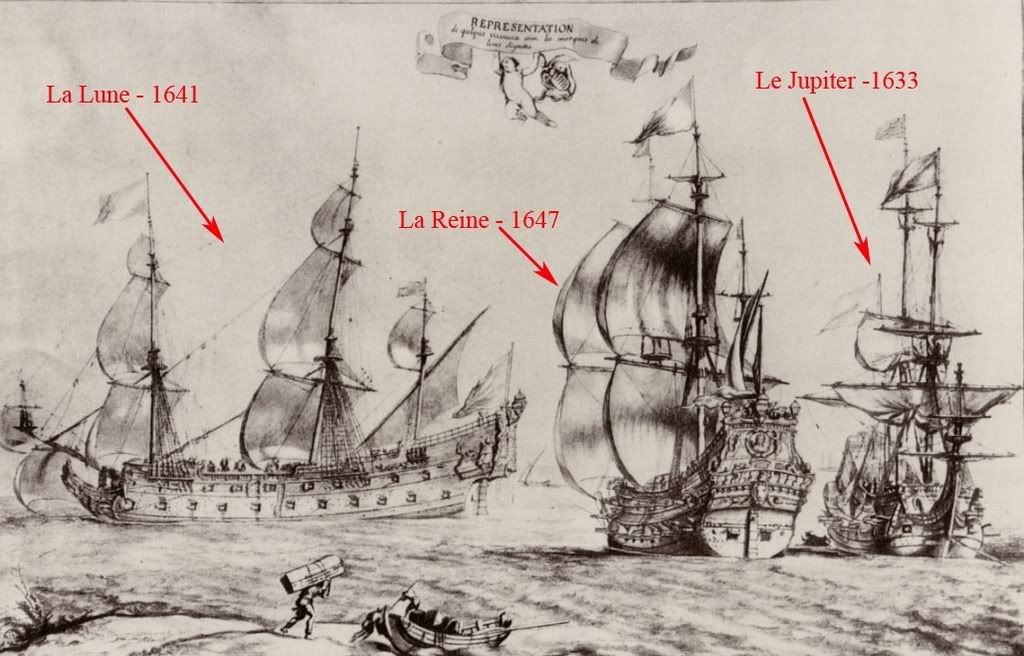 |
| (65) Vaisseaux - Milieu du XVIIème - P.Puget (1620-1694) |
Au cours des décennies, la proue s’élève, la poupe s’abaisse et la ligne générale des bâtiments tutoie l’horizontalité au tournant du XIXème siècle.
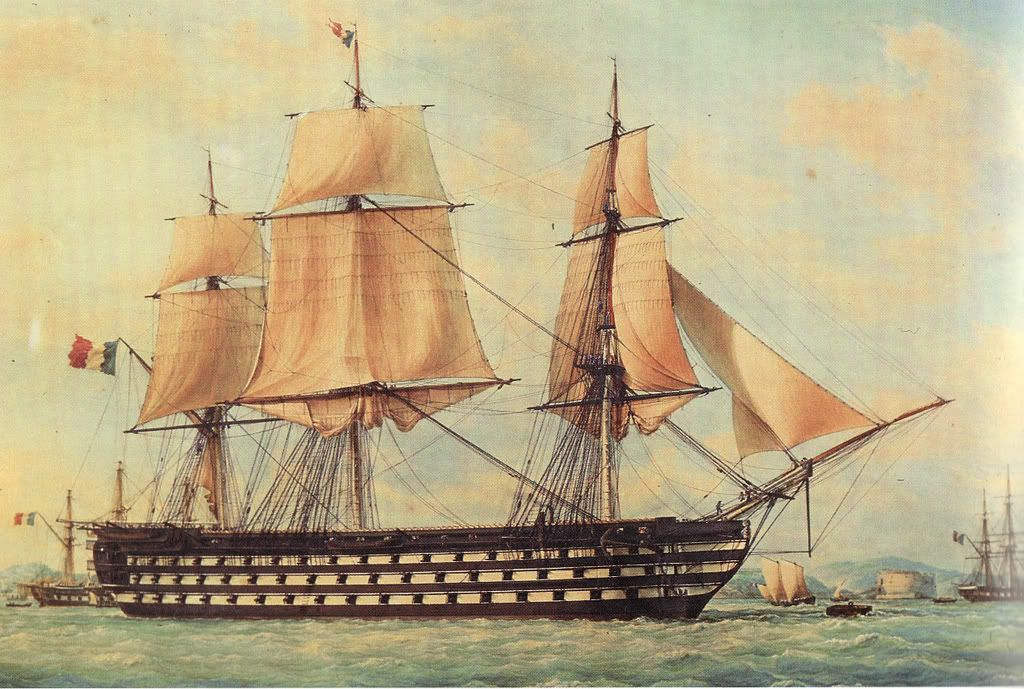 |
| (66) Trois-ponts de 1er rang (1840) - Aquarelle de François Roux - Musée de la Marine. |
Le château avant est un vieux reste de la caraque moyenâgeuse et est principalement destiné à y installer une artillerie de chasse, qui tire dans l’axe du navire, à l’instar des galères. De toute façon, cette disposition reste limitée à quelques pièces, généralement quatre, sans grand pouvoir destructeur. Les Anglais, encore eux, inaugurent dès 1665, au combat du Texel, la disposition des vaisseaux en ligne de file, on y reviendra. Toutes les marines occidentales leur emboitent le pas et les quelques pièces dans l’axe du navire perdent tout intérêt. Mais les traditions ont la vie dure dans la marine et le coltis, muraille frontale, perdure encore un bon siècle. Ce n’est qu’à l’extrême fin du XVIIIème que le coltis perd son usage militaire.
En attendant, les constructeurs se retrouvent avec un avant tronqué à façade droite et une guibre, la partie saillante de l’étrave, qui pointe comme une malheureuse esseulée à son extrémité. En plus, il y a ce fameux mât de beaupré, décrit au chapitre précédent, qui se dresse en oblique à l’avant du navire. Force est donc de réaliser un bricolage pour rendre tout çà à peu près rationnel. Il faut que les fameuses pièces d’artillerie installées tout à l’avant, sur le coltis, aient une zone de tir dégagée, que la liaison étrave-coque soit suffisamment profilée pour fendre les flots et que cette construction soit suffisamment robuste et esthétique. Les virures basses se cintrent de part et d’autre de la coque et viennent se fixer sur l’étrave. Jusque-là, çà baigne. Par contre, il n’est pas question de procéder de même en partie haute car on va boucher la vue des pièces de chasse et on a toujours cette guibre qui s’entête à frimer toute seule à l’avant. Tout le monde se creuse la tête, puis on installe des planchers ou des caillebotis pour faciliter l’accès au mât de beaupré, çà peut toujours servir, et on essaye de cacher la misère avec des planches gracieusement incurvées, les herpes. On y ajoute un peu de sculptures, deux ou trois tritons, quelques feuilles d’acanthe, de la dorure à la feuille mais pas trop quand même car le coin n’est guère fréquenté par l’état-major. L’équipage se marre, baptise le coin, les poulaines, car sa forme rappelle les vieilles godasses moyenâgeuses, et se voit attribuer ce superbe espace pour y faire ses besoins et laver son linge. Vu sa position particulière, il n’est pas nécessaire d’y réclamer l’eau courante, elle y est déjà…surtout par mer formée !
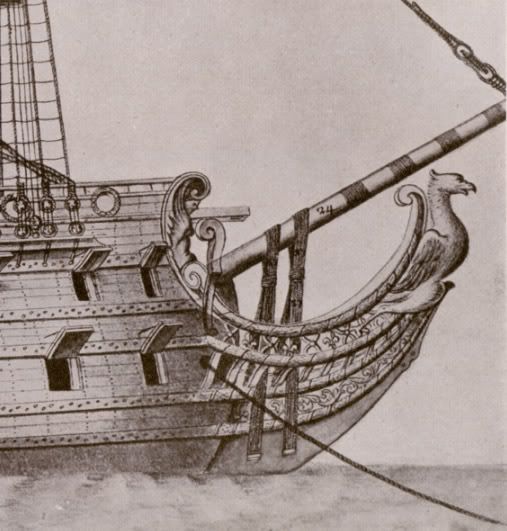 |
| (67) Proue - vue de tribord - Atlas Colbert – Fin XVIIème. |
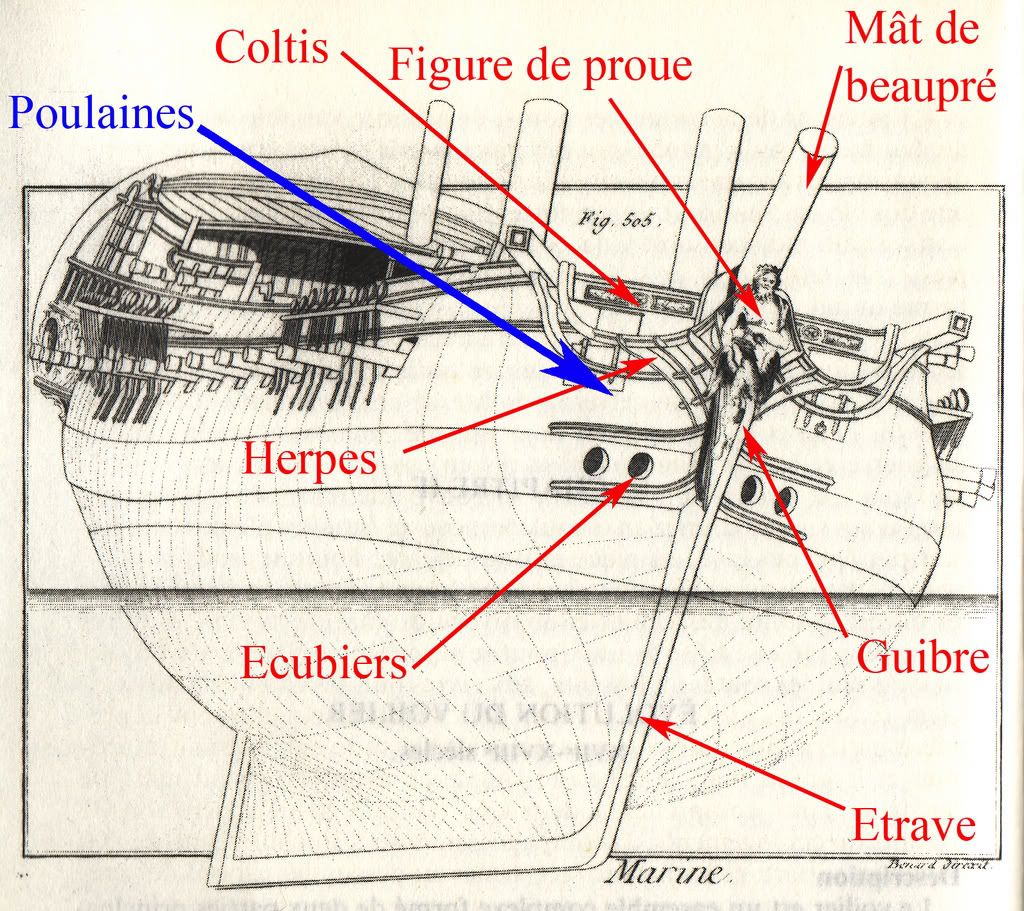 |
| (68) Coque d'une frégate de 28 vue par la proue - Encyclopédie méthodique marine – 1783. Vous noterez l’évolution de la proue même si le coltis est toujours en vigueur. |
A l’arrière, ce n’est guère mieux, on a bien mis le holà dans la terminaison en sucette des galions mais la poupe ressemble à un diapason flottant. Le château arrière débute quasiment au pied du grand mât et, par une succession de ponts intermédiaires, pour éviter des pentes dignes de l’Himalaya, se transforme en échafaudage pour peintre. En fait, les seuls satisfaits de cette disposition sont les sculpteurs qui disposent d’un magnifique tableau –c’est le terme employé- pour y cloquer, qui un soleil majestueux, qui un Neptune au trident menaçant. Sinon, c’est trop haut, çà nuit à l’équilibre du bâtiment, çà met un souk pas possible dans la répartition de l’artillerie des gaillards…plus çà grimpe, plus le calibre diminue pour des questions de poids et on se retrouve avec des escopettes tout juste bonnes à chasser les mouettes. Mais il faut de la place pour loger ses beaux messieurs…Du coup, on fait une croix sur la hauteur et on en profite pour se prendre de l’embonpoint dans le sens de la largeur, en y ajoutant des petites tourelles, baptisées bouteilles qui servent, la plupart du temps de lieux d’aisance pour l’état-major et des balcons pour que le tout-puissant maitre du navire puisse y fumer tranquille sa pipe ou son cigare. Sous Louis XIV, le château arrière est constitué de trois étages. Au XIXème siècle, le gaillard d’arrière n’est plus qu’un entresol ou un rez-de-chaussée dans le prolongement du pont.
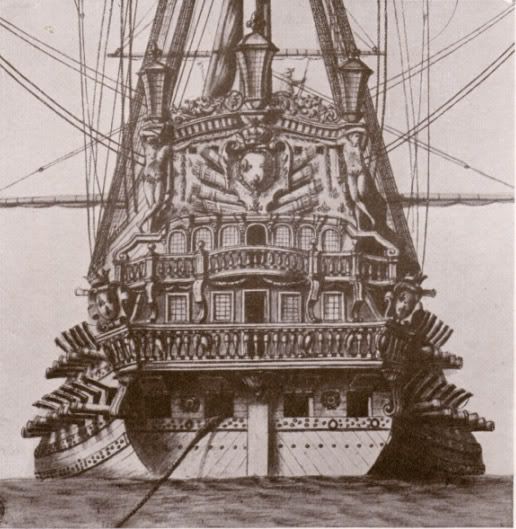 |
| (69) Poupe - Atlas Colbert |
Au cours des décennies, les balcons disparaissent puis refont surface mais intégrés dans le tableau. Dans les années 1840, ils seront construits en ferrailles comme de vulgaires balcons d’HLM.
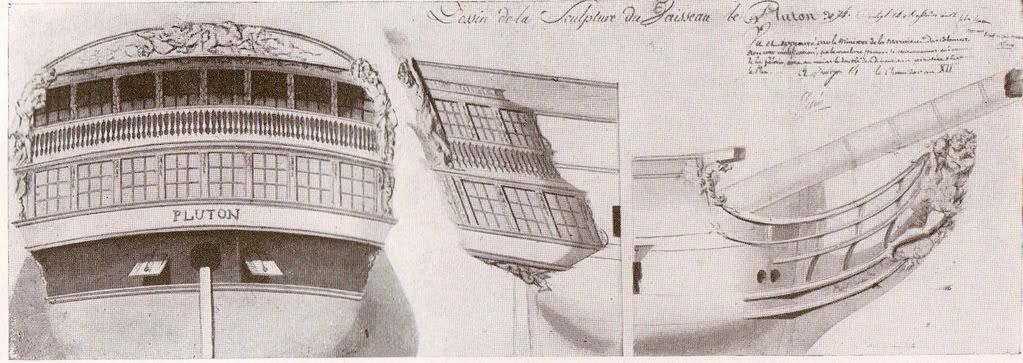 |
| (70) Proue, poupe et bouteilles du vaisseau Le Pluton – 1804 |
C’est la disposition standard de la poupe des vaisseaux de type Sané, construits dans les années 1800.Au passage, vous pouvez vérifier l’évolution de la proue.
Le dessin du tableau arrière évolue progressivement de la forme en diapason, adoptée au XVIème siècle, à celle du fer à cheval inversé, conception, pour une fois typiquement française, que les autres marines reprendront à leur compte.
Quand je comparais la poupe des vieux vaisseaux à un diapason, vous avez du remarquer que le gouvernail y faisait aussi office de manche. Vous avez, sans aucun doute, remarqué également que le château arrière dépasse de la coque. Cà va nous permettre de traiter deux problèmes en même temps. La dernière fois que vous avez canoté sur le petit lac près de chez vous, comme vous êtes extrêmement galant, vous vous êtes coltiné les rames et avez élégamment confié la barre du gouvernail à votre copine. Vu les dimensions de la coque de noix, cette barre est tout simplement un manche perpendiculaire qui surplombe le tableau arrière et est relié au gouvernail extérieur. Il suffit de pousser à gauche ou à droite pour modifier la trajectoire de l’esquif. Maintenant, considérons les dimensions d’un navire de haute-mer. On peut difficilement y adopter la même configuration. La barre pénètre donc à l’intérieur du bâtiment, au-dessus de la ligne de flottaison, à travers le tableau. Si on conserve la disposition de notre petite barque de location, on se retrouve avec une grande ouverture horizontale dans le tableau pour pouvoir orienter le gouvernail. Sur un plan d’eau pour canards parfaitement calme, çà ne pose aucun problème mais en pleine mer, c’est une autre paire de manches. Au tangage, nous d’embarquerons, à coup sûr, des paquets de mer par cette ouverture. On va bien essayer de limiter les entrées de flotte en disposant des pièces en cuir ou en inventant des palliatifs mais çà reste un problème. A première vue, çà parait insoluble… Puis, quelques petits gars futés trouvent la solution. Le château arrière surplombera dorénavant l’arrière du navire et son gouvernail. Du coup, l’extrémité supérieure de ce dernier entre dans le « plancher » du château et il suffit d’un orifice circulaire facilement étanchéifiable, la jaumière, pour le manœuvrer. Ce dispositif est toujours en application de nos jours sur les navires de surface.
Restons encore quelques instants à l’arrière. Les premiers vaisseaux ont un étambot rectiligne, comme notre barque louée pour une demi-heure. On parle de poupe carrée. Ce tronquage brutal crée des tourbillons et ralenti la marche. Encore une fois, les Anglais, dès 1673, inaugure une nouvelle disposition et les bordés inférieurs immergés et au-dessus de la ligne de flottaison viennent s’incurver sur l’étambot. Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, la plupart des marines occidentales vont adopter cette disposition. Le tableau arrière du château restera longtemps droit, puis, les « fesses rondes » apparaitront, de l’autre côté de la Manche, après les guerres napoléoniennes. En France, Le Valmy lancé en 1847, mais dont la construction avait débutée en 1838, conserve un tableau droit. L’Arsenal de Toulon étudie, en 1847, un programme de modification intitulé « Transformation des poupes carrées en poupes rondes » mais, entre temps, la propulsion à vapeur et hélice fait son apparition et, seules, quelques unités sont modifiées.
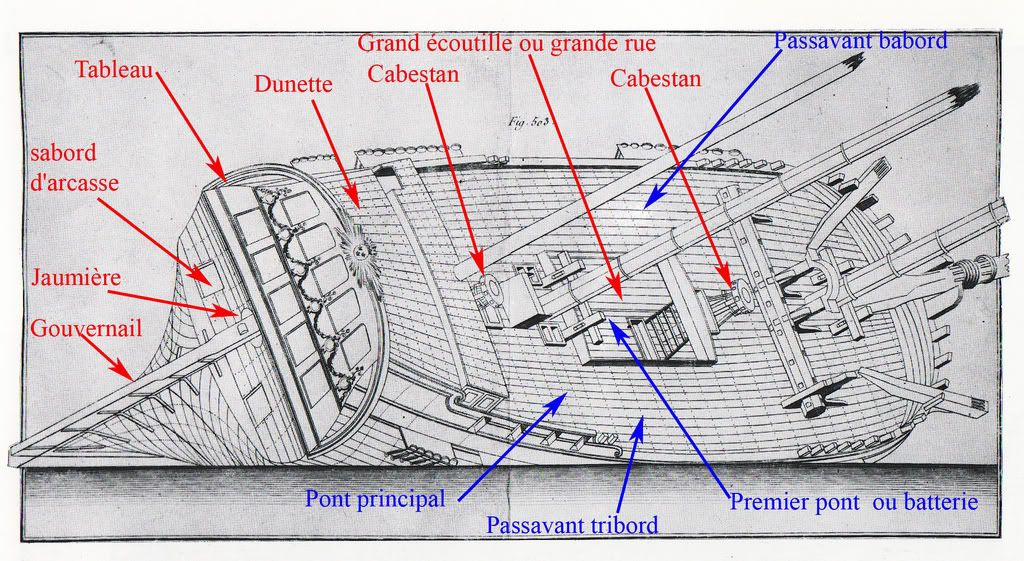 |
| (71) Vue arrière des dispositions d'une frégate abattue en carène. |
Je ne peux achever ce chapitre sur la coque sans évoquer le problème du doublage des fonds. La partie immergée de la coque, également dénommée les œuvres vives, est enduite de goudron. Mais ce dernier se désagrège peu à peu dans l’eau de mer et la coque a la fâcheuse propension à développer la culture des algues et l’élevage de coquillages parasites comme les bernicles. Résultat, au bout de quelques mois de mer, la coque s’orne d’une splendide chevelure d’algues interminables, l’équipage, s’il a un peu de temps, peut se consacrer à la conchyliculture mais votre superbe navire se traine comme un malheureux sabot. De plus, dans les mers chaudes, les tarets, une saloperie de mollusque, bouffent le bois de la coque à une vitesse pharamineuse. Pour tenter d’y remédier, on procède au brossage régulier de la partie immergée de la coque mais, seul, un abattage en carène (voir dessin au-dessus) permet un récurage correct. On adopte alors un doublage du bordé en rajoutant une couche supplémentaire de planches, c’est un pis aller. Puis on se rend compte que les coquillages et les algues prolifèrent moins et plus lentement sur le métal. On procède alors au mailletage, opération fastidieuse qui consiste à recouvrir la carène d’une succession de clous. La solution viendra, devinez d’où ?...des rivages de la Perfide Albion ! Elle consiste à doubler la coque en y clouant de minces feuilles de cuivre ou de laiton. Le cuivre poli améliore la « glisse » de la coque dans l’eau, se salit beaucoup plus lentement que le bois et est totalement indigeste pour l’estomac des mollusques. A partir de 1780, l’emploi du doublage cuivre devient systématique.
La Peinture
Je viens de me rendre compte que la coque de notre bâtiment n’est même pas peinte. Opération indispensable avant sa mise à l'eau. Je sors donc les pots de peinture et les pinceaux et nous allons immédiatement nous mettre à la tâche.
Au XVIIème siècle, les bordés sont badigeonnés d’un enduit résineux plus ou moins transparent ou carrément avec du goudron. Sous le règne du Roi-Soleil, la plupart des marines laissent aux capitaines le choix de la couleur des murailles. La proue et surtout la poupe avec son tableau sont chargées de sculptures généralement dorées à la feuille d’or. Cependant, en période de restriction économique, la feuille d’or laissera parfois la place à une bête peinture jaune qui tente d’imiter la teinte du luxueux métal. Les coques sont enduites de peintures vives. Le bleu et le rouge contrastent harmonieusement avec les dorures. Comme on a vu précédemment, les proportions du château arrière sont revues à la baisse et la densité des ornements et sculptures diminuent. Pour mieux les faire ressortir, elles sont mises en valeur par un fond de peinture contrastée, noire chez les Brits et bleue en France. Durant une courte période, sur certains navires prestigieux, des « guirlandes » de sculptures dorées, dans l’esprit de la poupe, s’alignent tout le long des flancs, rehaussent le contour des sabords puis cette mode tombe en désuétude. Au XVIIIème siècle, on sort les cordeaux et on trace des bandes de couleurs le long de la coque qui est généralement de couleur bois, la teinte varie entre le chêne clair et le bois sombre. En France, sous le règne de Louis XV, la muraille est bleu, les lignes de batteries marron et les mantelets de sabords peints en rouge. Chez les Anglais, les bandes sont noires ou rouges durant la Guerre d’Indépendance des futurs Etats-Unis d’Amérique. Durant la Révolution, les couleurs jaunes et rouge se généralisent. Ces bandes ou listons s’alignent logiquement sur les lignes de sabords.
 |
| (72) Frégate anglaise de 18 HMS Diane, construite en 1794 – Décoration typique des années 1790. |
Les documentations en couleurs sur les bâtiments de l’époque ne sont pas légions et j’ai dû me rabattre sur la couverture d’un bouquin anglais « Anatomy of the Ship » - Conway Maritime Press.
C’est au tournant du XIXème siècle, que le « damier Nelson » (encore lui !) fait son apparition chez nos voisins. Sur une coque peinte en noir, les lignes de batteries sont badigeonnées en ocre jaune, bordées de part et d’autre par un liseré blanc et les mantelets sont de couleur noir. Cette disposition est également adoptée par la Marine Impériale française et la livrée la plus courante de ses bâtiments consiste en des bordés de couleur chêne foncé avec des lignes de batteries rehaussées en beige.
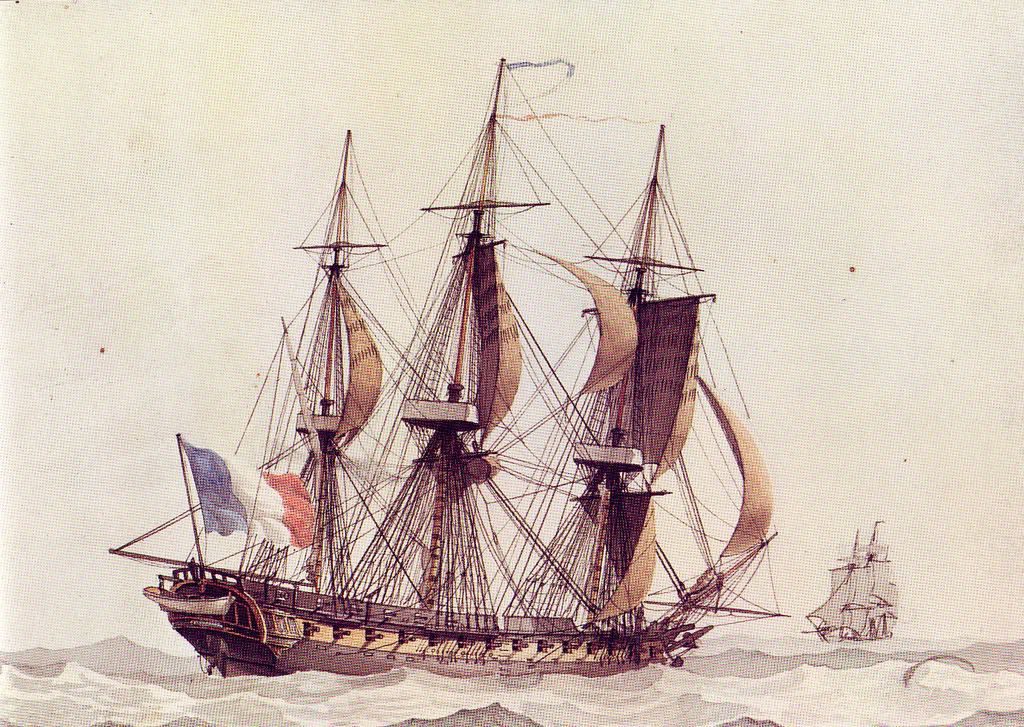 |
| (73) Frégate française de 18 - 1799 - Aquarelle d'Antoine Roux |
On rencontre cependant, à l’époque, des cas particuliers comme le vaisseau-amiral de la flotte espagnole, leSantissima Trinidad, monumental trois pont de 136 canons, qui combattra à Trafalgar, en 1805, avec l’escadre de Villeneuve. Ses lignes de batteries sont rouges, surlignées de blanc à la partie supérieure.
 |
| (74) Trois-ponts espagnol Santissima Trinidad. Huile de Geoff Hunt |
Sous la Restauration, La Royale adopte le style «british», la teinte bois foncé fait place au noir et les lignes de batteries sont peintes en blanc. Ces dispositions seront conservées jusqu’à l’apparition de la «Marine en Fer». Avec l’apparition des «culs ronds», évoquée plus avant, dans les années 1840, les lignes blanches des batteries feront le tour complet des bâtiments, sans égards pour les rares dorures encore existantes.
 |
| (75) Le Napoléon - Vaisseau à hélice de 94 canons, lancé en 1850 - Aquarelle de François Roux (le fils d'Antoine!) |
Ces pots de peinture rouge sombre vous intriguent? Il nous reste encore les planchers des batteries à peindre! Vous comprenez mieux le choix de la couleur, n’est-ce-pas? L’intérieur des murailles (le vaigrage) est parfois recouvert de cette peinture, au moins jusqu’au haut des sabords. Bien que non systématique, cette pratique perdurera jusqu’au début du XIXème siècle. Par contre, elle ne concerne pas les gaillards et la dunette, le bois de ces ponts garde sa couleur naturelle et même vire au blanc sous l’effet des multiples lavages et brossages quotidiens. La Royal Navy adopte même l’expression, brossé à blanc, pour définir l’état de propreté de ses ponts.
Décors, ornements, sculptures et remarques diverses
Je vais revenir, l’espace d’un petit chapitre, sur deux parties de la coque déjà évoquées plus haut, la proue et la poupe des navires. Ce sont les terrains de prédilection des artistes-sculpteurs et, comme déjà vu, l’évolution de leurs formes est directement liée à celle de la ligne générale du navire qui se veut, au cours des décennies, plus fonctionnelle, meilleur tenue à la mer, moindre prise au vent, meilleure disposition des batteries.
Le Service Historique de la Défense (SHD) a eu l’heureuse initiative de mettre en ligne, sur son site, un grand nombre d’anciens plans exécutés par les arsenaux français. Pour tout passionné d’histoire et d’architecture navale, c’est une véritable mine d’or, d’autant plus que dans les années 1830-1840, les bureaux de dessins se sont attachés à redessiner des tracés datant de la fin de l’Ancien Régime et de la période Révolution-Premier Empire. Le seul petit problème mais il est de taille, c’est le cas de le dire, c’est justement les dimensions de ces plans, qui peuvent atteindre 1,75 m de large!… De plus, ils ne sont disponibles qu’au format TIFF, une pure horreur à exploiter. Néanmoins, à l’aide d’un excellent logiciel bien connu de traitement d’images, il est possible de les convertir en fichiers JPEG et d’en exploiter certains détails. Corvée déconseillée aux personnes pressées ou débordées de boulot. Les images postées ci-après proviennent de montages réalisés à partir de ces plans (les références sont mentionnées en noir).
Nota : les vues numérotées 76-77-78 sont sensiblement à la même échelle.
Nous allons, d’abord, nous intéresser au château arrière, la partie la plus remarquable de la coque.
 |
| (76) Comparatif de l'évolution des poupes de vaisseaux (I) |
Cette vue arrière permet d’apprécier l’évolution des formes sur une période d’environ quatre-vingt ans.
1) Le Redoutable (environs de 1730): Le château arrière présente encore la forme en diapason des constructions du XVIIème siècle. Les arcs-boutants du balcon tentent d’harmoniser l’ajout des bouteilles, excroissances rapportées de part et d’autre du château. Le vaste tableau d’arcasse, dominé par un monumental fanal de poupe, a permis à l’artiste d’y exécuter une sculpture de grandes dimensions dont le thème principal, emprunté à la mythologie, représente probablement une scène de lutte entre deux athlètes, l’un soulevant l’autre de terre... comme il y a de la place, pourquoi se gêner! Sur la façade du balcon, figurent les armes royales, écu fleurdelisé et, probablement, Ordre du Saint Esprit. Au niveau inférieur, dans un cartouche stylisé en drapé, décoré d’une tête de Neptune et d’un carquois, figure le nom du navire. A ce sujet, la France est la première nation, par une ordonnance de 1671, à faire figurer réglementairement le nom de baptême du bâtiment. Les Anglais traineront les pieds pendant un siècle avant de faire de même. En période d’opérations, le nom est souvent camouflé pour éviter l’identification.
2) L’Intrépide (environs de 1770): Le fanal de poupe, bien que de taille plus modeste, est encore présent mais le couronnement a été sérieusement revu à la baisse. Il n’est plus possible d’y faire figurer une scène épique. L’artiste en est réduit à ajouter quelques guirlandes de feuilles d’acanthes au chiffre du souverain régnant. Le blason royal, sur la façade du balcon, a subi, lui aussi une cure d’amaigrissement et il n’y figure plus qu’une seule fleur de lis. Itou pour le cartouche « L’Intrépide » ! Si Neptune a encore la chance d’y figurer, il est nettement plus petit, le carquois et le drapé ont disparu. A noter également, l’évolution de la carène, plus ventrue, le cintrage transversal des ponts et le dessin circulaire du tableau arrière et de son couronnement. Esthétiquement, c’est probablement l’époque où la poupe est la plus réussie.
3) Le Duquesne (environs de 1810): La décoration du château arrière est l’œuvre d’un maitre-sculpteur de l’Arsenal de Venise. La baume du mât d’artimon s’étant généralisée, dans un premier temps, les grands fanaux de poupe sont positionnés plus bas puis sont définitivement supprimés du couronnement. De surcroit, le balcon ayant disparu, pour mettre à l’eau les embarcations du bord, des bossoirs ou des porte-manteaux sont souvent disposés à l’aplomb du tableau arrière. Les sculpteurs se sont acclimatés aux faibles dimensions du couronnement, la décoration comporte des personnages assis, voir accroupis, les étendards et les canons flirtent avec l’horizontale. L’artiste s’est vengé en disposant deux tritons « portefaix » à la base du château. De part et d’autre des galeries, des faisceaux de licteurs associent des tridents et des ancres. En parlant de galerie, en cas de combat, les fenêtres étaient démontées et remplacées par de solides panneaux de bois. Les deux sabords de retraite qui figurent sur les deux bâtiments précédents disparaissent. De toute façon, vu leur position, il y a plus de chances d’embarquer des paquets de mer que de faire mouche. Par contre, dans la galerie basse, il est prévu généralement deux postes de tir pour pièce de retraite, sous réserve qu’on n’y trouve pas un de ces superbes balcons décorés qui seraient rapidement transformés en petit bois de chauffage dès la première salve. Les canons de retraite sont soit prélevés provisoirement sur la batterie contigüe, soit installées à demeure. Dans les frégates, cet emplacement correspond à la grande-chambre, qui sert, entre autres, d’appartement au commandant de bord, ils sont alors pudiquement habillés de housses plus ou moins luxueuses. J’anticipe un peu mais lors du branle-bas de combat, l’ensemble des séparations étaient démontées pour disposer de l’espace maximum pour la manœuvre des canons. Pour se faire, la plupart des cloisons, y compris celles du poste des officiers et du commandant, étaient soient constituées de rideaux, ou de toiles fixées sur des cadres amovibles ou de cloisons légères démontables en bois. Mobiliers, tapis de la grande-chambre, cloisons et rideaux, tout était stocké dans la cale durant les combats. Les grands navires de ligne, deux et trois-ponts disposent généralement de cloisons fixes entre la grande chambre et le reste du bâtiment
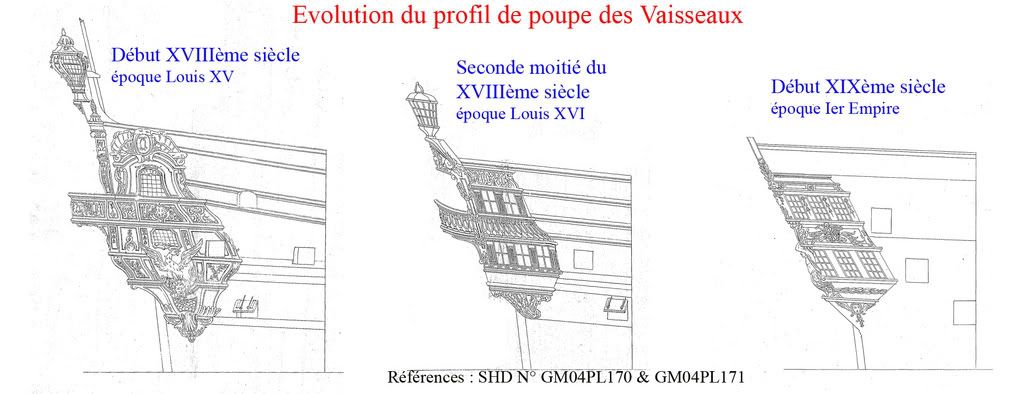 |
| (77) Comparatif de l'évolution des poupes de vaisseaux (2b) |
Les balcons et galeries de poupe apparaissent ou disparaissent au gré des modes. En fait, c’est « le nivellement par l’hypertrophie », l’espace libre entre le couronnement et le ou les balcon(s) se voit équipé de fenêtres, la galerie devient intérieure et le tableau d’arcasse plan (voir planche N° 77), puis, aux alentours des années 1840, des balcons en fer forgés font à nouveau leur apparition. Comparez les croquis N°77 avec celui ci-dessous.
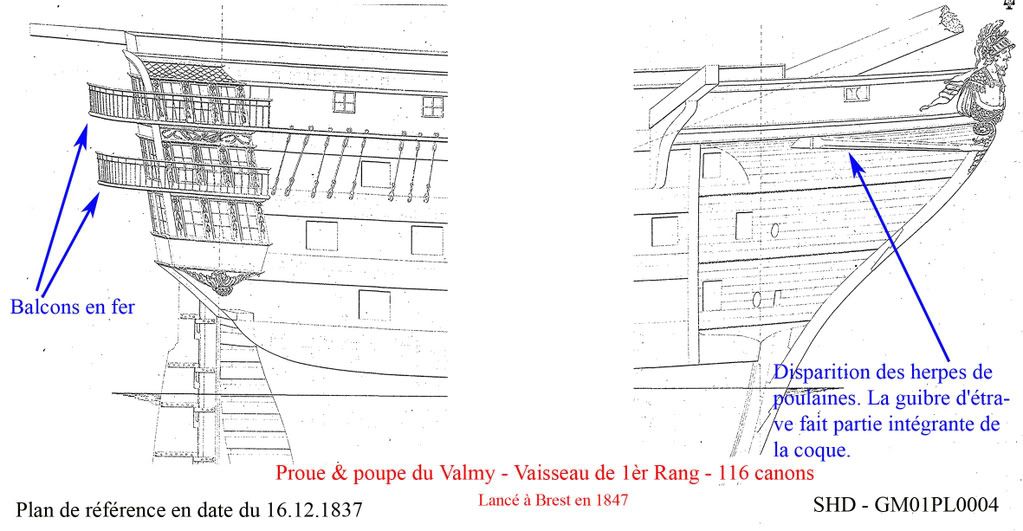 |
| (79) Proue & poupe du Valmy, lancé en 1847. |
Le cartouche.
Le cartouche où figure le nom du vaisseau mérite quelques explications. Hormis quelques navires hollandais, dans la seconde moitié du XVIIème siècle, qui arborent leur nom inscrit à la poupe, c’est le Royaume de France qui, à dater d’une ordonnance royale de 1691, inaugure l’emploi systématique du cartouche à la poupe de ses vaisseaux de guerre. Les Britanniques traineront les pieds pendant près d’un siècle avant de procéder de même, ne souhaitant pas faciliter le boulot des services de renseignement ennemis.
La plupart du temps, dans les différentes marines de l’époque, les noms de baptême des navires évoquent des dieux et divinités de l’Antiquité, ou se réfèrent à des qualificatifs virils et guerriers. En France, les vaisseaux étant du genre masculin, le qualificatif est, bien évidemment, de sexe male ou réputé tel tandis que les frégates et corvettes sont féminisées. Dans la ligne de bataille, on trouve pêle-mêle du Redoutable, de l’Inflexible, du Foudroyant, etc., tandis que les bâtiments « hors ligne » se voient baptisée Minerve (çà, ce n’est pas vraiment du bol, vu que les treize frégates françaises baptisée ainsi, finiront dans les mains anglaises et que ce n’est guère mieux pour celles lancées par les Britanniques), Thétis, Vestale, Valeureuse, Vengeance, Forte, etc.
Le 5 Septembre 1799 (19 Fructidor An7), sous le Directoire, le citoyen Boulay-Paty, rapporteur du budget de la Marine devant le Conseil des Cinq-Cents (l’Assemblée Nationale de l’époque), gros fayot devant l’Eternel (son rapport que j’ai déniché dans les trésors de la BNF est un vrai poème !) réclame à cette respectable assemblée que, dorénavant, les noms de héros et de grands faits d’arme (républicains, bien sûr !) soient attribués aux navires de guerre de la République. Comme çà ne coûte pas un rond, l’assemblée des Sages entérine immédiatement cette proposition. Ce qui est extraordinaire, c’est que ce rapport, établi quelques mois après la déculottée d’Aboukir, établit bien, au début, les carences de la marine française, responsables en partie de ce désastre, mais, dès qu’il s’agit de pognon à attribuer au Ministère de la Marine et des Colonies pour tenter de remédier à cette situation calamiteuse, là, çà coince et les coupes franches, aux justifications plus que douteuses, se succèdent, réduisant le budget-programme du Ministère à une véritable peau de chagrin, amputée de 50% de ses besoins chiffrés, alors que nous sommes en pleine guerre depuis 1792 ! En attendant, c’est à partir de cette date que la plupart des grands bâtiments français portent principalement des noms de personnages plus ou moins illustres et de fait d’armes militaires.
Je ne résiste pas au plaisir de vous asséner, avec l’orthographe de l’époque, le paragraphe du rapport s’y afférant.
« …Mais, en même temps, représentans du peuple,…il est de l’essence des imminentes fonctions que vous remplissez au nom du peuple français, de nommer chaque vaisseau dont vous ordonnez la mise sur les chantiers. C’est ainsi que vous en ferez une récompense nationale, qui ne doit être dispensée que par le Corps législatif, et qui deviendra un aliment de plus au courage et à la valeur des républicains ; c’est ainsi que vous célèbrerez les sacrifices généreux, les hauts-faits d’armes, les belles actions militaires, qui, depuis longtemps, n’ont de témoins que de vastes tombeaux appelés champs de bataille. Que la cendre du soldat, de l’officier, du général de terre et de mer, qui a signalé son triomphe ou sa mort par des traits de dévouement et d’héroïsme, soit honorés : le Français vit de gloire ; que ses exploits soient publiés ; que la victoire se nourrisse de la victoire et que les peuples de la terre apprennent les fastes de la République inscrits sur la poupe de nos vaisseaux.
Votre commission de marine a donc pensé que c’étoit entrer dans vos vues sur les récompenses militaires à décerner aux armées de la République, de comprendre dans ce cadre vaste et digne du peuple français, la nomination des vaisseaux de l’Etat. Ainsi cet acte de justice et de reconnoissance aura lieu pour les bâtimens qui sont en construction et pour ceux qui seront mis à l’avenir sur les chantiers, d’après un rapport du Directoire exécutif. Quelle est l’âme froide qui ne se sentira pas remplie d’émotion en contemplant ces honneurs du triomphe ! L’exemple des héros enfante des héros ! »
Document Bibliothèque Nationale de France.
Pour la petite (et la grande) histoire, c’est ce même Directoire, approuvé par le même Conseil des Cinq-Cents qui, inquiet de la notoriété grandissante d’un certain général Buonaparte, l’avait nommé, l’année précédente, à la tête de l’Expédition d’Egypte. L’idée de base, sur le plan stratégique, n’était pas complètement loufoque, installer, en Mer Rouge, une force militaire et navale pour, en association avec les forces déjà présentes dans les Mascareignes (Réunion, Maurice), mettre la pagaille sur les routes commerciales anglaises dans l’Océan Indien et obliger la flotte britannique qui campait devant les ports français à aller jouer les pompiers de l’autre côté de la planète. Le résultat en sera calamiteux, hormis pour les égyptologues, perte de précieuses troupes, d’officiers expérimentés, annihilation d’une bonne partie de la flotte française – après Aboukir, l’armée navale ne dispose même plus d’un seul vaisseau de ligne opérationnel en Méditerranée et le reste est coincé dans les ports de l’Atlantique !- sans compter le coût financier d’une telle opération. Elle a coûté cher, la «pierre de Rosette », moi, je vous le dis.
Je vois un Lolo des Villes qui se marre comme une baleine, en signalant que question « confusionnel », je ne suis pas le dernier non plus, vu que la dernière fois que j’ai tenté de faire un point d’histoire dans ce feuilleton interminable, Louis XIV était encore en train de sucer son pouce !...C’est pas faux !
Pavillons et couleurs.
La plupart des peintures et aquarelles de l’époque nous montrent des navires avec de superbes pavillons claquant au vent du large. Dans la réalité, hormis le grand pavois, lors d’évènements exceptionnels, ou le séchage du linge de l’équipage après la corvée hebdomadaire de lavage, les belligérants arborent rarement de pavillons et dévoilent le plus tard possible leur identité, généralement juste avant de balancer la première bordée. Cà fait, en principe, partie des convenances généralement admises, encore que la couronne anglaise, en 1744, stipule à ses bâtiments qu’ils peuvent s’en dispenser, selon le cas. De même l’emploi de pavillons d’une nationalité différente pour leurrer l’adversaire est d’un usage assez courant. Cette pratique concerne surtout les bâtiments isolés et ceux affectés à la course. Bien sûr, quand il s’agit d’une escadre qui, en général, essaye de se castagner avec son homologue adverse, la philosophie n’est pas exactement la même. L’affichage des couleurs fera, au XVIIIème & XIXème siècle, couler beaucoup d’encre et des armées de juristes se pencheront sur le problème….Et si Untel commence à tirer avant d’avoir signalé sa nationalité, peut-il revendiquer la valeur de sa prise ?...le tir d’avertissement doit-il être considéré comme un début d’engagement ? Comme quoi, on n’a pas attendu notre belle époque moderne pour s’enquiquiner avec de tels détails.
En principe, les navires de guerre arborent trois types de pavillon, le pavillon national, pour la France royale, c’est le pavillon blanc fleurdelisé, baptisé « drap de lit » par les Brits, puis, à partir de 1792, de nombreuses variantes du pavillon tricolore dont la disposition ne sera figée que quelques années plus tard. Encore de nos jours, le pavillon réglementaire de la Marine n’utilise pas la même proportion des couleurs que le drapeau national, il y a plus de rouge et moins de bleu. Dans la Royal Navy, le pavillon est, lui aussi spécifique, distinct de celui que nous connaissons avec ses reprises des différentes composantes du Royaume Uni. C’est le pavillon de l’Angleterre, croix rouge sur fond blanc ou bleu clair et, parfois, frappé des armes royales dans le carré supérieur. Généralement le pavillon national est hissé à l’arrière, soit sur une hampe au couronnement de poupe, soit à la corne de la voile d’artimon.
A la pomme de grand mât, point le plus élevé du navire, on hisse la flamme de guerre, un pavillon de forme triangulaire de plusieurs dizaines de mètres de long. Elle indique la nationalité du bâtiment, son appartenance à la marine militaire et que l’officier qui le commande s’est vu officiellement attribuer une lettre de commandement par son gouvernement ou les plus hautes autorités navales, ce qui revient au même. La tradition française veut qu’on rajoute un mètre supplémentaire à la flamme par mois de mer, au-delà de cinq mois consécutifs en opération. Par calme plat, après quelques années de conflit ininterrompu, c’est un coup à se prendre les pieds dedans !
A l’époque, on trouve également en tête de mât la marque de l’autorité embarquée à bord, chef d’escadre, chef de division, etc. C’est le cas en France sous l’Ancien Régime, et dans la Royal Navy, où la couleur précise également la hiérarchie navale (« amiral de la Rouge », « amiral de la Bleu »).
Alors, j’en étais où ?... La poupe, c’est fait…Ah oui, la proue !...
Comme la maison ne recule devant aucun sacrifice pour son aimable clientèle, j’ai également bricolé un montage comparatif de l’évolution des proues à travers les époques.
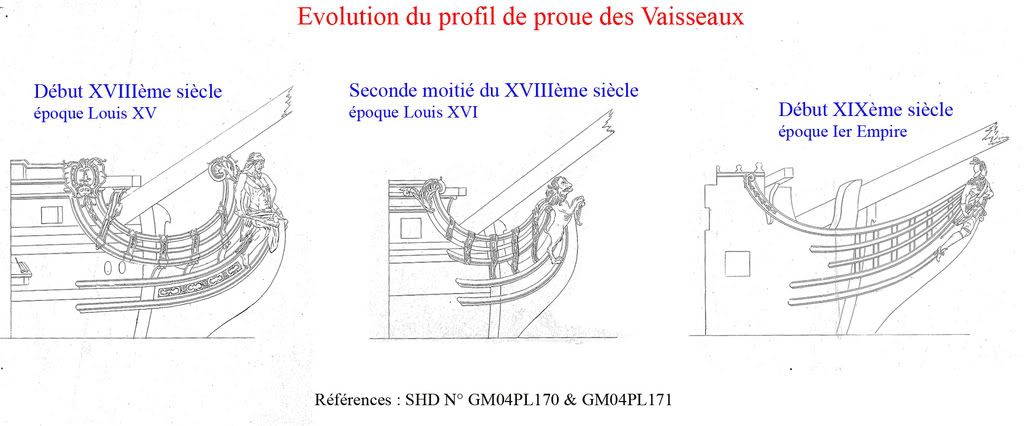 |
| (78) Comparatif de l'évolution des proues de vaisseaux. |
Ce sont les proues des trois mêmes vaisseaux évoqués plus haut. En dépit des herpes et autres enjolivures, on distingue parfaitement la scission entre la coque du navire proprement dit et la guibre ou taille-mer (cette dernière dénomination étant nettement plus imagée). Je vous rappelle que durant longtemps, on s’est entêté à vouloir coller des pièces d’artillerie de chasse dans le coltis, espèce de muraille frontale. Du coup, l’avant du navire est tout sauf profilé pour fendre les flots. Les architectes vont s’échiner pendant des décennies à réaliser une étrave à peu près fonctionnelle. Elle a d’abord tendance à s’élever, remarquez le cintrage accentué des herpes d’étrave à l’époque Louis XVI, puis à s’allonger au tournant du XIXème siècle. Dans la foulée, l’inclinaison du mât de beaupré diminue. Je vous rappelle que l’équipage, quelque soit le temps, est prié d’aller faire ses besoins dans ce charmant endroit !
Ce n’est que dans les années 1830 que la proue tend vers son aspect définitif, très comparable à celui de nos navires moderne. Le coltis à disparu, les poulaines, même si elles existent toujours, sont dorénavant englobées dans la coque et le bordé est maintenant prolongé jusqu’au taille-mer. Je dégaine encore une fois le croquis du Valmy mais là, il faut s’intéresser au schéma de droite.
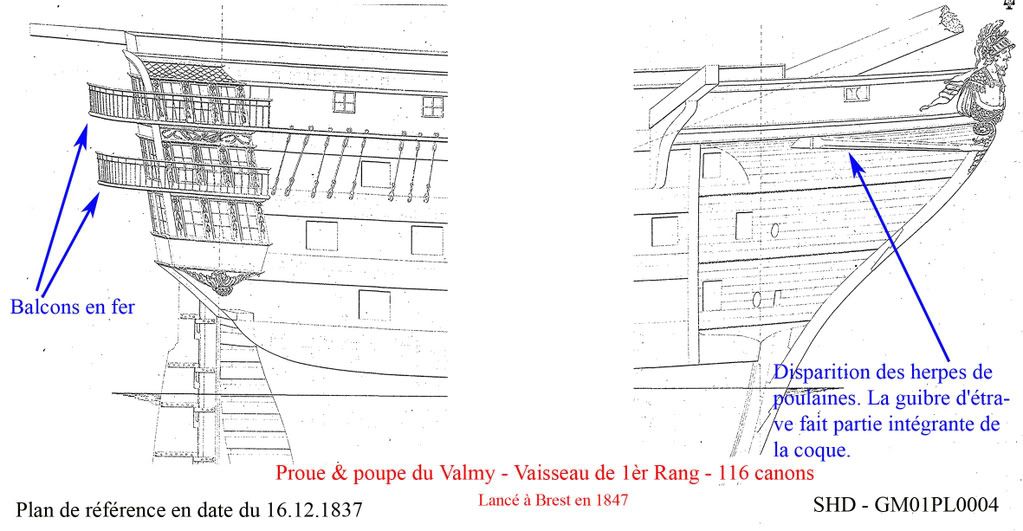 |
(79) Proue & poupe du Valmy, lancé en 1847. (One more time!  ) ) |
Figure de proue
Durant près de trois siècles, la tradition navale exige un emblème de proue à l’extrémité avant du navire. Issu de l’éperon des galères, le bec va, au fil du temps, s’élever puis disparaître, laissant place à cette guibre incongrue. La mocheté de cette pièce qui prolonge le taille-mer nécessite d’y ajouter un minimum de décorations pour cacher la misère. Si c’est le bonheur pour les sculpteurs, ce n’est pas toujours le cas pour leurs œuvres. En général, la figure de proue est plus ou moins sensée évoquer le nom de baptême du bâtiment. Au début du XVIIème siècle, l’étrave, nettement plus basse, laissait un bel espace disponible sous le mât de beaupré. Le sculpteur ravi pouvait carrément y coller une statue en pied, à taille réelle (voir plus !), juchée sur un piédestal. Manque de chance, l’architecte naval s’entête à redessiner l’étrave et notre artiste s’en trouve réduit à tenter d’exploiter l’espace restant. Du coup, on se retrouve avec des lions ou des léopards aux corps faméliques, à faire pleurer de pitié la présidente de votre SPA locale. Ce n’est pas beaucoup mieux pour les représentations humaines, le héros donne soit l’impression que la plus grande part de son corps est coincé sous un pan de mur effondré, soit celle d’un dégénéré, résultat de multiples mariages consanguins. Avec un peu de chance, si le héros à trait au monde marin, Neptune ou Triton, l’artiste lui colle une queue de merlan en tire-bouchon, ce qui finalement est un moindre mal. En 1785, en France, c’est le marasme chez les sculpteurs ! On vient de décider qu’à partir de dorénavant, seul un ridicule écusson fleurdelisé figurera à l’étrave des navires. Sans compter une mode qui se met à sévir dans toute l’Europe et consiste à disposer une tête de lion sculpté à la proue ; force est de constater que nombres de sculpteurs n’ont jamais vu ne serait-ce que la queue dudit félin ! Heureusement, la Révolution stimule à nouveau l’inspiration des artistes. C’est reparti pour les vengeances dépoitraillées au glaive vindicatif, les héros offrant leurs torses valeureux aux embruns des vagues. C’est grandiose à souhait ! Arrive l’Empire. Les sculpteurs proposent des dessins superbes. L’Antique est très à la mode. Des processions de guerriers sortent de la coque pour rejoindre le beaupré. Cà vous a une gueule folle !...sauf que ces superbes projets ne verront jamais le jour. En désespoir de cause, nos artistes mal-aimés se contentent, la plupart du temps, de réaliser des bustes qui viennent se coincer sous le mât de beaupré. Sous la Restauration, c’est encore pire, il n’y a plus un seul fifrelin dans les caisses de l’Etat et, évidemment, ce sont les sculpteurs qui trinquent. Bon an, mal an, les gouvernements se succèdent et l’inspiration de nos artistes évolue selon le bon vouloir des comptables du Trésor, une petite couche de bustes durant les périodes fastes, un assortiment épinards-poireaux…pardon, de « volutes en stylisation végétale », durant les époques de vaches maigre
 |
| (76) Comparatif de l'évolution des poupes de vaisseaux (I) |
Cette vue arrière permet d’apprécier l’évolution des formes sur une période d’environ quatre-vingt ans.
1) Le Redoutable (environs de 1730): Le château arrière présente encore la forme en diapason des constructions du XVIIème siècle. Les arcs-boutants du balcon tentent d’harmoniser l’ajout des bouteilles, excroissances rapportées de part et d’autre du château. Le vaste tableau d’arcasse, dominé par un monumental fanal de poupe, a permis à l’artiste d’y exécuter une sculpture de grandes dimensions dont le thème principal, emprunté à la mythologie, représente probablement une scène de lutte entre deux athlètes, l’un soulevant l’autre de terre... comme il y a de la place, pourquoi se gêner! Sur la façade du balcon, figurent les armes royales, écu fleurdelisé et, probablement, Ordre du Saint Esprit. Au niveau inférieur, dans un cartouche stylisé en drapé, décoré d’une tête de Neptune et d’un carquois, figure le nom du navire. A ce sujet, la France est la première nation, par une ordonnance de 1671, à faire figurer réglementairement le nom de baptême du bâtiment. Les Anglais traineront les pieds pendant un siècle avant de faire de même. En période d’opérations, le nom est souvent camouflé pour éviter l’identification.
2) L’Intrépide (environs de 1770): Le fanal de poupe, bien que de taille plus modeste, est encore présent mais le couronnement a été sérieusement revu à la baisse. Il n’est plus possible d’y faire figurer une scène épique. L’artiste en est réduit à ajouter quelques guirlandes de feuilles d’acanthes au chiffre du souverain régnant. Le blason royal, sur la façade du balcon, a subi, lui aussi une cure d’amaigrissement et il n’y figure plus qu’une seule fleur de lis. Itou pour le cartouche « L’Intrépide » ! Si Neptune a encore la chance d’y figurer, il est nettement plus petit, le carquois et le drapé ont disparu. A noter également, l’évolution de la carène, plus ventrue, le cintrage transversal des ponts et le dessin circulaire du tableau arrière et de son couronnement. Esthétiquement, c’est probablement l’époque où la poupe est la plus réussie.
3) Le Duquesne (environs de 1810): La décoration du château arrière est l’œuvre d’un maitre-sculpteur de l’Arsenal de Venise. La baume du mât d’artimon s’étant généralisée, dans un premier temps, les grands fanaux de poupe sont positionnés plus bas puis sont définitivement supprimés du couronnement. De surcroit, le balcon ayant disparu, pour mettre à l’eau les embarcations du bord, des bossoirs ou des porte-manteaux sont souvent disposés à l’aplomb du tableau arrière. Les sculpteurs se sont acclimatés aux faibles dimensions du couronnement, la décoration comporte des personnages assis, voir accroupis, les étendards et les canons flirtent avec l’horizontale. L’artiste s’est vengé en disposant deux tritons « portefaix » à la base du château. De part et d’autre des galeries, des faisceaux de licteurs associent des tridents et des ancres. En parlant de galerie, en cas de combat, les fenêtres étaient démontées et remplacées par de solides panneaux de bois. Les deux sabords de retraite qui figurent sur les deux bâtiments précédents disparaissent. De toute façon, vu leur position, il y a plus de chances d’embarquer des paquets de mer que de faire mouche. Par contre, dans la galerie basse, il est prévu généralement deux postes de tir pour pièce de retraite, sous réserve qu’on n’y trouve pas un de ces superbes balcons décorés qui seraient rapidement transformés en petit bois de chauffage dès la première salve. Les canons de retraite sont soit prélevés provisoirement sur la batterie contigüe, soit installées à demeure. Dans les frégates, cet emplacement correspond à la grande-chambre, qui sert, entre autres, d’appartement au commandant de bord, ils sont alors pudiquement habillés de housses plus ou moins luxueuses. J’anticipe un peu mais lors du branle-bas de combat, l’ensemble des séparations étaient démontées pour disposer de l’espace maximum pour la manœuvre des canons. Pour se faire, la plupart des cloisons, y compris celles du poste des officiers et du commandant, étaient soient constituées de rideaux, ou de toiles fixées sur des cadres amovibles ou de cloisons légères démontables en bois. Mobiliers, tapis de la grande-chambre, cloisons et rideaux, tout était stocké dans la cale durant les combats. Les grands navires de ligne, deux et trois-ponts disposent généralement de cloisons fixes entre la grande chambre et le reste du bâtiment
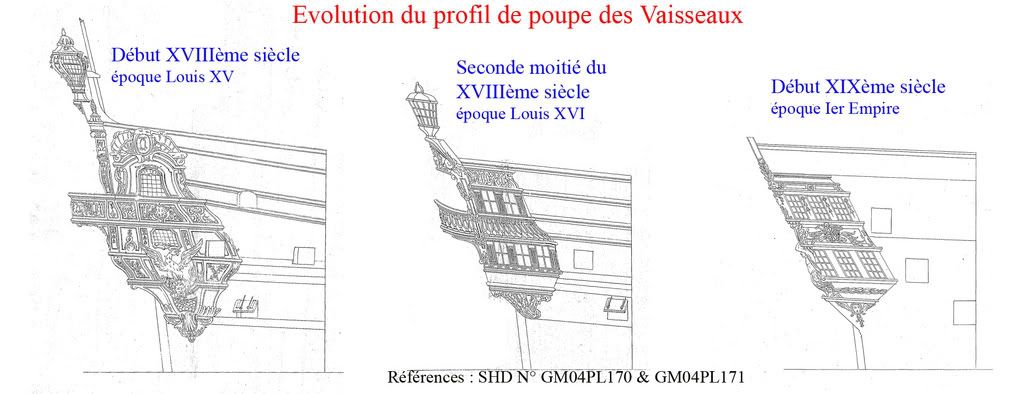 |
| (77) Comparatif de l'évolution des poupes de vaisseaux (2b) |
Les balcons et galeries de poupe apparaissent ou disparaissent au gré des modes. En fait, c’est « le nivellement par l’hypertrophie », l’espace libre entre le couronnement et le ou les balcon(s) se voit équipé de fenêtres, la galerie devient intérieure et le tableau d’arcasse plan (voir planche N° 77), puis, aux alentours des années 1840, des balcons en fer forgés font à nouveau leur apparition. Comparez les croquis N°77 avec celui ci-dessous.
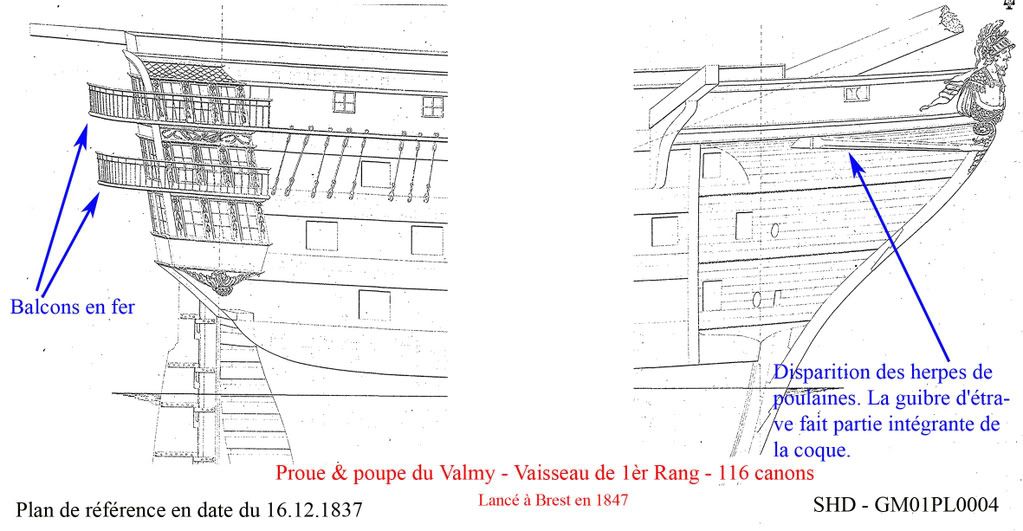 |
| (79) Proue & poupe du Valmy, lancé en 1847. |
Le cartouche.
Le cartouche où figure le nom du vaisseau mérite quelques explications. Hormis quelques navires hollandais, dans la seconde moitié du XVIIème siècle, qui arborent leur nom inscrit à la poupe, c’est le Royaume de France qui, à dater d’une ordonnance royale de 1691, inaugure l’emploi systématique du cartouche à la poupe de ses vaisseaux de guerre. Les Britanniques traineront les pieds pendant près d’un siècle avant de procéder de même, ne souhaitant pas faciliter le boulot des services de renseignement ennemis.
La plupart du temps, dans les différentes marines de l’époque, les noms de baptême des navires évoquent des dieux et divinités de l’Antiquité, ou se réfèrent à des qualificatifs virils et guerriers. En France, les vaisseaux étant du genre masculin, le qualificatif est, bien évidemment, de sexe male ou réputé tel tandis que les frégates et corvettes sont féminisées. Dans la ligne de bataille, on trouve pêle-mêle du Redoutable, de l’Inflexible, du Foudroyant, etc., tandis que les bâtiments « hors ligne » se voient baptisée Minerve (çà, ce n’est pas vraiment du bol, vu que les treize frégates françaises baptisée ainsi, finiront dans les mains anglaises et que ce n’est guère mieux pour celles lancées par les Britanniques), Thétis, Vestale, Valeureuse, Vengeance, Forte, etc.
Le 5 Septembre 1799 (19 Fructidor An7), sous le Directoire, le citoyen Boulay-Paty, rapporteur du budget de la Marine devant le Conseil des Cinq-Cents (l’Assemblée Nationale de l’époque), gros fayot devant l’Eternel (son rapport que j’ai déniché dans les trésors de la BNF est un vrai poème !) réclame à cette respectable assemblée que, dorénavant, les noms de héros et de grands faits d’arme (républicains, bien sûr !) soient attribués aux navires de guerre de la République. Comme çà ne coûte pas un rond, l’assemblée des Sages entérine immédiatement cette proposition. Ce qui est extraordinaire, c’est que ce rapport, établi quelques mois après la déculottée d’Aboukir, établit bien, au début, les carences de la marine française, responsables en partie de ce désastre, mais, dès qu’il s’agit de pognon à attribuer au Ministère de la Marine et des Colonies pour tenter de remédier à cette situation calamiteuse, là, çà coince et les coupes franches, aux justifications plus que douteuses, se succèdent, réduisant le budget-programme du Ministère à une véritable peau de chagrin, amputée de 50% de ses besoins chiffrés, alors que nous sommes en pleine guerre depuis 1792 ! En attendant, c’est à partir de cette date que la plupart des grands bâtiments français portent principalement des noms de personnages plus ou moins illustres et de fait d’armes militaires.
Je ne résiste pas au plaisir de vous asséner, avec l’orthographe de l’époque, le paragraphe du rapport s’y afférant.
« …Mais, en même temps, représentans du peuple,…il est de l’essence des imminentes fonctions que vous remplissez au nom du peuple français, de nommer chaque vaisseau dont vous ordonnez la mise sur les chantiers. C’est ainsi que vous en ferez une récompense nationale, qui ne doit être dispensée que par le Corps législatif, et qui deviendra un aliment de plus au courage et à la valeur des républicains ; c’est ainsi que vous célèbrerez les sacrifices généreux, les hauts-faits d’armes, les belles actions militaires, qui, depuis longtemps, n’ont de témoins que de vastes tombeaux appelés champs de bataille. Que la cendre du soldat, de l’officier, du général de terre et de mer, qui a signalé son triomphe ou sa mort par des traits de dévouement et d’héroïsme, soit honorés : le Français vit de gloire ; que ses exploits soient publiés ; que la victoire se nourrisse de la victoire et que les peuples de la terre apprennent les fastes de la République inscrits sur la poupe de nos vaisseaux.
Votre commission de marine a donc pensé que c’étoit entrer dans vos vues sur les récompenses militaires à décerner aux armées de la République, de comprendre dans ce cadre vaste et digne du peuple français, la nomination des vaisseaux de l’Etat. Ainsi cet acte de justice et de reconnoissance aura lieu pour les bâtimens qui sont en construction et pour ceux qui seront mis à l’avenir sur les chantiers, d’après un rapport du Directoire exécutif. Quelle est l’âme froide qui ne se sentira pas remplie d’émotion en contemplant ces honneurs du triomphe ! L’exemple des héros enfante des héros ! »
Document Bibliothèque Nationale de France.
Pour la petite (et la grande) histoire, c’est ce même Directoire, approuvé par le même Conseil des Cinq-Cents qui, inquiet de la notoriété grandissante d’un certain général Buonaparte, l’avait nommé, l’année précédente, à la tête de l’Expédition d’Egypte. L’idée de base, sur le plan stratégique, n’était pas complètement loufoque, installer, en Mer Rouge, une force militaire et navale pour, en association avec les forces déjà présentes dans les Mascareignes (Réunion, Maurice), mettre la pagaille sur les routes commerciales anglaises dans l’Océan Indien et obliger la flotte britannique qui campait devant les ports français à aller jouer les pompiers de l’autre côté de la planète. Le résultat en sera calamiteux, hormis pour les égyptologues, perte de précieuses troupes, d’officiers expérimentés, annihilation d’une bonne partie de la flotte française – après Aboukir, l’armée navale ne dispose même plus d’un seul vaisseau de ligne opérationnel en Méditerranée et le reste est coincé dans les ports de l’Atlantique !- sans compter le coût financier d’une telle opération. Elle a coûté cher, la «pierre de Rosette », moi, je vous le dis.
Je vois un Lolo des Villes qui se marre comme une baleine, en signalant que question « confusionnel », je ne suis pas le dernier non plus, vu que la dernière fois que j’ai tenté de faire un point d’histoire dans ce feuilleton interminable, Louis XIV était encore en train de sucer son pouce !...C’est pas faux !
Pavillons et couleurs.
La plupart des peintures et aquarelles de l’époque nous montrent des navires avec de superbes pavillons claquant au vent du large. Dans la réalité, hormis le grand pavois, lors d’évènements exceptionnels, ou le séchage du linge de l’équipage après la corvée hebdomadaire de lavage, les belligérants arborent rarement de pavillons et dévoilent le plus tard possible leur identité, généralement juste avant de balancer la première bordée. Cà fait, en principe, partie des convenances généralement admises, encore que la couronne anglaise, en 1744, stipule à ses bâtiments qu’ils peuvent s’en dispenser, selon le cas. De même l’emploi de pavillons d’une nationalité différente pour leurrer l’adversaire est d’un usage assez courant. Cette pratique concerne surtout les bâtiments isolés et ceux affectés à la course. Bien sûr, quand il s’agit d’une escadre qui, en général, essaye de se castagner avec son homologue adverse, la philosophie n’est pas exactement la même. L’affichage des couleurs fera, au XVIIIème & XIXème siècle, couler beaucoup d’encre et des armées de juristes se pencheront sur le problème….Et si Untel commence à tirer avant d’avoir signalé sa nationalité, peut-il revendiquer la valeur de sa prise ?...le tir d’avertissement doit-il être considéré comme un début d’engagement ? Comme quoi, on n’a pas attendu notre belle époque moderne pour s’enquiquiner avec de tels détails.
En principe, les navires de guerre arborent trois types de pavillon, le pavillon national, pour la France royale, c’est le pavillon blanc fleurdelisé, baptisé « drap de lit » par les Brits, puis, à partir de 1792, de nombreuses variantes du pavillon tricolore dont la disposition ne sera figée que quelques années plus tard. Encore de nos jours, le pavillon réglementaire de la Marine n’utilise pas la même proportion des couleurs que le drapeau national, il y a plus de rouge et moins de bleu. Dans la Royal Navy, le pavillon est, lui aussi spécifique, distinct de celui que nous connaissons avec ses reprises des différentes composantes du Royaume Uni. C’est le pavillon de l’Angleterre, croix rouge sur fond blanc ou bleu clair et, parfois, frappé des armes royales dans le carré supérieur. Généralement le pavillon national est hissé à l’arrière, soit sur une hampe au couronnement de poupe, soit à la corne de la voile d’artimon.
A la pomme de grand mât, point le plus élevé du navire, on hisse la flamme de guerre, un pavillon de forme triangulaire de plusieurs dizaines de mètres de long. Elle indique la nationalité du bâtiment, son appartenance à la marine militaire et que l’officier qui le commande s’est vu officiellement attribuer une lettre de commandement par son gouvernement ou les plus hautes autorités navales, ce qui revient au même. La tradition française veut qu’on rajoute un mètre supplémentaire à la flamme par mois de mer, au-delà de cinq mois consécutifs en opération. Par calme plat, après quelques années de conflit ininterrompu, c’est un coup à se prendre les pieds dedans !
A l’époque, on trouve également en tête de mât la marque de l’autorité embarquée à bord, chef d’escadre, chef de division, etc. C’est le cas en France sous l’Ancien Régime, et dans la Royal Navy, où la couleur précise également la hiérarchie navale (« amiral de la Rouge », « amiral de la Bleu »).
Alors, j’en étais où ?... La poupe, c’est fait…Ah oui, la proue !...
Comme la maison ne recule devant aucun sacrifice pour son aimable clientèle, j’ai également bricolé un montage comparatif de l’évolution des proues à travers les époques.
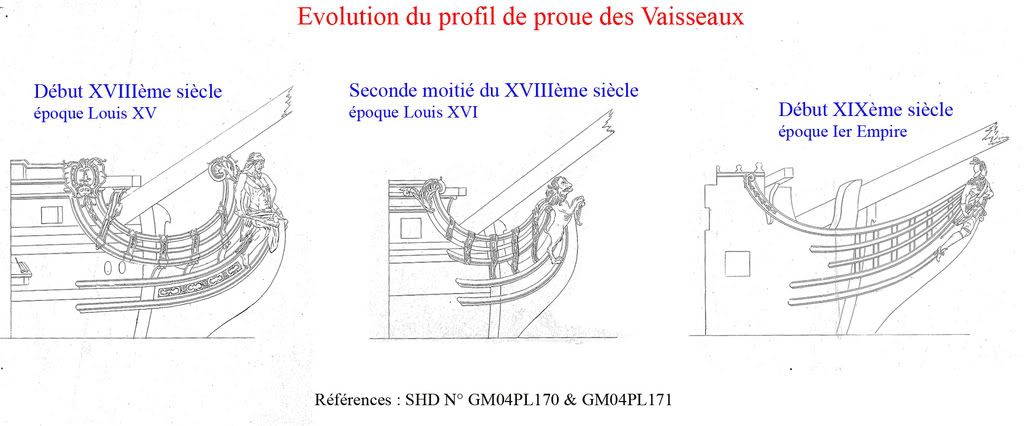 |
| (78) Comparatif de l'évolution des proues de vaisseaux. |
Ce sont les proues des trois mêmes vaisseaux évoqués plus haut. En dépit des herpes et autres enjolivures, on distingue parfaitement la scission entre la coque du navire proprement dit et la guibre ou taille-mer (cette dernière dénomination étant nettement plus imagée). Je vous rappelle que durant longtemps, on s’est entêté à vouloir coller des pièces d’artillerie de chasse dans le coltis, espèce de muraille frontale. Du coup, l’avant du navire est tout sauf profilé pour fendre les flots. Les architectes vont s’échiner pendant des décennies à réaliser une étrave à peu près fonctionnelle. Elle a d’abord tendance à s’élever, remarquez le cintrage accentué des herpes d’étrave à l’époque Louis XVI, puis à s’allonger au tournant du XIXème siècle. Dans la foulée, l’inclinaison du mât de beaupré diminue. Je vous rappelle que l’équipage, quelque soit le temps, est prié d’aller faire ses besoins dans ce charmant endroit !
Ce n’est que dans les années 1830 que la proue tend vers son aspect définitif, très comparable à celui de nos navires moderne. Le coltis à disparu, les poulaines, même si elles existent toujours, sont dorénavant englobées dans la coque et le bordé est maintenant prolongé jusqu’au taille-mer. Je dégaine encore une fois le croquis du Valmy mais là, il faut s’intéresser au schéma de droite.
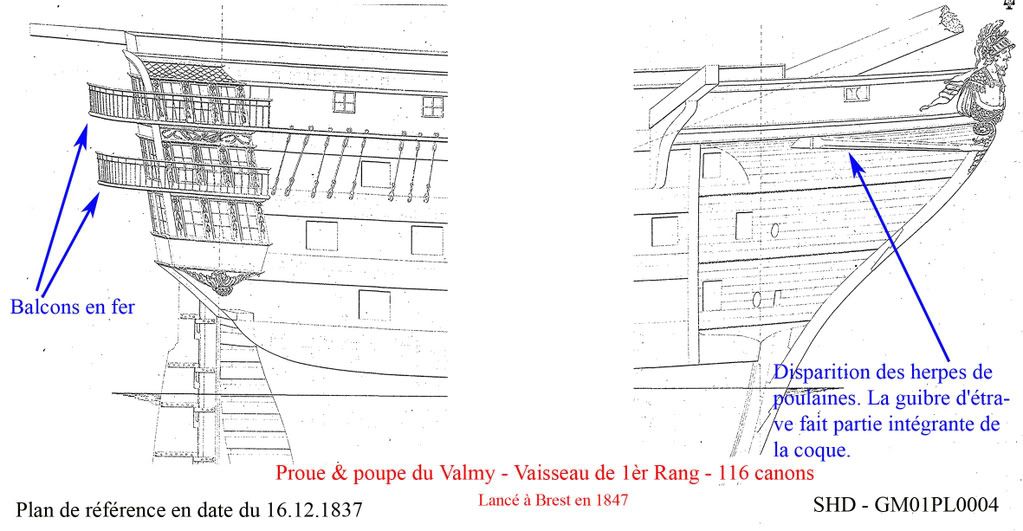 |
(79) Proue & poupe du Valmy, lancé en 1847. (One more time!  ) ) |
Figure de proue
Durant près de trois siècles, la tradition navale exige un emblème de proue à l’extrémité avant du navire. Issu de l’éperon des galères, le bec va, au fil du temps, s’élever puis disparaître, laissant place à cette guibre incongrue. La mocheté de cette pièce qui prolonge le taille-mer nécessite d’y ajouter un minimum de décorations pour cacher la misère. Si c’est le bonheur pour les sculpteurs, ce n’est pas toujours le cas pour leurs œuvres. En général, la figure de proue est plus ou moins sensée évoquer le nom de baptême du bâtiment. Au début du XVIIème siècle, l’étrave, nettement plus basse, laissait un bel espace disponible sous le mât de beaupré. Le sculpteur ravi pouvait carrément y coller une statue en pied, à taille réelle (voir plus !), juchée sur un piédestal. Manque de chance, l’architecte naval s’entête à redessiner l’étrave et notre artiste s’en trouve réduit à tenter d’exploiter l’espace restant. Du coup, on se retrouve avec des lions ou des léopards aux corps faméliques, à faire pleurer de pitié la présidente de votre SPA locale. Ce n’est pas beaucoup mieux pour les représentations humaines, le héros donne soit l’impression que la plus grande part de son corps est coincé sous un pan de mur effondré, soit celle d’un dégénéré, résultat de multiples mariages consanguins. Avec un peu de chance, si le héros à trait au monde marin, Neptune ou Triton, l’artiste lui colle une queue de merlan en tire-bouchon, ce qui finalement est un moindre mal. En 1785, en France, c’est le marasme chez les sculpteurs ! On vient de décider qu’à partir de dorénavant, seul un ridicule écusson fleurdelisé figurera à l’étrave des navires. Sans compter une mode qui se met à sévir dans toute l’Europe et consiste à disposer une tête de lion sculpté à la proue ; force est de constater que nombres de sculpteurs n’ont jamais vu ne serait-ce que la queue dudit félin ! Heureusement, la Révolution stimule à nouveau l’inspiration des artistes. C’est reparti pour les vengeances dépoitraillées au glaive vindicatif, les héros offrant leurs torses valeureux aux embruns des vagues. C’est grandiose à souhait ! Arrive l’Empire. Les sculpteurs proposent des dessins superbes. L’Antique est très à la mode. Des processions de guerriers sortent de la coque pour rejoindre le beaupré. Cà vous a une gueule folle !...sauf que ces superbes projets ne verront jamais le jour. En désespoir de cause, nos artistes mal-aimés se contentent, la plupart du temps, de réaliser des bustes qui viennent se coincer sous le mât de beaupré. Sous la Restauration, c’est encore pire, il n’y a plus un seul fifrelin dans les caisses de l’Etat et, évidemment, ce sont les sculpteurs qui trinquent. Bon an, mal an, les gouvernements se succèdent et l’inspiration de nos artistes évolue selon le bon vouloir des comptables du Trésor, une petite couche de bustes durant les périodes fastes, un assortiment épinards-poireaux…pardon, de « volutes en stylisation végétale », durant les époques de vaches maigres.
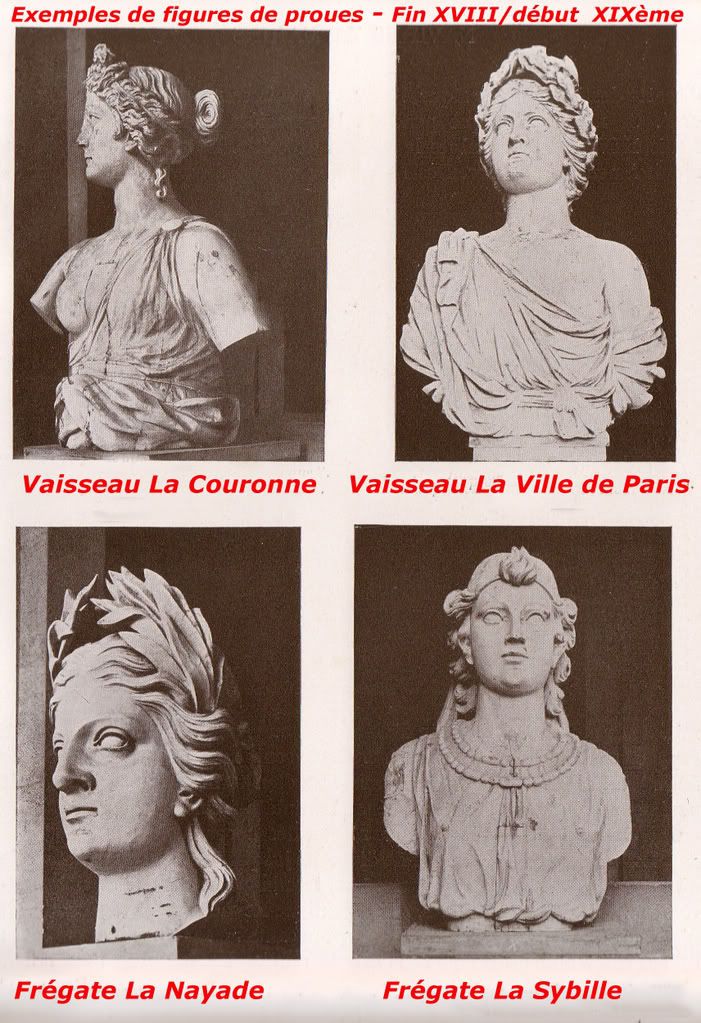 |
| (81) Figures de proues - période fin de l'Ancien Régime jusqu'à l'Empire. |
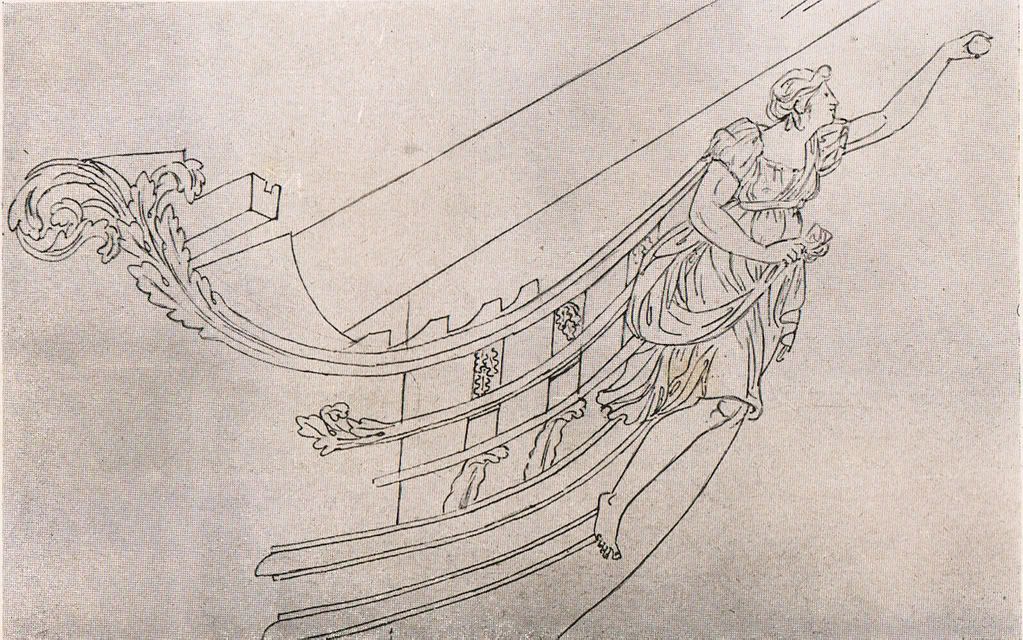 |
| (82) Projet de sculpture de proue |
Quand je vous disais, plus haut, que sous la Révolution et l'Empire, l'Antique avait beaucoup de succès. Admirez cette superbe amazone en pied, figure de proue de la Bellone. Un p'tit coup de bonnet phrygien pour rappeller, au passage, les origines révolutionnaires de l'Empire.
 |
| (80) Figure de proue de La Bellone - Frégate de 18 (1806) |
Allez, un p’tit coup de classement ! Vaisseaux, frégates et autres bouchons…
En ce début d’année, traditionnellement, les caisses du Ministère de la Marine sont vides ou remplies de reconnaissances de dettes et le Ministère des Finances tarde à verser ses bienfaisants subsides tant espérés. Nous allons donc retarder le lancement de notre vaisseau. Cà ne sert à rien qu’il pourrisse ses fonds dans les eaux nauséabondes du port, il vaut mieux qu’il sèche tranquillement sur son chantier, dans l’attente d’une période plus propice à son armement.
Je vais donc en profiter pour faire un peu le point sur les différents types de navires, leurs classements et leurs emplois.
C’est en 1665, au combat du Texel contre les Hollandais, que les Anglais inaugurent la tactique du combat naval en ligne de file. Cette disposition perdurera jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale.
Cette nouvelle tactique influe directement sur l’évolution du vaisseau car elle implique une harmonisation des armements, des dimensions et de la marche des bâtiments. La Ligne est une « muraille » flottante, il convient donc qu’elle présente le moins de points faibles possibles. Les navires qui la constituent doivent posséder une puissance de feu et une épaisseur de bordé, capable d’encaisser la décharge adverse, à peu près similaires. De surcroit, ils doivent disposer de qualités nautiques leur permettant de tenir leur position dans l’alignement. Même si la marche est généralement calculée sur les performances du vaisseau le moins performant, un bâtiment incapable de tenir l’allure est un vrai boulet, voir une catastrophe au moment du combat. A la fin du XVIIème siècle, cette harmonisation est loin d’être réalisée. Si, pour un œil non averti, un vaisseau ressemble à un autre, dans la réalité ce n’est pas le cas. A l’époque, chaque architecte naval à tendance à imposer ses idées, quelles soient bonnes ou médiocres. Du coup, les flottes de ligne ne sont qu’un assemblage hétéroclite. Chez les Hollandais, par exemple, grands commerçants des mers, leur flotte militaire est principalement constituée de navires au commerce armés en guerre. Cette « polyvalence » ne résistera à la réalité des combats. Chaque nation se met, à grands frais, à constituer une flotte de guerre permanente. Les principaux types de bâtiments se répartissent en trois familles distinctes :
· Les vaisseaux de ligne
· Les navires de guerre hors ligne
· Les bâtiments de charge et de servitude.
Citation d’un intendant de la Marine, au milieu du XVIIIème siècle (extrait de « La grande époque de la marine à voiles » (M.Accerra – J.Meyer – Ouest France Université – 1987) :
« Il ne peut y avoir proprement dans la marine que trois espèces de bâtiments, savoir, des vaisseaux de guerre, des frégates et des bâtiments de transport. Chaque espèce de ces bâtiments doit avoir des proportions et des distributions différentes relativement au service qu’ils ont à remplir »
Les vaisseaux de ligne.
Définition de base simple : Un vaisseau de ligne est un navire comportant, au moins, deux ponts couverts armés de canons et dont le calibre minimal à la batterie basse est du 18 livres (poids de balles, correspondant à 489 grammes par livre, assez proche de notre définition actuelle). Ce sont des bâtiments à trois mats carrés, qui tiennent la mer mais ne sont pas d’excellents marcheurs. Dans le meilleur des cas, la vitesse maximale d’un navire de ligne est de l’ordre de 8 à 9 nœuds (15 à 17 km/h). Il leur faut juste pouvoir tenir leur position dans la ligne.
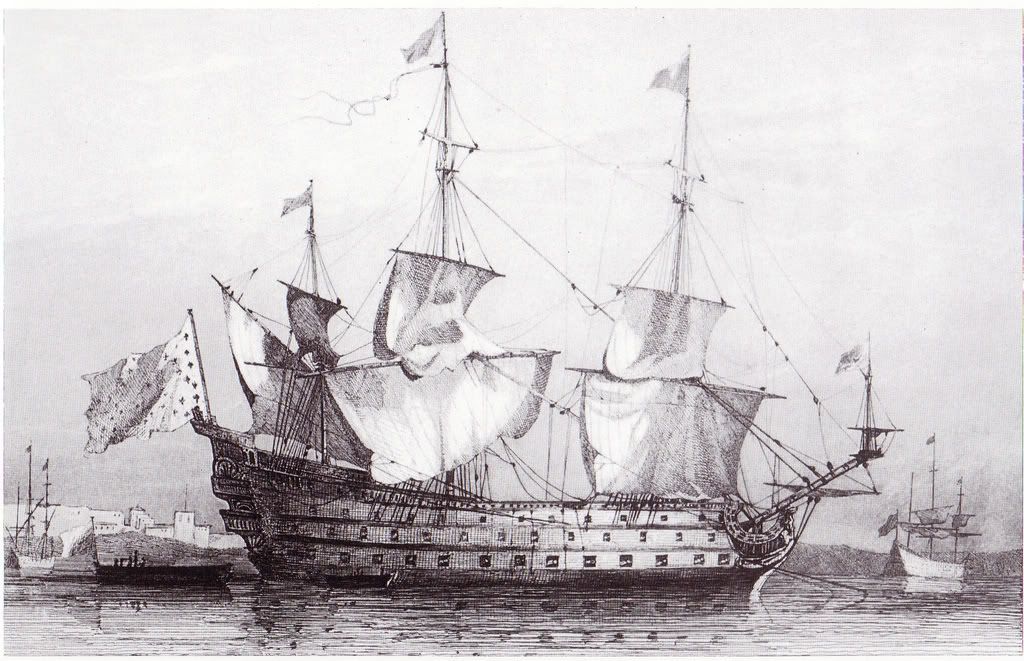 |
| (83) Le Soleil Royal – vaisseau à trois-ponts, lancé à Brest en 1693 |
Au cours des décennies, la flotte de ligne sera principalement constituée de deux-ponts et de quelques trois-ponts. Destinées à combattre en ligne de file, comme leur nom l’indique, les plus grosses unités quitteront rarement les eaux européennes. L’effectif embarqué varie entre 500 hommes et près d’un millier, dont une forte garnison pouvant atteindre plus de 200 soldats, sensée servir de corps de débarquement, lors des opérations à terre et de mousqueterie, dans les combats bord à bord et les abordages. C’est le corps des Royal Marines britanniques, très bien amarinés, ou, pour la France, celui des troupes de Marine et des Colonies, nettement moins spécialisées (mais bon, c’est une autre histoire…).
L’Amirauté anglaise, la première, se met à classer ses vaisseaux de guerre en « rangs ». Le Royaume de France lui emboite le pas, assez rapidement, dès l’année 1670. Le premier classement, l’Ordonnance de 1674, se contente d’indiquer le nombre minimal et maximal de canons que doivent comporter les vaisseaux, selon leurs rangs.
1er rang : 120 à 70 canons – tonnage : 2400 à 1400 Tx
2ème rang : 68 à 62 canons – tonnage : 1300 à 1100 Tx
3ème rang : 66 à 48 canons – tonnage : 1100 à 850 Tx
4ème rang : 44 à 36 canons – tonnage : 800 à 550 Tx
5ème rang : 34 à 28 canons – tonnage : 550 à 60 Tx
En réalité, seuls les trois premiers rangs sont assimilés à des navires de ligne. Les vaisseaux de 100 canons et plus, à l’époque ils sont au nombre de 4, sont désignés « de premier rang extraordinaire ».
L’Ordonnance ne fait pas mention du calibre des canons. Il y a d’importantes différences d’armement entre bâtiments du même rang, le nombre de sabords diffère d’un navire à l’autre, les calibres sont parfois panachés dans une même batterie.
En fait, les différentes nations s’efforcent de résoudre une équation très complexe. Comment réaliser le bâtiment le plus performant, à un coût point trop prohibitif, qui dispose d’une batterie basse la plus lourde possible, suffisamment élevée au-dessus des flots pour pouvoir servir par mer formée, sans entrainer la perte du navire, équipé de batteries supérieures puissantes et d’une structure vélique de plus en plus conséquente sans entrainer un déséquilibre du centre gravité qui risque de le faire chavirer à la première vague de flanc…sachant que les architectes navals sont limités par les caractéristiques intrinsèques du bois de construction, les dimensions des chantiers, le poids des canons et de la voilure ? Vous avez trente minutes pour donner une réponse sensée. Passé ce délai, je ramasse les copies.
Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle (Ordonnance de 1786), la construction navale française centre sa production sur trois modèles de vaisseaux de ligne, le trois-ponts de 118 canons et deux types de deux-ponts, le 80 et le 74 canons.
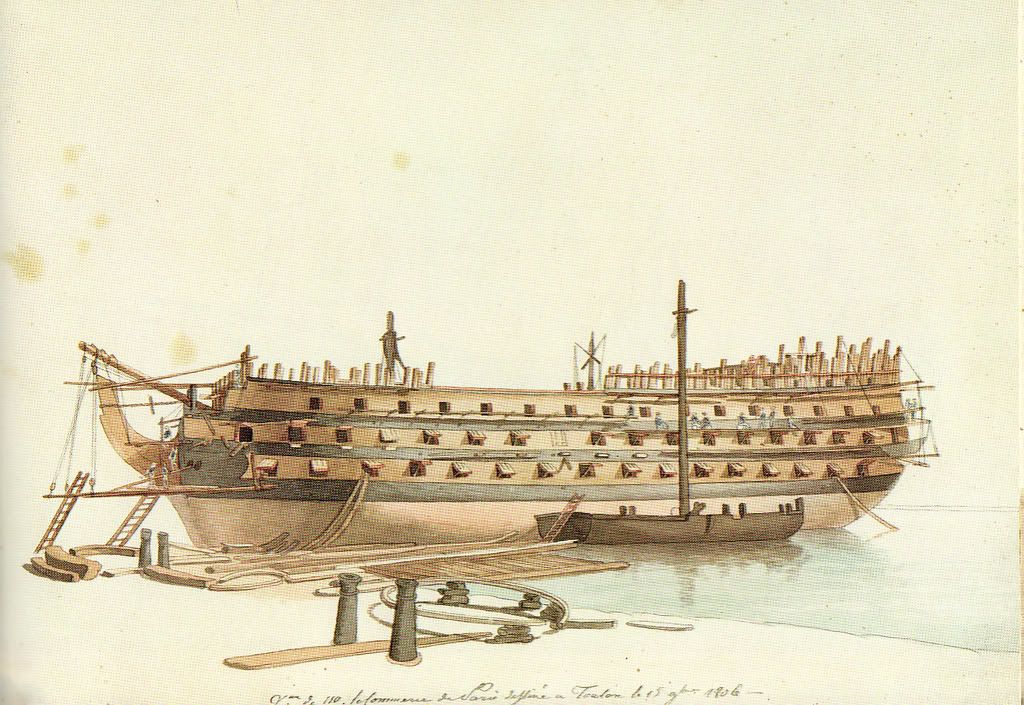 |
| (84) Le Commerce de Paris - trois-ponts de 110 - Arsenal de Toulon - 15-11-1806 |
 |
| (85) Le Bucentaure - Deux-ponts de 80 canons - Navire-amiral de Villeneuve à Trafalgar (1805) |
 |
| (86) Le Patriote - Deux-ponts de 74 – 1791 |
Déplacement d’un vaisseau de ligne (type Sané-Borda) :
Trois-ponts de 118 canons: 5140 tonnes
Deux-ponts de 80 canons : 3870 tonnes
Deux-ponts de 74 canons : 3010 tonnes
Les navires de guerre hors ligne.
La frégate
La simplicité consisterait à dire tous les autres, autres que les navires de ligne. La réalité se trouve dans l’évolution de la navigation intercontinentale et le développement des colonies d’outre-mer. Pour la communication et l’éclairage des escadres, il existe des bâtiments de petit échantillonnage, rapides mais faiblement armés. Avec l’expansion du commerce avec les colonies, il faut sécuriser les routes maritimes, protéger les convois et attaquer ceux de l’adversaire, découvrir et explorer de nouvelles côtes, s’enfoncer dans les embouchures de fleuves inconnus, assurer la police des atterrages. Le gros vaisseau de ligne n’est pas conçu pour ce genre d’activité. Les bâtiments de quatrième et cinquième rangs satisfont à ces tâches mais manquent généralement des qualités nautiques et véliques nécessaires. Ces petits deux-ponts sont parfois dénommés « vaisseaux-frégates » pour les distinguer de la « frégate légère », dénomination apparue au début du XVIIIème siècle et qui se rapporte à des unités de faible tonnage, assez éloignées du futur standard. Il faudra quatre-vingt ans (1660-1740) aux architectes navals et aux états-majors pour mettre au point le navire idoine, fruit du mariage compliqué du vaisseau, de la « double-chaloupe » et de la « barque longue », la frégate.
La frégate est un trois-mâts carré, avec une seule batterie couverte et une artillerie complémentaire de gaillard, taillé pour tenir la mer, bonne marcheuse – dans de bonnes conditions, certaines frégate peuvent atteindre des vitesses de l’ordre de 15 nœuds (27 km/h !)- et capable de serrer au plus près le lit du vent – les régimes de vents sont loin d’être toujours favorables à la route souhaitée et les capacités d’un voilier à remonter au vent sont des paramètres très importants. A l’époque, un navire, parti des côtes européennes, doit chercher les vents favorables au large des cotes brésiliennes pour rejoindre le Cap de Bonne-Espérance et remonter dans l’Océan Indien. Cà fait un joli détour.
Les frégates sont classées d’après le calibre de leur batterie principale. L’incessante course à la puissance entrainera l’accroissement régulier de la puissance de feu de ces bâtiments. La frégate de 8 des années 1740, laisse place, dans la décennie 1760, à la frégate de 12 et à la veille de la Révolution, le choix se porte sur la frégate de 18.
 |
| (87) Frégate française de 12 L'Unité - capturée en 1796, servira dans la Royal Navy jusqu'en 1802 |
La frégate de 18, tout en bénéficiant d’un certain nombre de refontes mineures, restera au programme de production des arsenaux français jusqu’à la fin du Premier Empire. En 1815, la totalité de la flotte de frégates est constituée de frégates de 18, dénommées également « frégate de 44 », en rapport avec le nombre total de pièces d’artillerie du bord.
 |
| (88) Frégate française de 18 & 44 canons. |
Curieusement, sous la Révolution, la France innove avec la fabrication d’une frégate « lourde » de 24 livres, percée à 15 (sabords) à sa batterie principale mais, pour de sombre raisons économiques injustifiées –sans oublier l’influence d’un certain Jean-Noël Sané, architecte naval omnipotent durant des décennies-, abandonne sa production après une demi-douzaine d’exemplaires. Les Etats-Unis, dans l’incapacité financière de produire une véritable flotte de vaisseaux de ligne, en reprennent l’idée et produisent, pour leur propre usage, une série de frégates lourdes de 24, bâtiments de qualité exceptionnelle, qui laisseront des souvenirs douloureux aux Britanniques, durant la guerre anglo-américaine de 1812-1813. Après 1815, toutes les marines européennes standardiseront la frégate de 24.
 |
| (89) USS United States - frégate lourde américaine de 24 & 50 canons - lancée en 1797 |
Déplacement d’une frégate :
Frégate de 8 : 950 tonnes
Frégate de 12 : 1100 tonnes
Frégate de 18 : 1400 tonnes
Frégate de 24 : 1930 tonnes (L’Egyptienne - 1799)
La corvette
C’est la plus petite unité à trois mâts carré de la marine. La corvette est une frégate en réduction, son échantillonnage et son armement, généralement de 20 pièces, évolueront de la même manière que sa grande sœur, la frégate. Il existe plusieurs classes de corvettes, également dénommées d’après leur calibre principal, corvette de 4, de 6, de 8. Certaines corvettes, notamment avec l’apparition des caronades françaises sous l’Empire, seront armées en 24 livres à la batterie principale.
Déplacement d’une corvette : de 500 à 600 tonnes.
 |
|
(90) Corvette corsaire La Babiole - 1806
|
Les petites unités.
En complément aux frégates et aux corvettes, on trouve également une flottille de petits bâtiments que les britanniques qualifient du terme général de « sloop of war ». Au cours du XIXème siècle, les corvettes et les brigs seront souvent dénommés avisos.
Le brick ou brig, navire à deux mâts et phare carré, généralement armé d’une seule batterie couverte ou découverte de petit calibre puis, ultérieurement de caronades. Le brig à pible a la particularité d’être équipé de mâts d’un seul tenant (pible). Cette disposition, plus légère et plus économique que la disposition en éléments séparés, a le désavantage de ne pas pouvoir être réparé à la mer, en cas de rupture d’un mât.
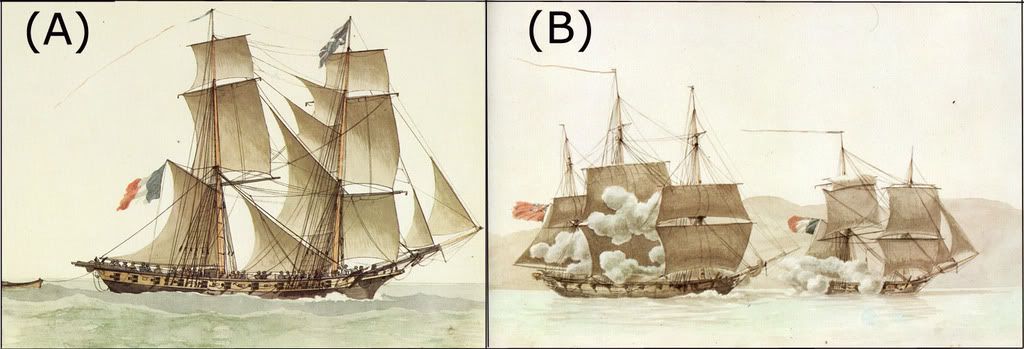 |
| (91)(A)Brig à pible La Ligurienne de 300 tonneaux & 20 canons (B) Combat de La Ligurienne et de la frégate anglaise Petrel – 30 Ventose An 8 (21 03 1800) |
La galiote à bombes, armée de deux mortiers de 12 pouces (le pouce français mesure 27,1mm, soit un calibre de 32,5cm). Les galiotes à bombes ont les dimensions d’une corvette mais l’épaisseur de la coque et des ponts est très proche de celle d’un vaisseau de ligne pour résister aux contraintes de tir. Le tir s’effectuant par l’avant, les galiotes à bombes ne disposent que de deux mâts. Le mortier de 12 pouces tirent une bombe (poids à vide : 71 kg) bourrée de 30 livres de poudre à canon et munie d’une fusée à combustion (temps de combustion de 30 à 40 secondes). La portée de tir des mortiers est de 2000 à 3000 m. Ces armes à tir courbe (angle de tir : 45°) sont destinées à bombarder des ouvrages côtiers.
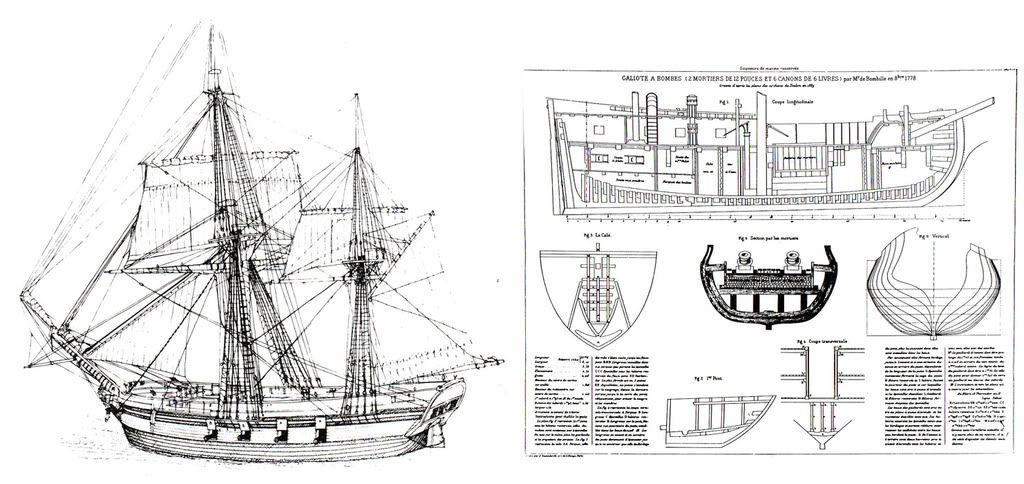 |
| (92) Galiote à bombe (1820) et détails d’implantation des mortiers de 12 pouces. |
Le chébec, bâtiment typiquement méditerranéen à voilure latine assez semblable à celle des galères dont il est issu. Le chébec se distingue par son long éperon de proue. Bas sur l’eau, il pouvait-être manœuvré à la rame mais cette pratique se perd au cours des décennies. L’armement est de l’ordre de 20 pièces de petit calibre.
 |
|
(93a/b) Chébec corsaire l'Intrépide, combat avec deux bricks anglais.
|
La goélette à huniers, petit bâtiment rapide, à deux mats, employé pour le courrier. L’armement se réduit, en général, à quelques pièces de petit calibre (4 ou 6 livres) mais certaines, selon leur échantillonnage, seront plus lourdement armées.
 |
|
(94) Goélette Le Jean Bart - abordage d'un navire anglais - 09 02 1810
|
Le lougre (dénommé chasse-marée dans son emploi civil) utilisé par les Douanes et pour des missions de surveillance côtières. Le lougre est également employé comme bâtiment corsaire en Manche et en Mer du Nord. Le lougre corsaire embarque un équipage nombreux, une centaine d’hommes, en vue de l’abordage et quelques pièces d’artillerie de petits calibres (4 ou 6 livres).
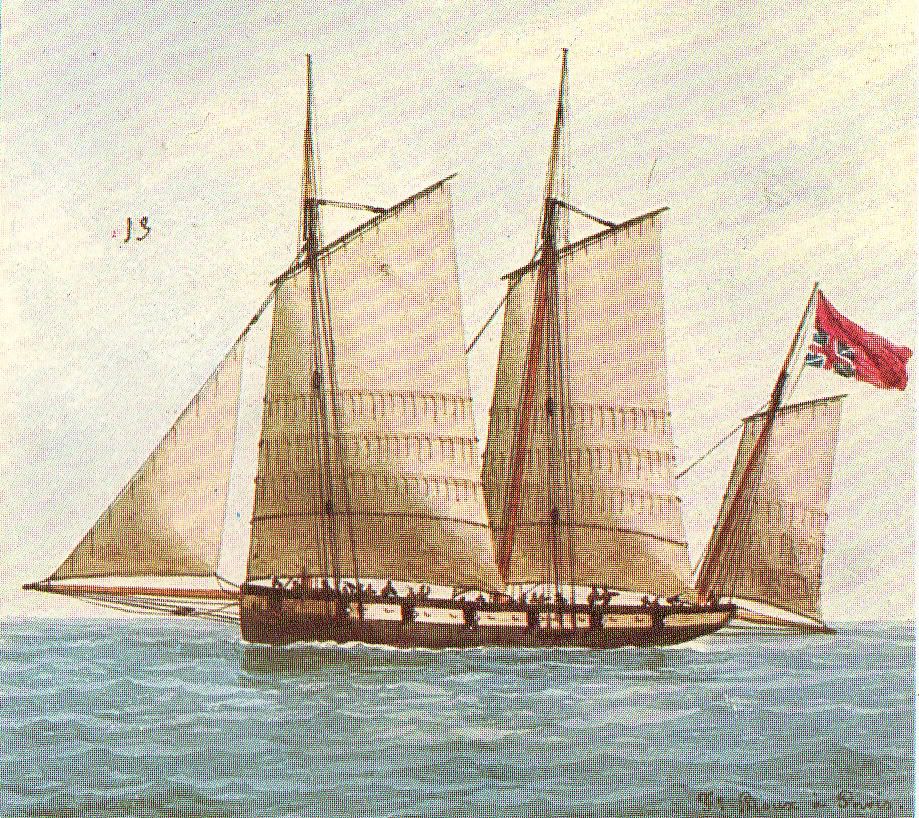 |
| (95) Le Pitt - Lougre corsaire anglais de Jersey - capturé par les Français - 1781 |
Le cotre, navire à mat unique. C’est le « cutter » des Anglais. Plus petit que le lougre, il sert aux mêmes missions. Surcouf affrètera un cotre, devenu célèbre, le Renard, de 70 tonneaux, armé de 10 caronades de 8 et 4 canons de 4 livres, et servis par 58 hommes. Il affrontera avec succès, dans la nuit du 8 au 9 septembre 1812, la goélette anglaise HMS Alphea, 16 canons, 16 pierriers et 80 hommes d’équipage. La goélette anglaise explosera entrainant tout son équipage dans la mort. Il reste alors 16 hommes valides sur Le Renard. L’expertise de boulets encastrés, pesant 16 livres françaises, dans la coque du Renard indique que la goélette anglaise portait probablement quelques pièces de 18 livres (la livre anglaise pesait 10% de moins que son équivalence française, soit environ 16 livres).
 |
| (96) Les cotres Telemachus & Wakeful engagent la corvette française La Foi - Printemps 1792. |
La chaloupe canonnière ou canonnière, bâtiment à fond plat ou faiblement quillé, à un pont couvert. Ces navires sont des batteries flottantes destinées à s’approcher au plus près des côtes et à remonter les embouchures des fleuves et rivières. Dans le cadre de la flotte d’invasion rassemblée à Boulogne-sur-Mer, de nombreuses canonnières seront construites. Elles devaient servir à la fois de barge de transport (chevaux de cavalerie inclus) et de batteries d’appui-feu lors du débarquement.
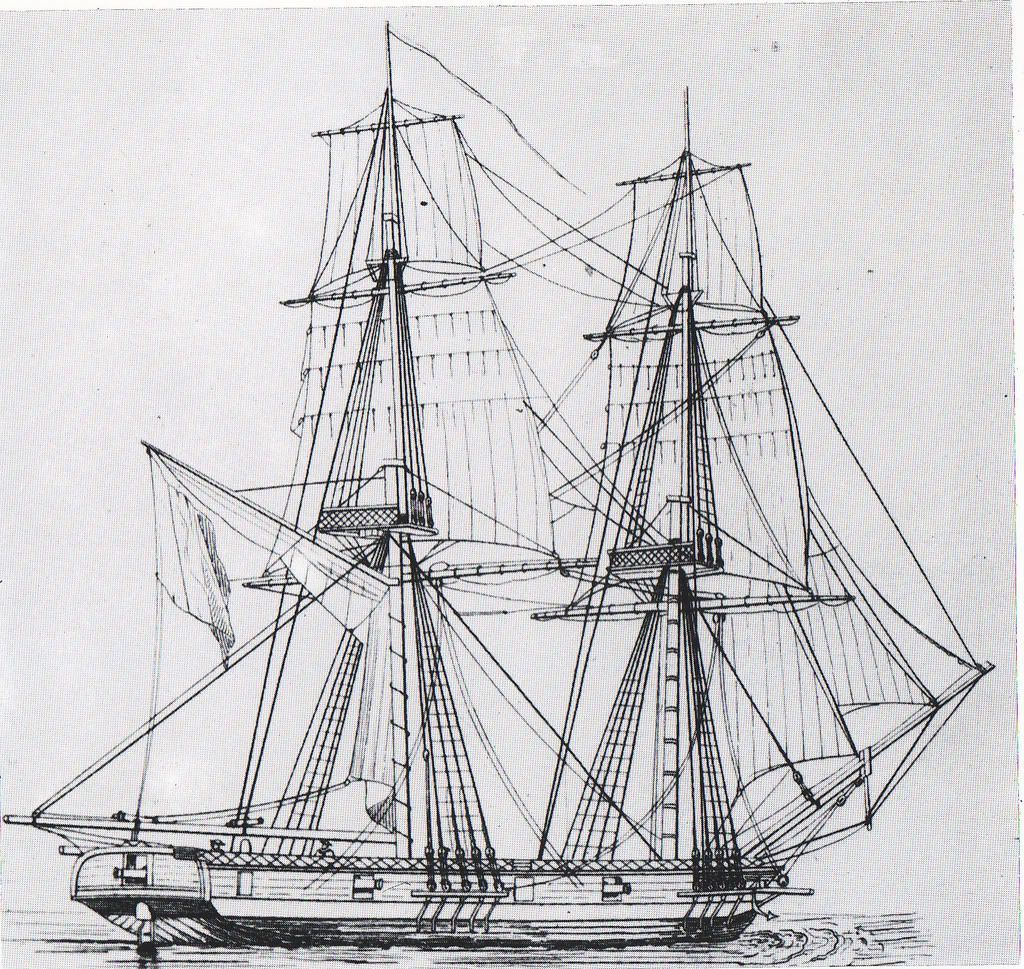 |
| (97) Canonnière de la flottille de Boulogne. |
La chaloupe armée en guerre, c’est une petite unité destinée à la protection des rades et des ports. Selon le cas, elles peuvent être manœuvrées à la rame ou à la voile. L’armement consiste en une unique pièce d’artillerie de moyen calibre ou gros calibre, 12, 18, voir 24 livres, montée sur une glissière longitudinale et tirant en chasse. Les chaloupes armées, compte-tenu de l’unique pièce embarquée, opèrent, la plupart du temps, en groupe de trois ou quatre unités.
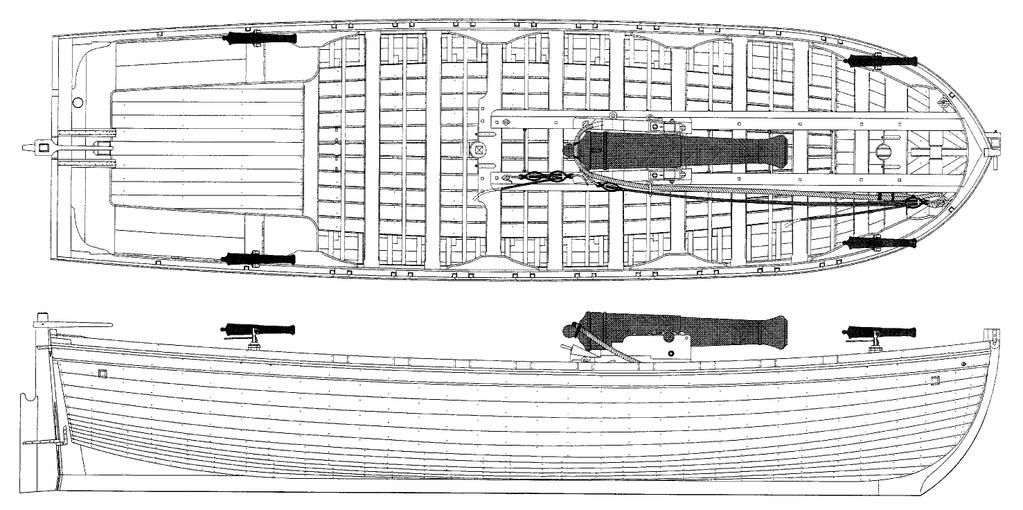 |
| (98) Chaloupe armée en guerre – 1834 |
Les navires de charge et de servitude.
Pour le ravitaillement des bases et des troupes des Colonies, la Marine à besoin de bâtiments de transport. Ce sont les flûtes et les gabares. Ces navires, à trois mâts, fortement ventrus, servent également à desservir les différents arsenaux du Royaume puis de l’Empire, en transportant des matières premières ou des produits finis. On parle aussi de bâtiments « armés en flûte ». Ils disposent d’une artillerie embarquée mais sont classés suivant leur tonnage, 600 tonneaux, 800 tonneaux, 1500 tonneaux.
En cas de nécessité, exemple, l’Expédition d’Egypte, l’Etat procède à la réquisition de navires au commerce avec leurs équipages, pour compléter sa flotte de servitude et indemnise (mal !) les capitaines et armateurs.
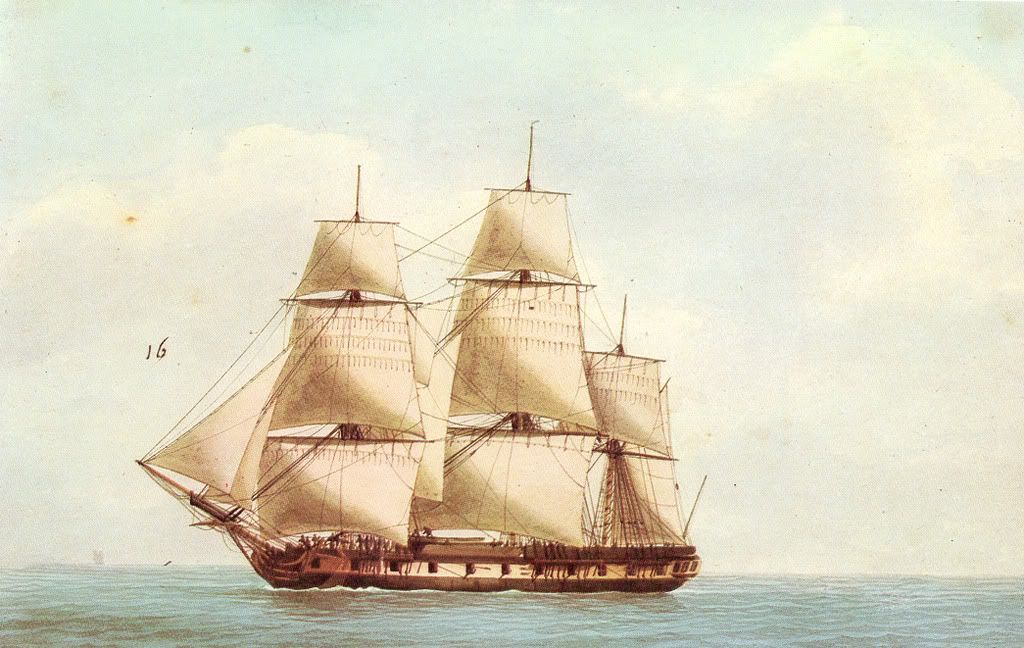 |
| (99) La Lionne – Gabare du Roy - 1787 |
La Seconde Guerre de Cent Ans (1688-1815)
Durant cette longue période, qui s’étend du règne de Louis XIV à l’abdication de Napoléon Ier, Français et Anglais ne cesseront de s’affronter. Les conflits se succèdent à intervalle régulier et, seuls, la Régence et le début de règne de Louis XV - ce qui lui vaudra, durant cette période paisible, le qualificatif de « Bien Aimé » - interrompent cette séquence guerrière.
Règne de Louis XIV (1661-1715)
1689-1699 – Guerre de la ligue d’Augsbourg ou guerre de Dix Ans.
1702-1713 – Guerre de Succession d’Espagne.
Régence (1715-1723)
1715 – 1723 – aucun conflit majeur.
Règne de Louis XV (1723-1774)
1744-1748 – Guerre de Succession d’Autriche.
1756-1763 – Guerre de Sept Ans.
Règne de Louis XVI (1774-1792)
1777-1783 – Guerre d’Indépendance Américaine.
République et Ier Empire.
1793-1802 – Guerre de la Révolution.
1803-1815 – Guerre de l’Empire.
Evolution de la flotte de guerre française
Sur la base d’un tableau existant dans l’ouvrage cité en source, j’ai greffé un certain nombre d’informations supplémentaires, notamment la standardisation des calibres au cours du XVIIIème siècle (le surlignage coloré précise la période de mise en place des calibres standardisés) et l’inventaire de la flotte en 1799 (les unités armées de moins de 10 pièces ne sont pas prises en compte), selon les documents officiels de l’époque. Cette récapitulation visualise l’évolution de la flotte française au cours d’un siècle et demi, flotte qui n’existe réellement qu’à partir de 1674.
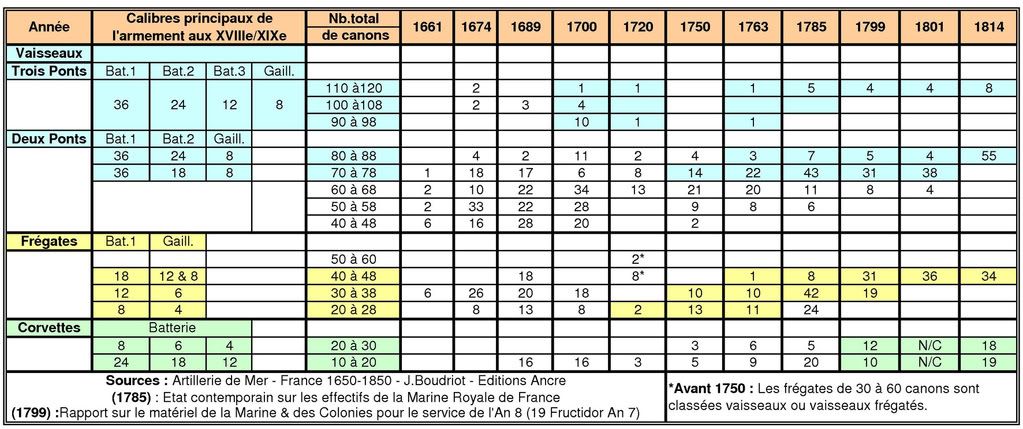 |
| (100) Evolution de la Marine Française, par type de bâtiments, entre 1661 et 1814 |
En 1661, premier inventaire Ce sont les restes des escadres de Richelieu et Mazarin, en tout, 18 bâtiments. Colbert dispose, en 1664, d’un tiroir-caisse correctement garni et peut satisfaire aux ambitions du Roy Soleil en lançant les bases d’une véritable marine de guerre. En dix ans, il en fait quantitativement la première flotte de guerre occidentale et qualitativement l’une des meilleures.
(I) 1689 – 1715 – La flotte du Roi-Soleil
La Grande Ordonnance de Colbert, en 1689, conserve les dispositions de 1670 mais y rajoute la longueur minimale des bâtiments, critère rarement respecté.
La politique navale de Louis XIV et de Colbert porte ses fruits et, à l’aube du XVIIIème siècle, en 1700, la Marine du Roy aligne fièrement un nombre de vaisseaux qu’elle n’atteindra plus jamais (15 trois-ponts et une centaine de deux-ponts). Mais, dès 1702, elle entame une période de déclin et la mort de Louis XIV, en 1715, sonne le début d’une longue période, cinquante ans, de vaches maigres pour la Royale.
Il est difficile d’évoquer cette période sans dire un mot de la victoire navale française – une rareté, comme vous allez le constater !-, le 10 Juillet 1690, sur la flotte coalisée anglo-hollandaise. Le combat se déroule dans la Manche, au large du Cap Béveziers qui fait face à la baie de Somme et couronne la période de 1688 à 1692, que les historiens navals dénomment « la Guerre d’Escadres ». En effet, ce sont des formations monumentales qui s’affrontent dans ces rencontres.
Le combat se déroule dans le cadre de la Guerre de la Ligue d’Augsbourg (1689-1699), Les Anglais le baptiseront bataille de Beachy Head, que notre célèbre pratique de la langue anglo-saxonne, transformera en Béveziers ! Alliée aux Hollandais, la flotte coalisée aligne 59 vaisseaux, dont 21 hollandais, commandés par l’amiral Herbert, la flotte française, sous les ordres de Tourville, en comporte 75 mais le nombre de pièces alignées est quasiment identique, les bâtiments ennemis étant plus lourdement armés. De surcroit, comme il n’est pas question de rompre avec nos bonnes vieilles habitudes, la composition de la flotte française, constituée à la va-vite, est un peu hétéroclite et intègre même une petite flottille de galères, stationnée à Dunkerque. Tourville prend la mer le 23 mai 1690.
Selon la tradition, les deux flottes se cherchent en Manche. Les Anglais surpris du désir d’en découdre des Français et par l’importance de leur flotte, bénéficient d’un répit grâce à des vents contraires et se replient dans le Pas-de-Calais, tandis que Tourville piétine au large du Cap Lizard, à l’entrée de la Manche. Considéré comme un carriériste par Seignelay, Secrétaire d’Etat à la Marine, Tourville se fait remonter les bretelles pour son attitude attentiste inqualifiable. Piqué au vif, il entame la remontée de la Manche en tirant des bords avec son escadre. Une monumentale manœuvre technique par vents contraires.
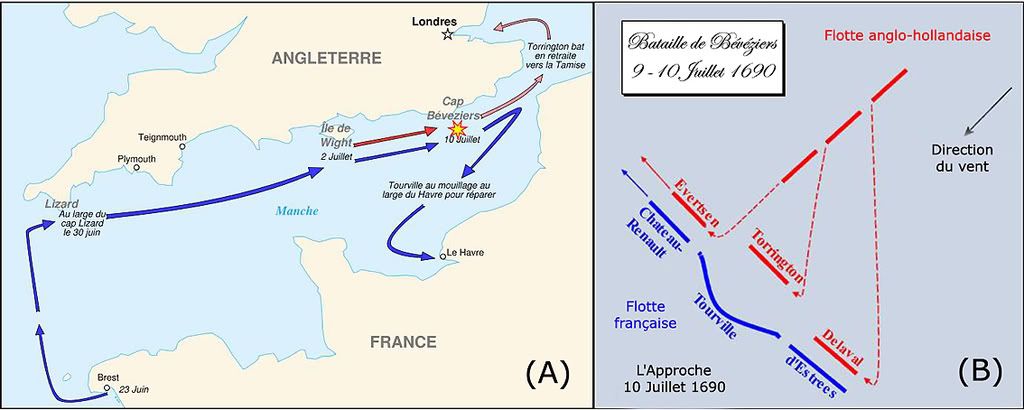 |
|
(101) Combat de Béveziers -1690 |
Après avoir louvoyé durant une semaine, il tombe sur la flotte ennemie devant Beach Head, le 8 ou 9 Juillet. Cette fois, la ramonée gouvernementale, c’est Herbert, l’amiral anglais, qui la prend. Il doit engager sa flotte sans délai.
Le 10 juillet, à neuf du matin, les deux escadres entament le combat. Le croquis (B) ci-dessus est révélateur de l’époque, la flotte anglaise bénéficie du vent et, dans des conditions similaires, un siècle plus tard, tout amiral britannique se serait empressé de rompre la ligne française pour isoler les trois escadres de Tourville. La manœuvre est au contraire des plus académiques, les divisions anglo-hollandaises manœuvrent pour venir prendre le bord au vent des Français.
 |
| (102) Le combat de Béveziers - gravure contemporaine. |
A 1H00 de l’après-midi, la flotte coalisée est en très mauvaise posture, la moitié de ses bâtiments est désemparée. Là, intervient un phénomène naturel important dans les eaux de la Manche, le changement de marée qui survient à 15H00. Le jusant entraine les bâtiments français vers les côtes anglaises, à l’Est, tandis que l’adversaire prévoyant a mouillé l’ancre.
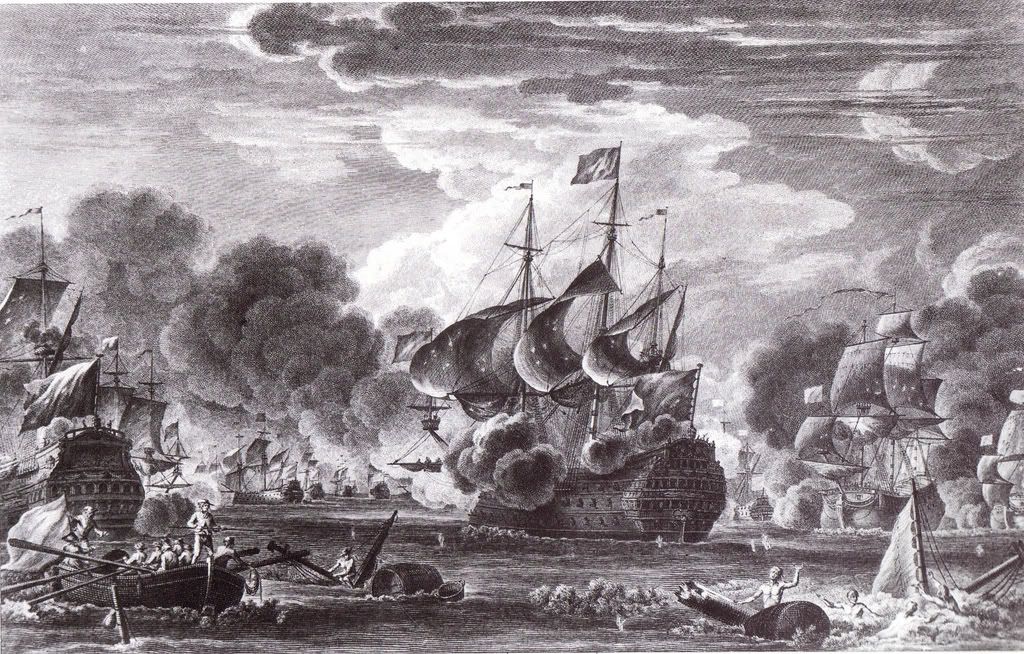 |
| (103) Combat de Béveziers – 10 Juillet 1690 – gravure de Nicolas Ozanne (1728-1811) |
Tandis que les Français luttent contre le courant et le vent contraire, on se concerte vite fait du côté des Anglo-hollandais et décide de profiter de la prochaine renverse, dans la nuit, pour faire voile à l’Est. Les bâtiments trop endommagés sont sabordés et, dans la nuit, Arthur Herbert of Torrington et sa flotte mettent voile sur l’entrée de la Tamise, abandonnant au passage, quelques trainards, dont certains préfèrent s’incendier, aux mains des Français. Tourville a bien donné la chasse à la flotte coalisée mais a conservé la disposition de combat en ligne et, dans ce cas, la vitesse de l’escadre est celle du moins rapide de ses navires. Ce qui laisse le temps à la plupart des fuyards de rejoindre l’abri des fortifications anglaises.
Comme, au même moment, le Roi d’Angleterre, Guillaume d’Orange, est en Irlande avec le gros de son armée, les Londoniens commencent à paniquer, craignant un débarquement français, et réclament des têtes dont celle d’Herbert, coupable, à leurs yeux, d’incompétence. Il sera acquitté par le Conseil de Guerre mais ne retrouvera ni un nouveau commandement ni son siège à la Chambre des Lords
En fait, Tourville n’exploite pas sa victoire, et, hormis quelques actions isolées dont celle des galères françaises, il ramène tout son monde à l’embouchure de la Seine pour procéder aux réparations puis rallie Brest. A son arrivée, il se retrouve accusé de manque de courage tactique pour ne pas avoir donné la chasse plus assidument à la flotte coalisée, ni débarqué en Angleterre, ce qu’il aurait été bien en peine de faire, sans troupe de débarquement suffisante, ni avoir pris l’initiative d’engager sa flotte dans le Canal d’Irlande pour empêcher Guillaume d’Orange de rentrer en Angleterre. J’avais oublié de vous préciser que cette action navale s’inscrivait dans le cadre d’un débarquement français en Irlande, au mois de mai précédent, destiné à remettre sur le trône, Jacques II d’Angleterre, prédécesseur malheureux de Guillaume d’Orange. Les forces franco-jacobites, dont 7000 soldats français seront écrasées, le 12 juillet 1690, à la bataille de la Boyne, deux jours après la victoire de Tourville.
Béveziers est considéré comme une victoire navale française. Preuve en est, la discrétion de rosière des historiens navals britanniques sur le sujet. Mais c’est aussi un de ces engagements indécis qui deviendront coutumiers de la Marine française, encore que l’adjectif « coutumier » soit très excessif, la tendance, au cours des cent-cinquante ans que nous allons survoler, étant plutôt à la défaite sans équivoque.
Les Anglo-hollandais ont perdu 17 vaisseaux, principalement hollandais et surtout sur sabordage, les Français, aucun. Mais à l’abri de Spitehead, la flotte britannique intacte se refait rapidement une santé et se vengera aux batailles de Barfleur et la Hougue, 29 mai au 2 juin 1692, en détruisant douze vaisseaux de ligne français. Cà, c’est net, clair et ne prête pas à discussion !
Duguay Trouin s’empare de Rio de Janeiro - 1711
Parmi les exploits maritimes lointains, il y a l’opération montée par Duguay Trouin, en 1711, contre les Portugais. Au début du XVIIIème, la colonie portugaise du Brésil fait des envieux et, plus particulièrement, sa colonie de Rio de Janeiro « l’une des plus riches et des plus puissantes du Brésil ». Il faut juste rappeler que dans les années 1550, les Français s’installent sur les côtes d’Amérique du Sud et fondent une colonie à Rio, qui bénéficie d’une rade exceptionnelle ; mais, suite au désintérêt de la Couronne pour ces contrées éloignées, ils se font virer comme des malpropres par les Portugais et ont juste le temps de s’accrocher aux branches de la forêt guyanaise, toujours française de nos jours.
Les Français ont la rancune tenace et ce n’est pas l’étalage de richesse de Rio qui va cautériser la plaie. Aux alentours de 1710, un dénommé Du Clerc, capitaine de vaisseau de son état, s’en va, avec cinq vaisseaux et 1000 soldats des troupes de Marine, à la conquête de la future capitale de la samba. Du Clerc omet juste un léger détail, la colonie est protégée par sept forts bien fournis en artillerie et hommes de troupe. Je vous laisse deviner le sort de l’expédition…les cinq vaisseaux sont détruits ou capturés, Du Clerc est fait prisonnier avec les 700 survivants de son corps expéditionnaire.
Une fois l’écho de la pilée parvenu à Versailles, çà fait comme un petit nuage sombre sur le front lumineux du Roi-Soleil. En plus, les nouvelles signalent que les prisonniers français sont maltraités et que Du Clerc s’est fait raccourcir le kiki dans des conditions bizarres, au fond de son cul-de-basse-fosse. Cà a tendance à plisser un peu plus le front altier de notre bon roi Louis et ce n’est pas bon signe. Cà tombe bien, Duguay Trouin, qui s’est taillé une belle réputation de corsaire à la fin du siècle, en capturant 100 bâtiments au commerce et 16 navires de guerre, exploits pour lesquels il a été anobli en 1709, se fait fort de s’emparer de Rio et venger l’affront. S’en suit un montage financier semi-public, l’Etat met à disposition une flotte de 17 navires et un détachement de 2200 soldats des troupes de Marine et des Colonies, charge aux intérêts privés d’en assurer les frais d’entretien et l’armement des bâtiments.
A l’été 1711, tout ce beau monde, y compris 26 hautbois et violons, prend la direction du Brésil. Entre-temps, le Roi du Portugal méfiant, à renforcer son dispositif militaire en expédiant, 4 vaisseaux, 3 frégates et des troupes supplémentaires qui porte les effectifs de Rio à 12 000 soldats !
Début septembre, la flotte française, qui s’est enrichie d’une prise en cours de route, est en vue du Pain du Sucre. Elle réussit à forcer le goulet qui donne accès à la baie de Rio. Ce qui n’est pas une mince affaire, car la passe, qui fait à peine quatre kilomètre de large est balayée, par l’artillerie de deux forts portugais. En principe, les batteries à terre, généralement situées en hauteur, peuvent tirer à boulet rouge sans risquer d’incendier leurs murailles en pierre, et sont plus précises que les canons de navires aux prises avec la houle et positionnés au ras de l’eau.
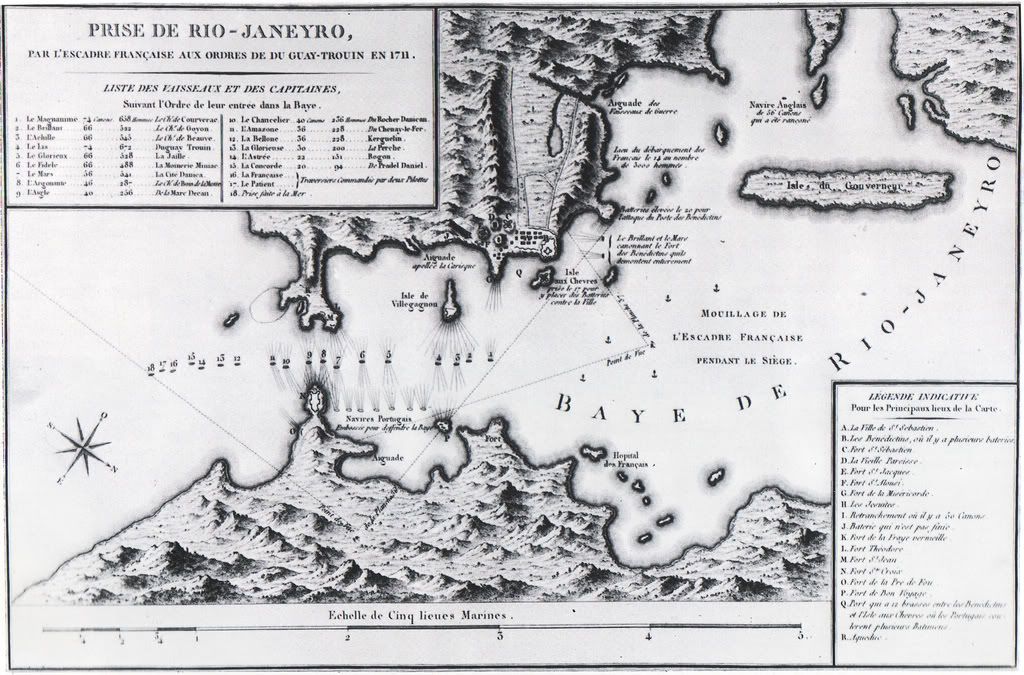 |
(104) Prise de Rio de Janeiro par Duguay Trouin – 1711 |
Le 14 septembre, Duguay Trouin, sur son navire-amiral, Le Lis, débarque sans encombre, au nord de la baie, un corps de 3300 hommes, constitué des soldats et de marins sélectionnés dans les équipages. Il y a bien 500 malades du scorbut mais, une fois à terre, ils se rétablissent assez rapidement.
Le 19, il envoie, selon les règles de l’époque, un tambour porter une sommation et une lettre de doléances au gouverneur portugais. Par son courrier, Duguay Trouin exige la restitution des prisonniers français et la remise des coupables de la mort de Du Clerc et d’exactions sur les captifs. La réponse a beau être fort courtoise, çà ressemble plus à un bras d’honneur surmonté d’un majeur très inconvenant, qu’à une invitation à diner. Le gouverneur brésilien invoque un accident malencontreux pour la mort de Du Clerc, justifie le traitement infligé aux survivants par l’absence (apparente) de commission officielle de course, fait remarquer à Duguay Trouin que ce n’est pas sa force de débarquement ridicule qu’il risque de le déloger et conclut le plus aimablement possible en lui souhaitant santé et prospérité sous la protection divine.
Comme les Français ne se sont pas coltinés tout ce voyage pour échanger des amabilités, Duguay Trouin donne le signale de l’attaque. Apparemment, l’appât du gain français a raison de la forte garnison portugaise quatre fois plus importante et Rio tombe aux mains de l’expédition française. Le pillage de Rio offrira 92 % de bénéfices, tous frais déduits, aux « sponsors » de l’opération, dont Duguay Trouin lui-même. Il finira sa carrière comme Lieutenant-général des Armées Navales de France.
(D’après les Mémoires de Duguay Trouin)
La guerre de course du XVIIème au XIXème siècle
Si la guerre de course s’inscrit dans le contexte militaire d’un conflit, elle comporte une facette lucrative non négligeable. Les disponibilités des flottes de guerre nationales ont leurs limites et la chasse aux navires du commerce ennemis accaparerait trop de petits bâtiments, indispensables au service des escadres. Mais les lois maritimes sont strictes, tout équipage, sans accréditation officielle de son gouvernement, qui s’en prend à un navire, même entre nations adverses en temps de guerre, est considéré comme pirate et finit pendu en bout de vergue, sans autre forme de procès. Même un capitaine de bâtiment militaire doit pouvoir justifier du caractère officiel de son commandement – c’est d’ailleurs le rôle de la flamme de guerre hissée à l’extrémité du grand-mât qui signale que le commandant de bord s’est vu confié son poste par son gouvernement de tutelle.
Durant les guerres, il y a deux solutions pour faire un peu d’argent sur mer. Soit réussir à ramener une cargaison sans se faire arraisonner, soit s’emparer de la cargaison de navires marchands ennemis. Il y a tout un tas de marins expérimentés ou d’officiers de marine en disponibilité qui ne demandent qu’à prendre la mer pour ferrailler, de nombreux armateurs, prêts à investir dans des opérations risquées mais juteuses, et des chantiers navals en quête de commandes. Les gouvernants ont vite compris qu’ils pouvaient s’enrichir, eux aussi, à moindre frais. Moyennant un généreux pourcentage sur les futures prises, les états maritimes établissent des « lettres de marques ». En temps de guerre, ces documents officialisent le statut militaire de ces armements civils et leur donnent le droit de chasser tout bâtiment ennemi. C’est le statut du corsaire, qui, assimilé, dès lors, à un militaire, bénéficie, en cas de capture, du statut de prisonnier de guerre…enfin, le plus souvent. Toutes les nations européennes et plus tard, les Etats-Unis, auront leurs flottes corsaires. Drake, nommé amiral par Elisabeth Ier, Reine d’Angleterre, n’est, au départ, qu’un corsaire chanceux. Il semble même, d’après certaines sources, qu’il ait d’abord goûté à la piraterie pour se faire la main.
Avec la contrebande qui se pratique aussi bien en temps de paix qu’en période de guerre, dans ce dernier cas, le prix des marchandises augmente au vu des risques encourus, la guerre de course est une véritable économie mais limitée à la durée de la guerre. Comme, à l’époque, il ne se passe guère sans que la France ne soit en bisbille avec un de ses voisins, elle finit par y acquérir une certaine pérennité.
Certaines cités côtières comme Saint-Malo ou Dunkerque s’en font une spécialité et bâtiront leur réputation sur de véritables lignées de marins pour qui le métier de corsaire devient une affaire de famille. Certains ont gagné la postérité, à l’instar d’un Jean Bart, d’un Duguay Trouin ou d’un Surcouf. D’ailleurs, les plus talentueux se voient souvent conférer, plus tard, de hauts postes militaires. Duguay Trouin finit sa carrière comme lieutenant-général, Jean Bart comme chef d’escadre et si Surcouf, jeune officier de marine recyclé en corsaire, refuse le grade de capitaine de vaisseau et le commandement d’une escadre, offerts par Napoléon, il se voit néanmoins attribuer le titre de baron d’Empire. Les officiers du Noble Corps seront souvent attirés par la guerre de course car elle correspond plus à leur esprit indépendant, qui a toujours caractérisé la noblesse française, et à leur recherche de panache que la discipline rigide de l’évolution en ligne des vaisseaux de guerre de la Royale.
La guerre de course se déroule principalement dans les eaux territoriales de la Métropole et les corsaires procèdent surtout par raids rapides de quelques jours de mer. La préférence est donnée à de petits bâtiments rapides, bons voiliers, légèrement armés, capables d’embarquer un équipage nombreux. Les proies sont les caboteurs et les navires au commerce ennemis. On va même les capturer dans les ports et les havres de l’adversaire. En principe, les corsaires évitent soigneusement de se colleter avec les bâtiments de guerre, généralement lourdement armés. Le séjour étant de brève durée, le confort du bord, le stock de vivres et d’eau douce sont réduits au strict nécessaire. Les navires sont armés en course, soit par les capitaines quand ils en ont les moyens, soit par des armateurs qui se remboursent sur les prises et leur cargaisons. L’état-major et l’équipage sont rémunérés en parts de prise. Pour les plus chanceux et les plus malins, la discipline dans la corporation est moins stricte que sur les bâtiments de guerre et la paye bien supérieure aux misérables soldes, souvent payées en retard, de la marine d’Etat mais le métier est à hauts risques et, durant les guerres de l’Empire, 27 000 corsaires français iront rejoindre leurs compagnons d’infortune, marins d’Etat, sur les pontons anglais, redoutables prisons flottantes où croupiront plus de 120 000 hommes. Certains prisonniers passeront, parfois, plus de dix ans de leur vie sur les pontons.
Nota : Louis Garneray, peintre de marine et écrivain qui servit avec Surcouf, relatera ses dix ans d’internement dans un livre intitulé, « Un corsaire au bagne ou mes pontons », dont on doit pouvoir encore se procurer la réédition chez Phébus.
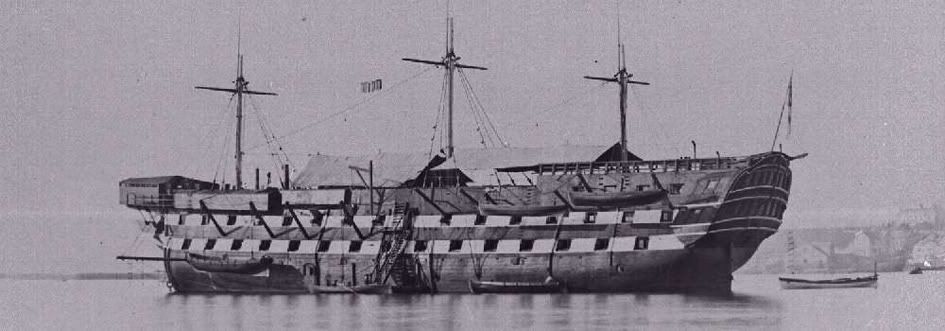 |
|
(105) HMS Canopus, ex-vaisseau français de 80 Le Franklin, capturé à Aboukir en 1798, terminera sa carrière comme ponton.
|
Bien entendu, on trouve également des équipages corsaires dans nos Colonies, généralement constitués de marins du crû. Les possessions françaises dans les Mascareignes – Ile Bourbon (La Réunion), Ile de France (Maurice) - et dans la Mer des Antilles sont idéalement situées par rapport aux routes commerciales des Indes Orientales et Occidentales, où croisent navires anglais, hollandais, espagnols ou portugais.
Certains corsaires « métropolitains » iront pratiquer leur art dans des mers lointaines. Surcouf notamment, mais ce n’est pas le seul, se taillera sa réputation dans les eaux de l’Océan Indien, à la charnière du XIXème siècle. La guerre de course transocéanique nécessite des moyens financiers beaucoup plus importants, un équipage et un état-major expérimentés, généralement issus voir « détachés » de la Royale. Les navires utilisés sont beaucoup plus proches du standard d’une corvette ou d’une petite frégate, la vitesse restant un élément primordial. Ces corsaires océaniques travaillent parfois en petite flottille. Les équipages embarquent pour de longues croisières ; il faut un trimestre, dans les meilleures conditions, pour rallier l’Océan Indien. Les routes commerciales sont dépendantes des vents dominants et, un corsaire malchanceux, une fois arriver sur sa zone d’opérations peut très bien se retrouver avec une mer vide de toute prise possible durant de longs mois et devoir taper dans la caisse pour subvenir au quotidien. En dépit des images d’Epinal, un marin est nettement moins performant le ventre vide. En plus, le scorbut guette l’équipage et, dans les mers chaudes, le taret, une cochonnerie de ver qui peut atteindre près d’un mètre de long et l’épaisseur d’un poing, raffole des coques en bois et détruit un navire bien plus vite que le chantier n’a mis de temps pour le construire !...Un remerciement ému aux Brits qui, dans les années 1760, ont inventé le doublage en cuivre des fonds, contraignant le taret au régime sec !...Il reste bien les cultures d’algues et les coquillages mais ce ne sont que moindres maux qui nécessitent juste de l’huile de coude.
Bien entendu, on trouve également des équipages corsaires dans nos Colonies, généralement constitués de marins du crû. Les possessions françaises dans les Mascareignes – Ile Bourbon (La Réunion), Ile de France (Maurice) - et dans la Mer des Antilles sont idéalement situées par rapport aux routes commerciales des Indes Orientales et Occidentales, où croisent navires anglais, hollandais, espagnols ou portugais.
Certains corsaires « métropolitains » iront pratiquer leur art dans des mers lointaines. Surcouf notamment, mais ce n’est pas le seul, se taillera sa réputation dans les eaux de l’Océan Indien, à la charnière du XIXème siècle. La guerre de course transocéanique nécessite des moyens financiers beaucoup plus importants, un équipage et un état-major expérimentés, généralement issus voir « détachés » de la Royale. Les navires utilisés sont beaucoup plus proches du standard d’une corvette ou d’une petite frégate, la vitesse restant un élément primordial. Ces corsaires océaniques travaillent parfois en petite flottille. Les équipages embarquent pour de longues croisières ; il faut un trimestre, dans les meilleures conditions, pour rallier l’Océan Indien. Les routes commerciales sont dépendantes des vents dominants et, un corsaire malchanceux, une fois arriver sur sa zone d’opérations peut très bien se retrouver avec une mer vide de toute prise possible durant de longs mois et devoir taper dans la caisse pour subvenir au quotidien. En dépit des images d’Epinal, un marin est nettement moins performant le ventre vide. En plus, le scorbut guette l’équipage et, dans les mers chaudes, le taret, une cochonnerie de ver qui peut atteindre près d’un mètre de long et l’épaisseur d’un poing, raffole des coques en bois et détruit un navire bien plus vite que le chantier n’a mis de temps pour le construire !...Un remerciement ému aux Brits qui, dans les années 1760, ont inventé le doublage en cuivre des fonds, contraignant le taret au régime sec !...Il reste bien les cultures d’algues et les coquillages mais ce ne sont que moindres maux qui nécessitent juste de l’huile de coude.
 |
| (106) La Confiance et le Kent - 7 Aout 1800 - Huile de Louis Garneray |
Le 7 Aout 1800, dans Golfe du Bengale, La Confiance, petite corvette de 18 canons et 190 hommes, commandée par Robert Surcouf, rencontre le Kent, 38 canons, 437 homme, un gros vaisseau armé en guerre de la Compagnie des Indes britanniques. Le Kent transporte un général, son état-major, 200 soldats…et un contingent de passagères ! A l’aperçu, le Kent envoie le pavillon danois. Officiellement, le Danemark est neutre mais, en réalité, les Britanniques tirent les ficelles en sous-main. Surcouf, méfiant, poursuit son approche. En fait, l’état-major du Kent essaye de le leurrer pour mieux foudroyer La Confiance de sa batterie lorsqu’il sera à portée de tir. Les Anglais sont tellement sûrs de leur force que le commandant du Kent convie ses passagères à assister, sur la dunette, à la correction de l’insolent français. Mais çà ne se passe pas du tout comme prévu, et, en dépit de quatre salves anglaises sans dégâts notoires, hormis la perte du petit mât de perroquet, Surcouf finit par aborder le Kent sur sa hanche tribord arrière. A bord de l’Anglais, tout le monde est convaincu que la Confiance est désemparée et on se bouscule au couronnement pour jouir du spectacle mais c’est pour découvrir que les corsaires montent à l’abordage. La différence de taille des deux navires est telle que la vergue de grand-voile, à la hauteur du pont anglais, sert de passerelle aux matelots français. Du haut des hunes françaises, les gabiers font pleuvoir des grenades et jettent même les corps de leurs camarades tués sur l’adversaire, rassemblé sur le pont du Kent. L’équipage et la troupe britannique se retranche sur le gaillard d’arrière mais Surcouf, la hache à la main, mène lui-même l’attaque finale et Le Kent est pris après un combat rapide mais violent. Les Français enregistrent 20 morts et on en décompte 70, côté britannique. Surcouf accorde deux heures de « part du diable » (pillage) à son équipage mais exige que les bagages personnels en soient exclus et fait garder les cabines des passagères par des hommes en armes. Un peu plus tard, il les transborde, avec les autres survivants anglais, sur un bâtiment arabe, qui croisait sur le lieu du combat, pour les ramener à terre, contre une promesse d’échange de prisonniers. Surcouf rejoint l’Ile de France, maintenant l’Ile Maurice, avec sa prise et un joli butin dans les cales puis, le 29 janvier 1801, regagne Bordeaux.
La dernière grande époque de la course française se déroule sous le règne de Napoléon Ier, qui espère, par son entremise, mettre à genoux le commerce maritime indispensable à l’Angleterre ilienne. En 1810, la France enregistre son plus beau score, plus de 600 prises grâce à ses corsaires, mais le commerce de la Couronne britannique s’appuie sur une flotte commerciale de 24 000 navires sur toutes les mers du monde ! Les années suivantes, la Royale Navy emploie les grands moyens. Elle constitue des convois escortés dont certains comptent jusqu’à un millier de bâtiments, gère le calendrier des croisières, et accroit sa surveillance des routes maritimes. Les troupes britanniques s’installent au Cap, jusque là, colonie hollandaise, pour surveiller la route de l’Océan Indien, capturent nos possessions des Mascareignes, des Antilles, et de Saint-Pierre et Miquelon, nous privant ainsi de bases vitales. Vous connaissez les assureurs et leur goût prononcé pour le risque ? En 1810, les Lloyds de Londres pratiquent un taux d’assurance de 6% sur la cargaison et les navires alors qu’il était de 50% durant la guerre d’Indépendance Américaine ! Autrement dit, la guerre de course française, n’a pas eu de réel impact sur le cours du conflit.
(II) 1715 – 1776 – Une Marine aux abonnées absents
Grand remaniement en 1744, les rangs, dont le nombre total passe à six, comportent dorénavant une déclinaison supplémentaire en trois « ordres » et récapitulent les principales caractéristiques des navires (longueur, largeur, creux…).
Mais ces dispositions sont plus théoriques que pratiques, car la Marine royale traverse toujours sa période de disette et de restrictions budgétaires comme le prouve son inventaire de 1750 qui révèle une absence totale de trois-ponts et une flotte de navires de ligne constituée de bâtiments de deuxième et troisième rang (74 et 64 canons). Comme tout n’est pas noir dans ce tableau, on constate, à partir de cette époque, la standardisation progressive des classes 80 et surtout 74 canons. Initiative française que reprendront les autres nations occidentales, les Anglais, avec le deux-ponts de 70 canons, les Espagnols, avec, dans un premier temps, un 70 canons calqué sur le modèle britannique, puis un 74, pendant du modèle français.
Guerre de Sept Ans, le premier conflit mondial.
A partir de 1756, sous le règne de Louis XV, débute un la Guerre de Sept Ans, qui pour nombre d’historiens est la première guerre mondiale, dans son acceptation géographique. Elle va se dérouler en Europe, d’une part, entre la Prusse du roi Frédéric II et l’Autriche de l’impératrice Marie-Thérèse, d’autre part, entre les deux ennemis historiques, la France et l’Angleterre qui vont s’affronter, par le biais de leurs colonies, au Canada, aux Antilles, en Inde et même au Sénégal. Par le jeu des alliances, la Prusse et l’Angleterre sont dans un camp, les Français, les Autrichiens, la Russie et la Suède, dans l’autre. L’exportation de la guerre dans les territoires éloignés exige des moyens maritimes conséquents et, sur ce plan-là, la France n’est pas dans une situation favorable. A contrario, la Couronne britannique dispose de la Royal Navy et d’une imposante flotte de commerce dont une part non négligeable est constituée de bâtiments armés qui constitue une force d’appoint paramilitaire fort utile. A la différence des Français, elle n’entretient qu’une armée terrestre professionnelle de taille relativement modeste mais la part budgétaire de sa marine a toujours fait partie de ses priorités. Enfin, ses colonies sont beaucoup plus peuplées que les françaises. La proximité des colonies américaines et la coupure de ses lignes de communication maritime avec la Métropole scellera le sort du Canada français, privé de renforts.
La première année du conflit débute sous d’heureux auspices. La flotte de Méditerranée, avec 12 000 hommes, s’empare de l’ile de Minorque où les Anglais disposent d’une importante base navale. L’amiral anglais défait se verra condamner à la peine capitale par son Amirauté. La Corse est également occupée par les forces françaises.
Les deux années suivantes, l’Angleterre organise des raids sur les côtes atlantiques et les ports français de Rochefort, Saint-Malo, Cherbourg. Ces opérations sont limitées en temps et après avoir détruit les installations portuaires, les troupes britanniques rembarquent et reprennent la mer.
1759 est une année sombre pour les armées françaises. Alors que nos troupes piétinent en Hanovre, l’état-major français met la dernière main à un projet de débarquement sur les côtes anglaises sans se poser de question sur les capacités navales de sa flotte. Le portefeuille de la Marine vient d’être confié à certain Berryer, ancien lieutenant de police, plus compétent en répressions en tout genre qu’en art naval et la Marine retombe dans ses vieux travers, luttes de prérogative entre officiers, équipages peu ou mal entrainés. La flotte française est sensée s’assurer la suprématie maritime mais subie deux lourdes défaites. Le 19 Aout, une division de l’escadre de Toulon, en état d’infériorité, se fait étriller à Lagos, en vue des côtes portugaises. La flotte du Ponant, sort de Brest, le 14 novembre 1759. Le Maréchal de France, Hubert de Brienne, Comte de Conflans, malgré ses 75 ans est un officier-général compétent et expérimenté ; il a bien tenté de retarder la sortie de son escadre mais il est contraint de prendre la mer avec 21 vaisseaux de médiocre qualité et des équipages frisant l’incompétence. Sa première mission est d’embarquer des troupes à Auray. Le 20 novembre, il tombe sur l’escadre anglaise de Hawke, avec ses 27 vaisseaux et 6 frégates, tente de lui échapper en passant entre Belle-Ile et Quiberon par les Cardinaux mais la flotte anglaise rattrape son arrière-garde, coulent deux vaisseaux et en démolit un troisième. Là-dessus, arrive une tempête et, dans la nuit, 8 vaisseaux français s’esquivent vers Rochefort, laissant en plan le reste de l’escadre qui va se réfugier, après avoir balancé ses canons par-dessus bord, dans l’embouchure de la Vilaine. Les navires réfugiés dans la Vilaine, y pourriront pendant deux ans, empêchés de sortir par la surveillance anglaise. Deux bâtiments, dont le Soleil Royal, s’échouent au Croisic, se sabordent et un troisième, le Juste, coule à l’embouchure de la Loire. Cette défaite est connue sous le nom de Bataille des Cardinaux ou de Quiberon.
 |
| (107) Combat des Cardinaux – 20 novembre 1759 |
Cette peinture de R. Wright se situe le lendemain du combat. Sur la droite, on distingue le Soleil Royal et Le Héros, en flammes après le sabordage. Au premier plan, à droite, Le Résolution drossé sur les récifs par la tempête. Au fond à gauche, le Formidable, capturé, est en remorque d’un vaisseau anglais.
Au Canada, dès 1755, débutent les guerres indiennes où Anglo-américains et Français vont s’affronter, durant cinq ans. Malgré des débuts favorables sous la direction de Montcalm, Québec, assiégée par une escadre anglaise, tombe aux mains des Anglais en 1759 et, à l’exception de quelques points de résistances qui poursuivront le combat quelques temps encore, la prise de Montréal en septembre1760, marque la fin des possessions françaises du Canada. Les Français montent une petite expédition en 1762, pour tenter de reprendre pied sur les côtes de Terre-Neuve, en vue des négociations de paix, mais, à peine forte de 500 hommes, elle est vouée à l’échec.
En Inde, comme au Canada, les premières opérations, entamées en 1756, sont en faveur des Français, d’autant plus qu’ils bénéficient de l’appui des troupes d’un des plus puissants princes indiens, le Nawab Sirajud Dawla. Les Anglais, grâce à leur flotte, bénéficient de renforts mais, surtout, un allié opportun vient leur sauver la mise, le général des troupes du Nawab, accessoirement oncle dudit prince, passe de leur côté avec armes et bagages ! Malgré quelques succès mineurs, les Français abandonnent leurs prétentions indiennes, après la chute de Pondichéry assiégé, le 15 janvier 1761.
Le 10 février 1763, après deux ans de négociations chaotiques, Français et Espagnols signent le Traité de Paris avec les Anglais qui met fin aux hostilités. Autrichiens et Prussiens, feront de même, cinq jours plus tard, avec un traité séparé.
La facture est lourde pour la France, qui perd le Canada, une partie de ses possessions aux Antilles, se fait virer d’Inde, où elle ne conserve que cinq comptoirs, Pondichéry, Chandernagor, Karikal, Yanahon, Mahé, et du Sénégal, à l’exception de l’ile de Gorée (Où est née ma Môman !). La marine française en sort ruinée, elle n’aligne plus que 27 navires de ligne de la classe 74 ou supérieure et son avenir parait compromis.
Pourtant, le Secrétaire d’Etat à la Guerre et la Marine, Etienne François, duc de Choiseul-Stainville, nommé en 1761, réussit la prouesse de récolter treize millions de louis pour la reconstruction de la Flotte. En 1765, il établit une nouvelle Ordonnance. Elle annonce la grande Ordonnance de 1786 qui régira la Marine jusqu’à la Restauration. La France renoue avec la construction de trois-ponts, notamment avec le Ville de Paris, lancé en 1764. Les techniques de montage se sont améliorées et deviennent plus rigoureuses. Néanmoins, le trois-ponts, réalisation de prestige au prix prohibitif, reste, dans toutes les marines, une fabrication limitée à quelques unités, généralement moins d’une demi-douzaine, dans le meilleur des cas. Avec la standardisation des calibres par batterie, le 64 canons entame son déclin, au profit du 74, à l’armement mieux équilibré.
(III) 1777 – 1788 – Renouveau et revanche aux Amériques.
Sous l’impulsion de deux Secrétaires à la Marine compétents, Antoine Raymond de Sartine, de 1774 à1780, puis Charles Eugène Lacroix, marquis de Castries, de 1780 à 1787, la marine royale achève sa reconstruction et va se comporter de manière exemplaire durant la Guerre d’Indépendance Américaine.
Suite à la reconnaissance du nouvel état américain, par Louis XVI, en décembre 1777, les hostilités reprennent entre la France et l’Angleterre, en juin 1778. Le premier affrontement a lieu le 17 juin 1778, entre deux frégates de 12, la Belle Poule et l’Arethusa, au large des côtes bretonnes.
 |
|
(108) Combat du HMS Arethusa et de la Belle Poule - 17 juin 1778 - gravure d’époque
|
La frégate française appartient à une petite division de quatre bâtiments, deux frégates, La Belle Poule et la Licorne, la corvette l’Hirondelle et le lougre le Coureur. Après quatre heures de combat, entamé à l’heure du diner (18 H00), L’Arethusa très endommagée profite d’une brise favorable pour rejoindre le gros de la flotte anglaise. La Belle Poule ne peut exploiter son avantage et, sous la menace de deux autres frégates britannique, venues à la rescousse, doit se réfugier dans l’anse de Cam Louis. La Belle Poule est en triste état mais deux bâtiments français trompent la vigilance des Anglais, sortent de Brest, viennent lui porter assistance et l’escorter pour le retour.
 |
| (108b) Arethusa et Belle Poule – Le combat se poursuit dans la nuit. |
Le bilan militaire n’est pas particulièrement mirobolant car la Belle Poule est très endommagée et enregistre de nombreuses pertes. De surcroit, à l’exception de la corvette, l’Hirondelle, qui réussit, elle aussi, à s’échapper, ses deux autres conserves, la frégate de 12, la Licorne, et le lougre, le Coureur, sont capturés par la flotte ennemie. Néanmoins, cet engagement est monté en épingle par la Cour. Promotions, brevets et primes exceptionnelles sont distribués aux survivants. Un véritable engouement se crée pour cette « victoire » française et, à Versailles, en son hommage, les élégantes arborent de superbes pièces montées, baptisées coiffures « à la Belle Poule ».
 |
| (109) Coiffure à la Belle Poule en hommage à la victoire française. |
De Grasse subit, néanmoins, une défaite, au combat des Saintes (12-04-1782), mais, alors qu’il est contraint de se rendre, la plus grande partie de sa flotte s’esquive dans la nuit. Néanmoins, le combat a été rude car les pertes sont de 7000 hommes pour l’ensemble des deux flottes. Encore une fois, la non-observation des signaux et l’indiscipline, maladie chronique des chefs de division et capitaines français (Bougainville notamment et Vaudreuil, dans une moindre mesure), sont, en partie, responsables de la défaite française. C’est durant cette bataille que l’amiral britannique Rodney inaugure, involontairement, semble-t-il, la tactique de rupture de la ligne ennemie qui deviendra une constante de la Royal Navy, dans les combats futurs. Déjà, de Grasse fait état d’avancées techniques chez les britanniques, que la marine française mettra plus de vingt ans à généraliser sur ses bâtiments, comme les caronades ou les platines à silex pour l’allumage des charges.
 |
|
(110) Combat des Saintes – 12 avril 1782
|
Le Ville de Paris, trois-ponts de l’amiral de Grasse, amène les couleurs à 18H00, après dix heures de combat. Sur un équipage de plus de mille marins et soldats, on compte alors 400 morts et seulement 100 hommes valides sur le bâtiment.
En 1785, au sortir de la Guerre d’Indépendance, la Marine Royale aligne fièrement 55 navires de ligne dont 5 trois-ponts de 110 canons, 7 deux-ponts de 80 et 43 de 74 canons. En intégrant les différents modèles de bâtiments, la flotte est constituée de 227 unités. Il faudra attendre 1814 pour trouver un bilan comparable, sauf qu’en 1785, les navires du Roy ne sont pas enfermés dans les ports sous la menace anglaise.
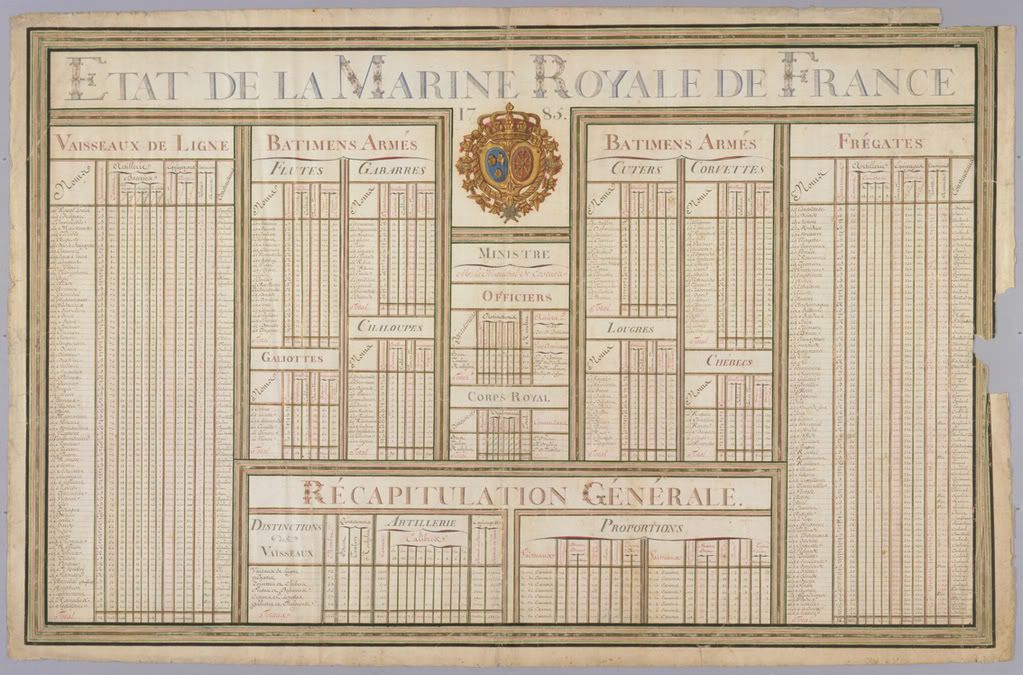 |
| (111) Etat de la Marine royale de France en 1785 |
En 1786, est divulguée la Grande Ordonnance qui va servir de cadre, sans changement notoire, durant trente ans, à la Marine française. Sur l’instigation du Chevalier de Borda, nommé Inspecteur des constructions navales, en 1784, les types de vaisseaux se figent et se limitent à trois modèles, un unique trois-ponts, le 118, et deux deux-ponts, le 80 et le 74 canons. En réalité, le 80 canons permet d’exploiter les pièces de bois de grande dimension, prévues pour les 118, en nombre limité. Les dimensions sont dorénavant standardisées, du moins selon les critères de l’époque, les calibres et les hauteurs de batteries définies une fois pour toutes. Un gros effort de rationalisation est réalisé et de nombreuses pièces sont dorénavant interchangeables et polyvalentes, comme certaines voiles. On introduit l’emploi de pièces forgées à la place d’éléments en bois. A ce stade, on ne peut passer sous silence l’importance des arsenaux de marine. Dans un pays comme la France, majoritairement rural et à l’industrie artisanale, les arsenaux, par leur concentration des compétences, sont les premiers exemples d’une industrialisation moderne. La production de vaisseaux de 64 et 50 canons est abandonnée et les derniers exemplaires rayés du service à la mer.
Il ne faut pas minimiser le rôle actif de Louis XVI, à partir de 1765, dans le choix de la politique maritime. En effet, ce souverain, largement torpillé par la propagande révolutionnaire, a bénéficié, dès sa prime jeunesse, d’une solide instruction navale et s’intéressera tout particulièrement à ce domaine militaire, tout au long de son règne. En remerciement, les officiers et les équipages lui témoigneront une fidélité sans faille que, seuls, les excès de la Révolution battront en brèche. Comme quoi, il n’avait pas qu’un prépuce coincé et une passion, quelque peu réductrice, pour la serrurerie.
[BREAK=(IV) 1789-1794 - Une Marine malade de la Révolution]
(IV) 1789 – 1794 – Une Marine malade de la Révolution
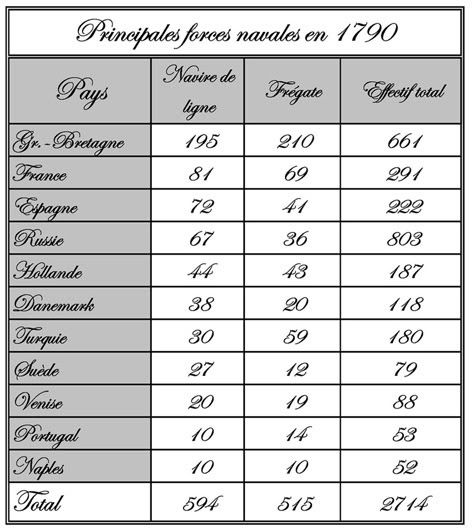 |
(112) Situation des forces navales occidentales en 1790 |
Tout aurait été bien dans le meilleur des mondes possibles, comme aurait dit Voltaire, si un évènement majeur n’était survenu, en 1789, la Révolution Française. L’abolition des privilèges provoque, à partir 1790, une fuite des officiers de marine, corps constitué essentiellement de nobles (officiers rouges). Cette hémorragie prive la marine de plus de 90% de ses cadres ! Les arsenaux se soulèvent et créent, avant la lettre, des piquets de grève qui pendent à la lanterne des officiers supérieurs venus parlementer tandis que les responsables politiques ratiocinent dans les couloirs. Les équipages se mutinent. Les bâtiments restent à l’ancre dans les ports.
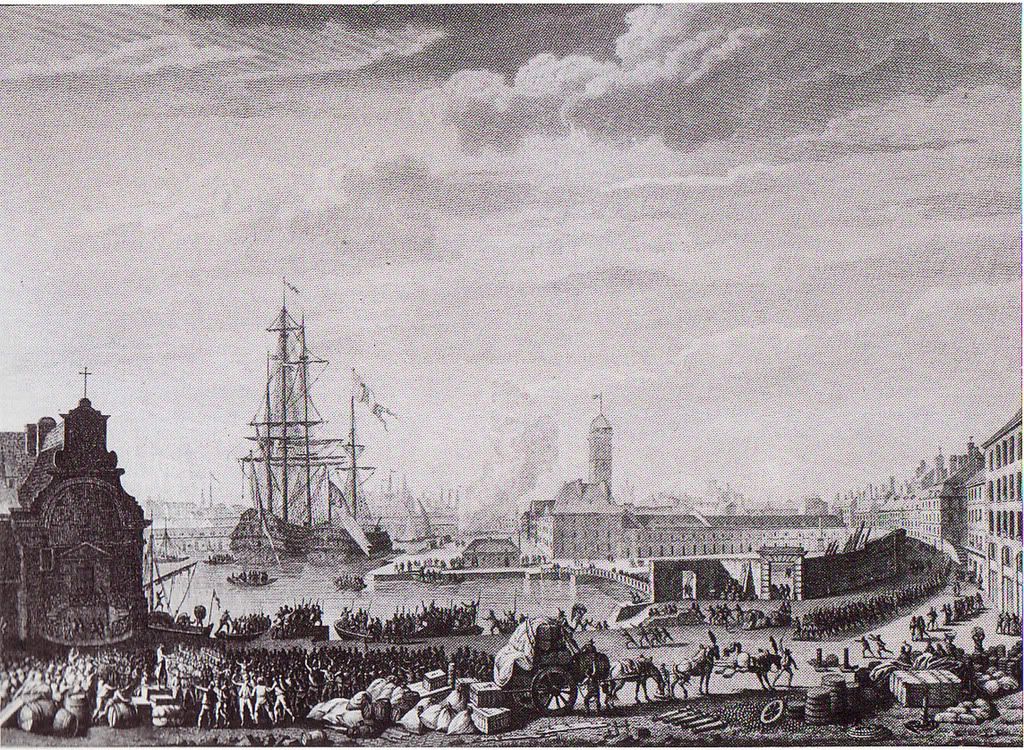 |
| 2b) L'équipage du Léopard s'insurge à Brest, en 1790 |
Le 1er Mai 1791, le Grand Corps ne comporte plus que 5 Amiraux sur 42, 42 capitaines de vaisseaux sur 170 et 356 lieutenants de vaisseaux sur un effectif de 630§ A Brest, le 1er Juillet de la même année, sur un effectif de 470 officiers affectés, 238 ont quitté le service sans congé et 135, après en avoir fait la demande. Il reste donc une petite centaine d’officiers de tout grade pour le service de la première flotte française ! En représailles, le Club des Jacobins exige de priver les officiers en congé de la demi-solde qui leur est réglementairement accordée, ukase que s’empresse de ratifier le Ministre de la Marine, membre dirigeant dudit Club. En remerciement pour sa conduite servile, il est congédié en septembre 1791.
En 1792, la flotte des Antilles négocie avec le gouvernement espagnol et, en janvier 1793, passe avec armes et bagages sous la bannière de Charles IV d’Espagne. Certains officiers refusent de faire allégeance au souverain espagnol, rallient Brest avec leurs bâtiments et leurs équipages. Trois d’entre eux sont arrêtés dès leur arrivée puis exécutés, un quatrième condamné à la prison. La Révolution marche sur la tête.
L’état républicain tente de suppléer à son manque de cadres en nommant de jeunes officiers inexpérimentés, des capitaines au commerce en mal de commandement après la reprise des hostilités avec les Anglais et toute une clique de « grandes gueules » issues de l’équipage et de la maistrance, plus compétents pour crier haut et fort les louanges de la République que pour mener un navire de guerre.
De surcroit, en 1792, sur l’instigation stupide du Chevalier de Kersaint, noble frustré de l’Ancien Régime, notre marine, déjà invalide faute d’encadrement et malade de ses convulsions politiques, ira défier la Royal Navy dans des combats aussi désastreux qu’inutiles, qui lui coûteront des pertes monumentales dont même le Premier Empire ne se remettra pas.
En avril 1793, la flotte océanique française du Ponant, se résume à trois vaisseaux, six frégates et une douzaine de corvettes et brigs opérationnels. Ce n’est pas beaucoup mieux en Méditerranée, où la flotte, en mer, est décimée par une tempête. Après avoir convoité, sans succès, le fauteuil de Ministre de la Marine, Kersaint, jacobin bon teint, parvenu, alors, au grade de vice-amiral, sera exécuté en Décembre 1793…Exit Kersaint.
Au passage, en septembre 1793, dans une France en proie à une guerre intestine, la terrible Guerre de Vendée, et une agitation qui secoue le Midi, Toulon s’insurge et ouvre l’accès de la ville et de son port à une flotte combinée anglo-espagnole qui, trop contente de l’aubaine, fait main basse sur un certain nombre de bâtiments. En décembre 1793, alors que les armées de la République, dont un certain capitaine d’artillerie Buonaparte, assiègent Toulon pour la reconquérir, les troupes occupantes mettent le feu aux installations de l’Arsenal et à une partie de la ville, incendient les navires qu’ils ne peuvent emporter, avant de s’esquiver discrètement. Les représailles, une fois Toulon reconquis, s’élèveront à un millier d’exécutions sans compter les déportations par convois entiers.
 |
|
(113) Les forces anglo-espagnoles évacuent Toulon – 17 et 18 décembre 1793
|
Le combat du 13 prairial An 2
1794 est marqué par un fait d’armes qui marquera la mémoire des belligérants, l’affaire du convoi de blé américain. On est en pleine Terreur et le Comité de Salut Public, confronté à une menace de disette nationale, est contraint d’acheter aux Américains un gros stock de blé. En Janvier 1794, le contre-amiral Vanstabel appareille de Brest, avec deux vaisseaux – Le Jean Bart et le Tigre - et une frégate, pour Norfolk où il retrouve la frégate l’Embuscade - encore française, à l’époque. Il doit y rassembler puis escorter 70 navires de charge chargés de blé et de farine - 110 bâtiments selon les sources mais je vous expliquerai plus avant la raison de cette différence de chiffres.
Le convoi et son escorte entame son retour, vers la France, le 11 avril. Bien entendu, les Anglais apprennent très vite l’existence de ce précieux convoi et confie une puissante escadre de 34 navires de ligne à l’amiral Howe pour l’intercepter. De son côté, la France dépêche le contre-amiral Nielly avec cinq vaisseaux, au large d’Ouessant, pour escorter le convoi jusqu’à Brest. En même temps, le lieutenant de vaisseau Linois avec une petite division composée d’une frégate, d’une corvette et un brick, est censé trouver le convoi pour lui indiquer les coordonnées de rencontre avec l’escadre des cinq vaisseaux d’escorte. Il ne trouve pas le convoi mais tombe sur une division anglaise, dont deux 74, qui, après 4 jours de chasse et un combat meurtrier, transforme sa petite flottille en passoire et les survivants en prisonniers. On retrouvera Linois, quelques années plus tard, dans l’Océan Indien, où, promu amiral et à la tête d’une division française, il donnera bien des soucis aux forces britanniques.
Là, il convient préciser que le Comité de Salut Public, se méfiant des risques de coup d’état fomentés avec l’aide de l’Armée, a confié les pleins pouvoirs sur les différentes Armes à des représentants du peuple, fonctionnaires civils souvent ignorants de la chose militaire mais fortement politisés et un tantinet exaltés. La flotte de Brest va tirer le gros lot avec un certain Jean-Bon-Saint-André, initiateur du Tribunal Révolutionnaire de sinistre mémoire et charmant compagnon qui proclame ouvertement que «… pour établir solidement la République, il faut réduire de plus de moitié la population française ». Petit détail amusant, le terme « Saint » est totalement proscrit du vocabulaire en cette période d’anticléricalisme forcené, au point que le pauvre bourg de Saint-Symphorien-sur-Sèvres se voit rebaptiser Phorien-sur-Sèvre. Apparemment, ces décisions imbéciles ne concernaient pas les hauts pontes du Comité. Bref, le citoyen André Jean-Bon-Saint-André, ex-pasteur protestant renié par ses pairs et, un temps, capitaine au commerce, se fait bombarder Ordonnateur de l’Armée Navale et, profitant du comportement attentiste et unrien cossard du Citoyen Dalbarade, son supérieur hiérarchique, Commissaire Général à l’Armée Navale, se comporte en dictateur autoproclamé. Sa haine de la noblesse n’a d’égale que celle qu’il porte à l’égard du clergé. Curieusement, le personnage semble faire preuve d’une anglophilie à peine dissimulée, qui le fera accuser, plus tard, d’avoir voulu démanteler la Marine pour servir la perfide Albion. Il se fera, d’ailleurs, violemment remonter les bretelles par Robespierre, profondément antibritannique, qui sera à deux doigts de l’envoyer tutoyer la Veuve, à l’occasion d’une séance houleuse du Club des Jacobins, en janvier 1794.
 |
| (114) André Jean-Bon-Saint-André - portrait de David |
Arrivé à Brest, le 7 Octobre 1793, la première tâche à laquelle il s’attelle est de décapiter, au propre comme au figuré, le noyau d’officiers « rouges » - ce qualificatif désigne les officiers issus de la noblesse qui arboraient, sous l’Ancien Régime, des chaussures à talon rouge- restés fidèles à la Marine après l’exécution de Louis XVI. Pour y parvenir, il n’hésite pas à faire rédiger, contre monnaie sonnante et trébuchante, de faux témoignages par des matelots peu scrupuleux et des bagnards. Mais, retors, il se garde bien de prononcer lui-même toute condamnation et expédie les « coupables » à Paris où Fouquier-Tinville, Accusateur Publique du Tribunal Révolutionnaire, se charge de la basse besogne. Puis Jean-Bon se fait envoyer, par le Tribunal Révolutionnaire de Paris, une délégation permanente et particulièrement dévouée qui, dorénavant, siègera à Brest. Il pourra toujours arguer, à l’heure de rendre des comptes, qu’il n’a aucun sang sur les mains et ainsi sauver sa tête.
On avait favorisé la pagaille et l’insubordination dans les ports et les escadres, il était temps de reprendre tout çà en main. Après s’être attaqué aux officiers, Jean-Bon s’occupe des équipages. Erigée sur un ponton, la guillotine trône au milieu du port de Brest. Le premier condamné est un vieux quartier-maitre de l’Impétueux, dénoncé par ses camarades pour attitude antirépublicaine, exécuté le 16 mars 1794. Il s’est essuyé le visage avec un mouchoir au lieu de retirer son chapeau à l’annonce de la reprise de Toulon par les troupes républicaines (9 janvier 1794) ! Le régime de discipline et de punitions devient si terrible que la marine de Louis XIV était une aimable croisière touristique, en comparaison. Officiers et équipages sont passibles des mêmes peines. Pour une broutille, on exécute. On envisage même, à un moment, d’embarquer une guillotine sur les bâtiments. Les désertions se multiplient à Brest et il faut constituer une commission chargée de faire le tour des autres ports pour tenter d’enrôler des volontaires.
En janvier 94, notre cher JBSA, c’est plus facile à écrire, dissout les régiments d’artillerie et d’infanterie de marine, troupes spécialisées pour le service sur les bâtiments, principalement constituées de bretons, sous prétexte que la spécialisation est contraire à l’égalité tant louée par la République. Dorénavant, les conscrits de la Garde Nationale sauront parfaitement remplir ce rôle…Enfin, c’est comme çà qu’il le voit mais la pharmacopée républicaine ne dispose pas encore de petites pilules contre le mal de mer et le pauvre bleu berrichon ira rendre tripes et boyaux sur les instables navires de guerre.
On lui prête même l’intention, sur la base de témoignages et de document d’époque, de vouloir traduire 18 000 marins brestois en justice pour attitude antirévolutionnaire ! Décision folle qui aurait désarmé la flotte.
Le 14 Pluviôse An 2 (2 février 1794), il se fend d’une proposition de décret tristement célèbre. Sera puni de mort et déclaré traitre à la Patrie, tout capitaine et officier qui aura amené son pavillon, quelque soit la puissance et le nombre d’ennemis affrontés, sauf si son bâtiment est en train de couler, encore faut-il qu’il ait quasiment de l’eau jusqu’à la taille ! Accessoirement un navire de guerre en bois a généralement la fâcheuse tendance à continuer de flotter et ne sombre qu’exceptionnellement ! Itou pour un commandant de frégate, corvette ou petit bâtiment isolé qui se rendra à un ennemi inférieur au double de sa puissance et sans que son bâtiment ne soit en train de couler. Pour faire bon poids, le 26 mai (7 Prairial), le Comité de Salut Public, publie un nouveau décret qui ordonne de ne pas faire de prisonnier, y compris sur les prises civiles et de pratiquer la guerre à mort. Sympa, l’ambiance, non ? Officiellement, un seul officier français appliquera ce décret infamant, le lieutenant de vaisseau Charbonnier, commandant de la frégate La Boudeuse, qui capture un petit brick anglais, au large des Baléares, fin juillet 1794, et passe par les armes les onze membres d’équipage. Promu capitaine de vaisseau pour ce « haut fait d’armes », il sera à jamais méprisé et exclu par ses pairs
Il est difficile de se faire une idée sur les compétences réelles de Jean-Bon-Saint-André car les textes de l’époque -et même encore de nos jours, il suffit d’aller faire un tour sur le Net !- lui tressent des couronnes de lauriers alors que des historiens plus tardifs et des témoignages contemporains dignes de foi le qualifient de Matamore sanglant et couard. Néanmoins, l’incohérence de ses ordres et son comportement révèle assez nettement son incompétence. Ce qui semble être son défaut le plus avouable à mon humble avis.
C’est donc, dans cette sympathique ambiance, que se déroule l’affaire du convoi de blé. Le commandement de la Flotte de Brest est confié à Villaret de Joyeuse ou Villaret-Joyeuse, bombardé contre-amiral par notre cher JBSA. Compte-tenu du contexte, cet officier général, courageux, certes, mais tacticien de troisième ordre, soucieux de conserver sa tête sur ses épaules, promet qu’il rééditera les exploits de Tourville en 1691 et d’Orvilliers en 1778, pas moins.
Début mai, ordres et contre-ordres parisiens se succèdent mais, le 16 Mai, en fin de journée, la flotte sort de Brest. Villaret-Joyeuse et l’inévitable JBSA sont sur le navire-amiral La Montagne, trois-ponts de 118. Objectif, rejoindre le convoi qui est sensé stationner aux Açores dans l’attente d’une escorte, comme le prévoient ses ordres initiaux. Le contexte n’est pas simple, il semble que le Comité ne souhaite pas d’engagement avec la flotte anglaise car il réserve ses forces navales en vue d’une opération pour conquérir Jersey et Guernesey. Ce n’est donc, en principe, qu’une mission d’escorte. En cours de route, la flotte française dont la plupart des commandants navigue pour la première fois en formation, au lieu de se contenter de rallier sagement les Açores en ordre discipliné, se disperse comme une volée de mouettes, vaisseaux de ligne inclus, sur l’instigation de JBSA, pour chasser la moindre voile en vue. Le résultat ne se fait pas attendre, c’est la confusion totale. On arraisonne des bâtiments neutres qu’il faut relâcher après moult excuses, certains navires français finissent même par se chasser mutuellement et l’état-major est infoutu de mettre la main sur la moindre frégate ou corvette pour les tâches d’éclairage et de liaison, vu qu’elles sont toutes parties en chasse ou capturées par les Anglais alors qu’elles ramènent, toutes fiérotes, leurs prises dans les ports français. Si on rajoute l’incompétence notoire d’un certain nombre d’officiers et d’équipages, c’est la pétaudière totale. A l’heure des explications, JBSA stipendiera violemment ce honteux comportement, en oubliant très vite que l’ordre émanait de lui.
Le 9 Prairial (28 Mai), la vigie, alors que la flotte française, vent arrière, s’est mise en tête de faire jonction avec les cinq vaisseaux de Nielly, sensés être au large d’Ouessant – comme quoi, on n’avait pas beaucoup avancé et que les Açores étaient encore loin-, signale l’escadre de Howe et annonce 30 vaisseaux de ligne, dont quatre trois-ponts –en fait il n’y en a que 27- et une ribambelle de frégates et petits bâtiments. La flotte française, à ce moment, n’aligne plus que 23 vaisseaux dispersés dont un égaré de Nielly, rejoint 48 heures plus tôt, et quelques rares frégates ou corvettes, vu que çà fait dix jours que c’est du « grand n’importe quoi » ! A quinze bornes de distance, chaque flotte y va de sa manœuvre. Les Français tentent de reprendre la formation en ligne, virent au vent, tandis que les Anglais changent de bord. Selon la vieille tradition navale, les flottes s’affrontent en naviguant dans le même sens…C’est plus sympathique, la canonnade dure plus longtemps ! Finalement, en fin de journée, l’avant-garde anglaise, très avancée, engage l’arrière-garde française. Le Révolutionnaire met provisoirement hors de combat le HMS Bellerophon, encaisse les bordées vengeresses de quatre autres bâtiments anglais et, après un combat qui se prolonge dans la nuit, désempare le HMS Audacious qui finit par rallier l’Angleterre pour compter ses débris, tandis que le Révolutionnaire, gravement endommagé, se voit contraint, lui aussi, de rallier le port français de Rochefort. Bien entendu JBSA s’empressera, plus tard, de stipendier l’attitude timorée du navire français. La nuit tombe sur les belligérants, sans autre dommage.
Le 10 Prairial (29 Mai), lorsque le jour se lève, la flotte anglaise n’est plus qu’à huit kilomètres de distance. Cà cafouille chez les Français, qui, en début de matinée, ont pourtant l’avantage du vent. Howe, vieux briscard expérimenté mais un peu trop prudent aux yeux de certains, va chercher le vent et décide de rompre la ligne française. Il y laisse quatre bâtiments désemparés, dont le Bellerophon déjà amoindri, la veille, un vice-amiral et deux contre-amiraux mais sa manœuvre réussit et il a dorénavant l’avantage du vent. Tout ce joli ballet dure douze heures et à 22H00, les deux flottes abandonnent le poste de combat pour la nuit. A ce stade, Villaret-Joyeuse et JBSA commencent à discerner les lauriers d’une victoire, si la situation en reste là.
 |
|
(115) Howe engage la flotte française, le 29 mai 1794 (10 Prairial An 2)
|
Le 11 Prairial (30Mai), le brouillard ne se lève pas de la journée. Nielly finit par rallier la flotte de Villaret-Joyeuse, avec 3 vaisseaux. Il lui en manque un quatrième, l’Audacieux, et deux frégates qu’il a envoyé chasser un vaisseau « ennemi » désemparé…En fait d’ennemi, c’est le malheureux Révolutionnaire qui tente de rallier un port ! Vous avouerez que ce n’est vraiment pas de bol !
Le 12 Prairial (31 Mai), conditions climatiques inchangées, brouillard et calme plat. Faut se faire une raison, quand il y a du brouillard, il n’y a pas de vent. C’est comme çà.
Au matin du 13 Prairial (1er Juin), au large d’Ouessant, le brouillard s’est enfin levé, la mer est calme et il y a une jolie brise de sud mais Villaret-Joyeuse tire une tronche de deux pieds de long…le teigneux de Howe est toujours à ses trousses avec l’avantage du vent et, vu sa position, il n’a pas l’intention de venir prendre le thé. Il reste 26 vaisseaux français, cinq frégates et deux corvettes opérationnels, trois autres vaisseaux ayant dû rallier Brest suite à des avaries. Enfin opérationnels, c’est vite dit car le Tyrannicide est en remorque de la frégate la Seine - c’est le Trajan qui le prendra en remorque durant le combat. Howe, de son côté, aligne 26 vaisseaux (trois 100 canons, quatre 98, deux 80 et dix-sept 74) mais l’un d’eux, HMS Charon, est transformé en navire-hôpital. Les forces sont sensiblement équivalentes. Par contre, l’Anglais dispose de onze frégates et d’une flottille importante de petits bâtiments, très utiles pour la répétition des signaux ou pour remorquer les vaisseaux désemparés et éviter leur capture. En réalité, sans l’apport des frégates anglaises, la ligne française dispose d’une batterie plus puissante que la ligne anglaise.
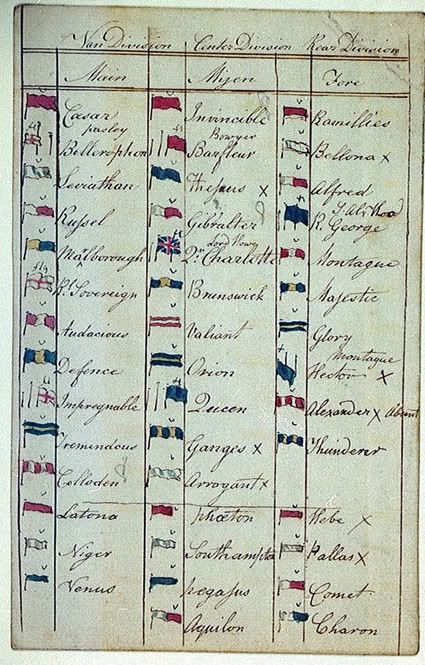 |
|
(116) Ordre de bataille et effectifs britanniques (document d’époque).
Les divisions sont identifiées par la couleur du pavillon et le navire-amiral est repéré par le pavillon national. |
La flotte française met carrément en panne pour attendre l’Anglais ! Howe en profite pour équilibrer sa ligne, désigne, à l’avance, une cible à chacun de ses bâtiments, les plus puissants devant engager leurs équivalents français. Objectif, rompre la ligne française avec quatre divisions distinctes. Villaret-Joyeuse subodore la manœuvre et enjoint à ses bâtiments de serrer la ligne.
Ordre de bataille des divisions anglaises de l’avant-garde à l’arrière garde. Chaque division est constituée d’une demi-douzaine de navires de ligne.
La division du HMS Bellerophon cherche à couper la ligne entre le Gasparin et l’America, second et troisième vaisseaux de la division d’avant-garde française –Convention(74), Gasparin (74), America (74), Terrible (110), Impétueux (74), Mucius (74), Eole(74), Téméraire (74), Tourville (74)- commandé par Bouvet sur le Terrible.
La division du HMS Barfleur entre le Trajan et le Tyrannicide, premier et deuxième bâtiments du corps de bataille – le Trajan avec le Tyrannicide en remorque, le Juste (80), La Montagne (120), le Jacobin (80), l’Achille (74), le Vengeur du Peuple (74), le Northumberland (74), le Patriote (74)- commandé par Villaret (La Montagne).
La division HMS Queen Charlotte, sous les ordres de Howe, entre La Montagne, montée par Villaret, et le Jacobin (corps de bataille français)
Enfin, la quatrième, HMS Queen, doit couper l’arrière-garde française - l’Entreprenant (74), le Neptune (74), le Jemmapes (80), le Trente-et-un mai (74), le Républicain (110), le Sans-Pareil (80), le Scipion (74), le Pelletier (74) -, confiée à Nielly sur le Républicain, entre ce dernier et le Sans-Pareil.
Nota : l’air de rien j’ai bien retrouvé 26 bâtiments français et même réussi à reconstituer, à peu de chose près, l’ordre de bataille. Si j’avais le temps, je me décernerais bien une médaille, rien que pour çà. Autant les sources anglaise sont précises, autant les françaises sont brouillonnes…et pourtant, là, ma source est un amiral français, Jurien de la Gravière. J’aurais bien dit qu’on patine aimablement dans le gravier…mais bon, un peu facile, n’est-il pas ?
Le combat débute à 9H00 du matin. Les trois premiers bâtiments de l’avant-garde française supportent bien l’attaque anglaise mais, derrière, la ligne ne tient pas ses positions.
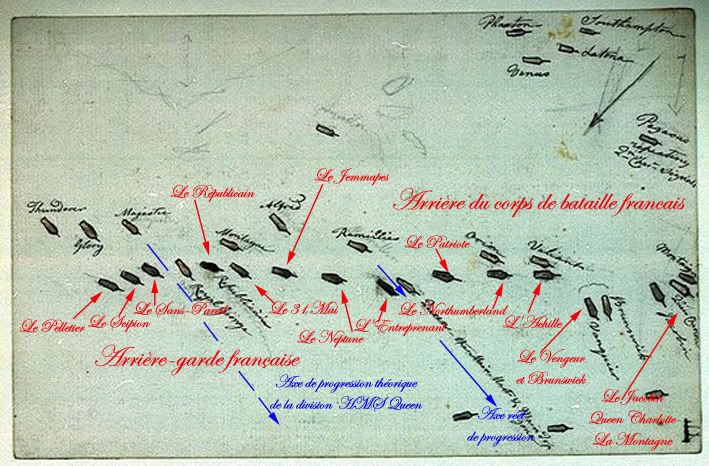 |
| (117) Croquis des dispositions générales de combat (origine britannique). |
Pourtant les ordres de Howe ne sont que partiellement exécutés (voir tracé bleu ci-dessus), vraisemblablement pour des problèmes de compréhension et de transmission. A la fin du XVIIIème siècle, les anglais ont mis au point une procédure de communication par pavillons efficace et relativement simple. Le dispositif prévoit une centaine de pavillons différents mais une vingtaine suffit pour transmettre les principaux ordres de manœuvre. De leur côté, les français sont toujours empêtrés dans un système de signaux complexes et, en dernier recours, signalent par des séries codifiées de tir au canon. Méthode peu efficace, pour le moins, dans l’environnement d’une canonnade. Ce n’est donc que la division du navire-amiral, HMS Queen Charlotte, constituée des HMS Defense, navire de tête, Malborough, Royal Georges, Brunswick, Valiant et Orion qui réalise la manœuvre souhaitée. Exemple typique du manque de discipline des commandants anglais comme français, le HMS Invicible voyant le HMS Defense, sévèrement touché et désemparé après avoir perdu ses mâts, quitte sa propre ligne de bataille pour essayer de lui lancer une remorque. Opération qu’il
loupe, d’ailleurs.
 |
| (118) Le navire-amiral HMS Queen Charlotte coupe la ligne française. |
Vingt-cinq minutes après, la ligne française est rompue. Les vaisseaux anglais s’engouffrent dans les brèches et attaquent les bâtiments français des deux bords. Position très défavorable car il n’y a pas assez de servants pour servir des deux bords et, en plus, les canonniers français inexpérimentés –rappelez-vous que JBSA a remplacé les canonniers de métier par des gardes nationaux- sont deux fois plus lents, voir pire, que leurs homologues britanniques. De surcroit, les Français, quand la portée le permet, applique la tactique du « tir à démâter ». Autrement dit, 80% de la décharge se contente de déranger le vol des mouettes et des goélands. Les Anglais, plus pragmatiques, tirent « à plein bois » avec un pourcentage de coups au but proche de 90%, soit en tir direct soit par ricochet, comme quand vous étiez gamin, au bord de la mer. Sous l’impact des boulets, le bois produits des éclats particulièrement meurtriers qui font des ravages dans les batteries.
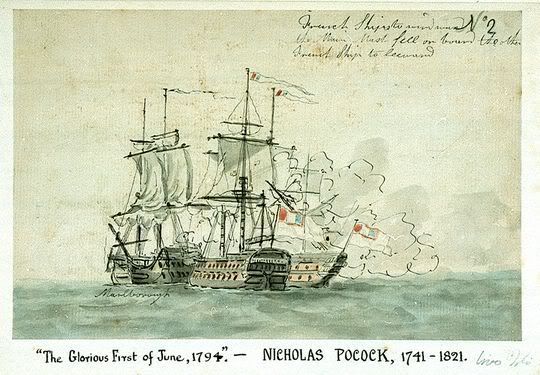 |
| (119) HMS Malborough aux prises avec deux vaisseaux français |
Le combat devient une mêlée indescriptible. Les adversaires se canonnent à portée de pistolet, voir carrément bord à bord, comme le Vengeur qui, durant deux heures ininterrompues, reste accroché au HMS Brunswick. Les deux bâtiments sont si proches que les canonniers français ne peuvent utiliser leurs écouvillons, montés sur des manches en bois, les anglais les leurs arrachant des mains.
 |
| (120) De gauche à droite, Le Terrible, HMS Brunswick, Le Vengeur du Peuple. |
Sur les coups de midi, les compagnies d’abordage prennent pied sur le pont anglais sans rencontrer de résistance sérieuse mais deux bâtiments ennemis viennent à la rescousse du Brunswick qui en profite pour se dégager et recommence à pilonner le Vengeur, créant une brèche importante dans sa coque. Sous les coups des deux autres anglais, le 74 français, après trois heures de combat incessant, perd ses mâts et, sévèrement touché, se retrouve, à son tour, désemparé et obligé de faire servir les pompes, l’eau envahissant ses soutes.
 |
| (121) Le Vengeur du Peuple et HMS Brunswick. |
La plupart des bâtiments français se comportent courageusement, selon la formule consacrée. Cependant, les deux derniers bâtiments de l’arrière-garde, le Scipion et le Pelletier, son matelot d’arrière, abandonnent le combat en fin de matinée, provoquant le déséquilibre des forces.
 |
|
(122) Les deux navires-amiraux HMS Queen Charlotte et La Montagne s’affrontent dans la matinée.
|
Aux alentours de treize heures, il y a autant de navires désemparés de part et d’autres et bien malin qui peut désigner un vainqueur. Villaret-Joyeuse sur la Montagne, après avoir ferrailler, toute la matinée, avec six vaisseaux anglais dont le navire-amiral HMS Queen Charlotte, profite d’un moment de calme, se dégage et envoie le signal de rappel. Après avoir regroupé sept à huit vaisseaux de l’avant, distants de près de huit kilomètres, il fait virer tout son monde pour rallier l’arrière-garde dont il n’a aucune nouvelle. Il constate alors qu’une partie de son corps bataille principal et les restes de l’arrière-garde sont pratiquement tous démâtés et emmêlés avec les britanniques. Il fait mettre en panne pour laisser le temps à certains bâtiments de gréer une mâture de fortune. Cinq autres navires français, à peu près navigants, en profitent pour le rejoindre. Les rares frégates françaises sont priées d’aller lancer des remorques aux navires démâtés mais reviennent en clamant que ce sont tous des bâtiments ennemis ! Vous avouerez que ce n’est quand même pas de chance ! Villaret-Joyeuse se garde bien d’aller vérifier par lui-même l’exactitude de ces rapports. Il en oublie même de capturer deux navires anglais désemparés, tout proches, sur le point d’amener les couleurs.
A ce moment-là, il dispose d’une escadre d’une quinzaine de vaisseaux encore en état de combattre qui pourrait faire basculer l’issu de la bataille en faveur des Français. Mais c’est sans compter sur l’intervention de JBSA, barbouillé de suif et de goudron, qui surgit des fonds de la Montagne, où selon certaines sources y compris des confidences de Villaret-Joyeuse, en personne, il se serait courageusement abrité dès les premiers tirs, et qui exige que la flotte encore valide abandonne le combat. Motif : il faut, en priorité, protéger le convoi de blé !...Tiens, on l’avait presque oublié celui-là ! Il semble qu’en fait, notre héroïque ordonnateur avait eu plus que son compte d’émotions et de souvenirs de bataille navale pour le restant de son existence et qu’il ne se sentait pas trop concerné par son décret implacable sur le refus de combattre.
Aux alentours de 15 heures trente, Villaret-Joyeuse, obéissant aux injonctions de Jean-Bon –Saint-André fait mettre les voiles, direction les atterrages de Brest, laissant le reste de sa flotte, sept bâtiments, se dépatouiller tout seul.
Howe marque une pause pour porter assistance à ses navires en difficulté et, grâce à sa flottille de frégates, fait envoyer des remorques à onze bâtiments désemparés puis, bénéficiant du nombre, reprend le combat avec les sept navires français abandonnés à leur triste sort – Le Vengeur du Peuple, l’Impétueux, le Juste, l’America, le Northumberland, l’Achille et le Sans-Pareil. Le Pelletier, particulièrement discret durant le combat, dépasse l’America mais ignore superbement sa demande désespérée de remorque car çà risquerait de le ralentir… « Voilà la façon avec laquelle j’ai cru de bonne foi de bien travailler le 13 prairial ; si j’ai manqué, c’est bien sans le vouloir. » (Défense manuscrite du capitaine de vaisseau Berrade, commandant du Pelletier, devant la Cour Martiale – Section Historique de la Marine)
L’America et le Northumberland, gravement touchés, amènent le pavillon. A quinze heures, L’Impétueux, attaqué par trois vaisseauxanglais, avec trente centimètres d’eau dans la batterie basse et en proie à un incendie, doit être abandonné par son équipage. L’Achille et le Sans-Pareil, cernés et désemparés cessent le combat et abaissent les couleurs à 16H30. De même que le Juste, après, semble-t-il, un début de mutinerie qui voit l’équipage balancer par-dessus bord les officiers « jusqu’au-boutistes », avant de signaler sa reddition. Le Vengeur qui fait eau de toutes parts, depuis le tout début d’après-midi, finit par sombrer. Ses chaloupes du bord ayant toutes été démolies durant le combat, les anglais lui dépêchent des embarcations pour sauver les survivants. L’état-major du Vengeur s’empresse d’y embarquer (le rapport officiel indique pudiquement que Renaudin, son capitaine, a nagé vers les chaloupes !) ainsi que 267 rescapés. Mais il reste plus de deux cents marins blessés ou malades à bord, qui sombrent avec le bâtiment, aux cris héroïques de « Vive la République ! » si on veut bien accorder quelque crédit aux témoignages de l’époque. Les canots anglais récupèrent néanmoins des chanceux, agrippés à des épars.
 |
|
(123) Naufrage du Vengeur du peuple - aquarelle naïve du temps.
|
A dix-sept heures, tout est terminé. Les Anglais ont 11 navires en remorque mais ont aussi capturés six bâtiments français en triste état, dont la plupart ne pourront resservir dans la Royal Navy, et un vaisseau français a sombré. Les pertes humaines sont d’un peu moins de 1000 hommes, chez les britanniques, contre 5000 morts, blessés, disparus ou prisonniers, chez les français, mais pour ces derniers, la liste n’est pas encore close.
Howe, à 68 ans, après cinq jours d’insomnie totale, perclus de rhumatismes qui l’ont obligé à commander la manœuvre assis dans un fauteuil, et à cours d’eau douce, ramène tout ce petit monde à Spithead. On lui reprochera de ne pas avoir donné la chasse à l’escadre de Villaret-Joyeuse et, si le Roi confirme, par décret, son titre de Commandant de la Flotte, L’Amirauté ne lui confie plus de commandement à la mer jusqu’à sa mort en 1799.
 |
|
(124) Howe à la bataille du 13 Prairial ou la victoire, excellent remède contre les rhumatismes!
|
Mais nous n’en avons pas fini avec notre équipe de duettistes Villaret-Joyeuse et JBSA. Lorsque nous les avons quittés, ils faisaient voiles vers Brest. En chemin, à la hauteur d’Ouessant, ils rencontrent la petite escadre anglaise, neuf bâtiments, de l’amiral Montagu qui vient de se faire gentiment balader par la division française, stationnée à Cancale -Il sera d’ailleurs reproché à Villaret-Joyeuse de n’avoir pas réuni cette division à son escadre pour donner la chasse à Howe, ralenti par ses remorques– mais les Français, alors qu’ils sont sur le point de rattraper l’escadre anglaise, laissent tomber et vont mouiller à Berthaume, à l’entrée nord du Goulet de Brest. Apparemment, l’état-major n’est pas très sûr de l’accueil qu’on va lui réserver à Brest. Le mouillage de Berthaume est tout sauf un abri satisfaisant par vent du Sud et il coûte la vie à 2000 blessés, privés de soins et entassés sur des bâtiments secoués par la houle, ce qui porte le bilan global à 7000 hommes hors de combat. La flotte rallie Brest le 11 Juin (23 Prairial), dix jours après la bataille.
En attendant, le convoi de blé et sa maigre escorte - il y a 300 malades à bord de chacun des deux vaisseaux- ont bien rejoint le point de rendez-vous des Açores. Puis, faute de retrouvaille avec une quelconque escorte, ils ont repris la mer en direction de la Bretagne. Le 3 Juin, le convoi traverse la zone de combat, repère les débris flottants de la toute récente bataille et, trompant la surveillance anglaise, fait son entrée à Brest, deux jours après la flotte de Villaret Joyeuse, en ayant capturé, au passage, un convoi anglais d’une quarantaine de bâtiments (70 + 40 = 110, le compte est bon !).
Le Comité de Salut Public juge préférable d’axer sa communication et sa propagande sur la réussite et l’arrivée à bon port du convoi de blé. La presse magnifie la perte de sept vaisseaux et sept mille marins en un acte de dévouement et d’abnégation exceptionnel. Le combat du 13 Prairial devient une victoire incontestable de la République - The Glorious 1rst of June, pour nos voisins anglais qui s’attribue logiquement le gain du combat- mais, en attendant, la flotte de Brest ne mettra plus jamais le nez dehors jusqu’à la Paix d’Amiens, en 1801 !
Jean Bon Saint André n’a même pas fini de poser le pied sur le quai, qu’il ordonne l’arrestation de plusieurs commandants de vaisseaux, participants du combat du 13 Prairial. Puis, très en verve, question décret, il s’empresse d’en concocter un nouveau qui intime aux chefs d’escadre d’embarquer sur des frégates avant le début des combats…pour mieux en surveiller l’évolution. Ben tiens…en plus, si çà tourne mal, on peut toujours prendre la poudre d’escampette plus rapidement !
Comme il n’y a pas de bataille navale sans enquête, les responsables français encore vivants ou non prisonniers des Anglais passent au tourniquet, la même année. Jean Bon Saint André y va de son refrain sur l’incompétence et la couardise des officiers, s’attribue trois vaisseaux, dont un trois-ponts, coulés bas sur une flotte anglaise revue à la hausse de neuf navires de ligne, pour l’occasion – les navires anglais cités seront dûment identifiés en parfait état de marche, quelques mois après-, justifie la fuite calamiteuse par la nécessité de protéger le convoi et obtient les félicitations du Comité de Salut Public qui n’en pense pas moins mais craint de se déjuger. JBSA et Villaret-Joyeuse se couvrent mutuellement et ce dernier s’en sort sans dommage. De toute façon, personne ne met en doute le courage de Villaret-Joyeuse, qu’il a déjà prouvé sur d’autres théâtres mais les avis sont nettement plus critiques sur sa souplesse d’échine. Quant à Vanstabel qui monte à Paris dire tout haut ce qu’il pense de l’attitude de Jean-Bon-Saint-André, on l’expédie d’autorité à Boulogne où il décède en 1797, après quarante ans de services exemplaires, sans avoir touché un fifrelin sur les parts de prise qui lui sont dues, au point que sa veuve démunie doit quémander quelques subsides à cette République si reconnaissante.
Condamné à la déportation après le coup d’état du 18 Fructidor (4 septembre 1797), Villaret-Joyeuse sera rappelé par Bonaparte, à la reprise des hostilités en 1802. Capitaine-général aux Antilles, il capitule en 1809. Il meurt à Venise, en 1812, ou il exerce la fonction de Gouverneur Général. Villaret-Joyeuse fait partie de ces « épaulettiers », comme on disait l’époque, officiers dont la carrière doit plus à leurs hautes relations qu’à leurs réelles qualités militaires. Napoléon dira à son sujet et à propos de son attitude au combat du 13 prairial, « …L’amiral Villaret, brave de sa personne, était sans caractère et n’avait pas même d’attachement à la cause qu’il défendait. »
Arrêté en 1795, lors de la suppression du Comité de Salut Public, Jean Bon Saint André bénéficie d’une amnistie générale. En bon fonctionnaire zélé, il va se faire oublier comme consul à Alger puis à Smyrne, en Turquie, où il est emprisonné, en 1798, par les Turcs, suite à la Campagne d’Egypte. Décoré de la Légion d’Honneur sous Napoléon Ier, il est nommé baron d’Empire, en 1809, et meurt du typhus à Mayence, en 1813.
Pour finir, vous ne couperez pas à notre séquence émotion, avec cet extrait des « Stances Patriotiques, sur le combat naval du 13 Prairial, et le dévouement sublime de l’équipage du vaisseau le Vengeur », œuvre immortelle du citoyen Pierre CHAS, écrite le 5 Thermidor An 2 (23 juillet 1794). Vous ne manquerez pas de noter que l’auteur a privilégié le côté pathétique au détriment de la richesse des rimes.
Ciel, j’ai failli oublier ! Il n’y est question que d’Anglais fuyant lâchement devant les Français invincibles…et là, c’est le drame, dans leur fuite effrénée, les Anglais s’offrent une petite pause et s’acharnent sur le courageux bâtiment qui sombre avec son équipage…
« Tout à coup, le tumulte cesse,
Et le calme succède aux cris de la douleur ;
Déjà le pavillon se dresse
Etalant la triple couleur.
Vive la liberté ! Vive la République !
Tels sont les derniers cris de ces cœurs généreux,
Pour qui l’instant le plus affreux
N’est plus qu’une fête civique. »
…Quand je vous disais que les documents d’époque étaient très utiles pour vérifier la véracité des faits, je ne mentais pas !
1795 – 1802 – Convalescence et rechute.
En janvier 1795, un fait d’armes amusant. Alors que les armées françaises sous les ordres du général Pichegru, progressent à travers la Hollande, le gouvernement néerlandais s’apprête à expédier sa flotte de guerre en Angleterre. Malheureusement un hiver rigoureux bloque les unités de la flotte batave dans les glaces du Zuiderzee. Le 8éme régiment de hussards, après avoir préalablement emmailloté les sabots de ses chevaux pour éviter de glisser sur la glace et emmené en croupe un fantassin du 15ème régiment d’infanterie légère derrière chaque cavalier, prend d’assaut la flotte hollandaise, sabre au clair. Ce régiment peut revendiquer la prise de 15 vaisseaux de guerre, 850 canons plus un certain nombre de navires de commerce sans perte connue.
 |
(125) Prise de la flotte hollandaise par la cavalerie française de Pichegru - 25 01 1795 |
Après les excès de la Terreur, les officiers-généraux de la marine disposent de plus de liberté dans leurs actions et surtout dans leurs réflexions sur le devenir de la flotte face au Britanniques. Pour ces dernières, leur bilan est catégorique, les escadres françaises ne sont pas en mesure de les affronter avec succès, ce que confirmera la poursuite des hostilités.
1797-1798
En 1797, la Royal Navy va être confrontée à des mutineries. En mars, les équipages de la flotte amarrée au mouillage de Spithead, adressent onze pétitions à leur ancien commandant, Lord Howe, le vainqueur de la bataille du 1er Juin 1794 (13 Prairial) maintenant en train de goûter à une retraite bien méritée. Leurs réclamations portent sur une hausse de la solde, inchangée depuis des décennies, une amélioration des conditions de vie et un assouplissement de la discipline particulièrement rigoureuse voir souvent inhumaine. Howe tente de faire valoir la modicité de leurs exigences mais l’Amirauté reste de marbre. Le 16 Avril, lorsque l’ordre est donné de prendre la mer, les équipages refusent de rejoindre leurs postes. En fait, on a plus à faire à une grève qu’à une mutinerie mais cette distinction subtile n’existe pas dans le vocabulaire militaire. La discipline est maintenue à bord des bâtiments mais les marins déposent leurs officiers et élisent des délégués qui instaurent une Assemblée Générale décisionnaire. On parlera alors de « république flottante ». Le terme de république sonne douloureusement aux oreilles d’une Amirauté, majoritairement noble, qui passe le plus clair de son temps à tenter de museler une république autrement plus encombrante et suffisamment braillarde pour donner le mauvais exemple, la toute jeune République Française. Elle commence par réprimer selon de bonnes vieilles méthodes éprouvées, fait mettre aux fers les perturbateurs, inflige des peines de fouet parfois mortelles et, pour faire bonne mesure, pend quelques meneurs. Las, les mutins ne lâchent pas prise. A contrecœur, elle confie à Howe le rôle de négociateur. Après avoir obtenu une augmentation de solde, des promesses d’amélioration des conditions de vie et une diminution du barème de coups de fouet en vigueur, la mutinerie prend fin le 15 avril 1797.
Dans le même temps, un autre mouvement de contestation éclot également au Nore, mouillage traditionnel de la Flotte à l’entrée de la Tamise. Mais là, la méthode des mutins est beaucoup plus expéditive. Les officiers sont maltraités, fouettés, enduits de goudron et, pour certains, jetés à la mer. Face à ces exactions, l’Amirauté refuse toute négociation, isole les bâtiments mutins pour les affamer, procède à une répression brutale, prononce une soixantaine de condamnation à la pendaison et en exécute la moitié. L’Amirauté a eu chaud mais il n’y aura plus de mutinerie organisée dans la Royal Navy jusqu’à nos jours.
 |
|
(126) Les mutins du Nore hissent le drapeau rouge sur l'Achilles - 1797
|
L’Expédition d’Egypte – préparatifs et premiers succès
A la fin du XVIIIème siècle, l’Empire Ottoman se fragilise et il y a du mou dans le Divan turc (conseil des Vizirs présidé par le souverain ottoman). Les Mameluks ont pris le pouvoir en Egypte et, tout en opprimant la population locale, se battent les flancs de l’autorité centrale ottomane qui a déjà fort à faire avec ses deux voisins, l’Autriche et la Russie, ses adversaires traditionnels. Dès les dernières années de la Monarchie, les Français, alliés traditionnels de la Sublime Porte, ne sont pas longs à s’en rendre compte. On ébauche ferme des plans sur l’avenir. Deux tendances s’opposent, soit filer un coup de main aux Turcs pour retaper l’édifice, soit profiter sournoisement de la situation et se tailler un superbe empire colonial, copié sur celui que sont en train d’établir les Anglais en Inde. Il ne faut pas oublier que ces cochons de Goddons, nous ont virés comme des malpropres, nous laissant juste quelques Comptoirs pour ne pas nous ridiculiser totalement. Cette dernière option est soutenue par Choiseul, ministre de Louis XVI
Les années suivantes, la France a fort à faire avec sa Révolution et ses visées expansionnistes moyen-orientales prennent la poussière.
En 1797, si les monarchies européennes continentales ont été mises au pas par la nouvelle République, il reste toujours un adversaire irréductible, bien peinard sur son ile et en train de magouiller, dans les Cours européennes, une nouvelle coalition antifrançaise, l’Angleterre. Il reste deux solutions au Directoire, soit débarquer en Angleterre mais, après avoir privilégié cette option, début 1798, même les plus audacieux considèrent l’opération des plus hasardeuses, soit semer la pagaille dans ses lignes commerciales de l’Océan Indien, en implantant des bases navales et militaires à l’entrée de la Mer Rouge. Cette option a deux avantages, elle contraindrait l’Angleterre à distraire ses forces navales de l’Atlantique pour renforcer son dispositif en Inde, et l’obligerait à emprunter la longue et difficile route du Cap, tandis que les forces françaises n’auraient qu’à traverser la Méditerranée. De surcroit, avec nos colonies existantes dans l’Océan Indien, les navires anglais iraient de Charybde en Scylla.
Talleyrand, Ministre des Affaires Extérieures, prône la conquête égyptienne et finit par convaincre les membres du Directoire qui entérinent la décision le 5 Mars 1798. Maintenant, il convient de trouver un général capable de mener cette expédition lointaine. Il y a bien toute une cohorte de courtisans, plus habiles dans l’art du quadrille que dans celui du sabre, et des traineurs de sabre à l’intellect un peu limité mais l’affaire est d’importance. Cà tombe bien, il y un jeune général qui, après ses victoires en Italie et la conquête des Iles Ioniennes, commence sérieusement à faire de l’ombre à ce Directoire un peu falot, Napoleone Buonaparte. Il vient de décliner, en février, la direction du projet de débarquement sur les côtes anglaises, après avoir inspecté, par la mer, les côtes de la Manche et de la Mer du Nord, mais accepte l’opération égyptienne. Talleyrand avait, depuis des mois, soigneusement préparé le terrain en lui communiquant copie des rapports de fonctionnaires et agents de renseignement installés en Turquie. L’optimisme est de mise et tout le monde est d’accord pour convenir que Constantinople ne lèvera pas le petit doigt pour aider les Mamelucks sécessionnistes et que l’initiative française sera favorablement perçue par la Sublime Porte.
Les préparatifs sont, en tout point, un chef-d’œuvre d’organisation. D’une part, parce qu’il faut tout juste deux mois pour armer une flotte de 10 000 marins, 13 vaisseaux de ligne, 80 navires de guerre divers, 300 bâtiments de transport, rassembler 2500 officiers, 36 000 soldats, 2800 cavaliers, 300 chevaux, 175 pièces d’artillerie et stocker vivres et eau douce dans les ports de Toulon, Marseille, Gènes, Civita Vecchia, et Ajaccio. D’autre part, le secret de la destination est tellement bien conservé que les commandants de la flotte ne la connaitront qu’une fois en mer, après avoir ouvert leurs ordres. Ce n’est pas que l’Angleterre manque d’espions et d’informateurs mais les services français jouent admirablement l’intox et les pistes vont de l’Angleterre au Levant, en passant par le Portugal et Naples ! En dernier recours, alors que l’expédition prend la mer, le 19 Mai 1798 (30 Floréal An 6), les Britanniques tablent sur les côtes de Syrie.
Pourtant, le Directoire a omis un petit détail. Le tiroir-caisse français est lamentablement vide, les équipages et les troupes n’ont plus reçu de solde depuis des lustres. Cà va s’arranger grâce à la banque suisse car les troupes françaises occupent la Confédération, début 1798. Mais çà couvre juste les arriérés de solde et une partie des impedimenta. Qu’importe, la flotte française fait un petit détour par Malte, qu’elle occupe, le 11 juin, avant de rallier les côtes égyptiennes. La prise de Malte, en sus de la « bouffée d’or frais », offre une excellente position stratégique en Méditerranée.
La chance sourie toujours à Bonaparte qui arrive à faire passer une flotte de 400 bâtiments sous le nez des Anglais, alors que Nelson s’échine à mettre la main dessus. Il croise devant Alexandrie, le 27 et 28 juin, pas la queue d’une voile. Le 1er Juillet, les Français y jettent l’ancre alors que les vagues d’étraves de l’escadre anglaise se sont à peine estompées.
 |
| (127) Nelson chasse Bonaparte en Méditerrannée - Mai à Aout 1798 |
Craignant le retour de l’escadre anglaise, Bonaparte s’est donné trois jours pour accomplir le débarquement et, contre l’avis de l’amiral Brueys, demande qu’on fasse, sans délai, préparer les chaloupes. La mer houleuse, le vent fort et la flotte s’est ancrée trop loin du rivage, dont l’accès est parsemé de nombreux récifs mal ou pas signalés sur les cartes qui créent de redoutables brisants. Mais il y a plus de peur que de mal, et on ne dénombre que vingt noyés auxquels il convient de rajouter près de 4000 malades et blessés des suites du voyage, qui sont débarqués et soignés à terre.
Contre toute attente, le Sultan de Constantinople digère très mal la pilule mais la diplomatie anglaise n’y est surement pas étrangère. Il déclare la guerre à l’envahisseur français et, pour l’occasion, s’allie aux Russes, ravis de pouvoir s’aventurer en Méditerranée.
A peine débarquées, les troupes françaises s’emparent d’Alexandrie, le 2 Juillet. Puis, à partir du 7 juillet, elles s’enfoncent dans les terres, en direction du Caire, où elles font connaissance avec le désert, la chaleur torride et la chasse aux bidons. Les malheureux chevaux ont souffert de la traversée et les artilleurs en sont réduits à s’atteler à leurs pièces. En plus, les flancs-gardes et les trainards sont attaqués par des bandes de cavaliers. Après avoir repoussé, sans perte, la charge de 800 Mameluks, l’armée finit par atteindre la rive du Nil, aux environs du 10 juillet, où bon nombre de soldats se tapent une turista monumentale après avoir ingurgité des pastèques.
Le 12 Juillet, Bonaparte est rejoint par une flottille sensée le protéger côté fleuve. Il reprend la route du Caire mais celle-ci est barrée par 4000 Mameluks. Sur le Nil, la flottille française, séparée par des élévations de terrain, doit se battre avec les Mameluks sur la rive et une flottille ennemie. Après deux heures de combat, et soixante-dix hommes perdus, le gros des troupes françaises disperse l’adversaire qui laisse 600 morts et blessés sur le terrain, tandis que la flottille française, un moment malmenée, met en fuite son adversaire.
Après avoir parcouru deux cent cinquante kilomètres depuis la plage de débarquement, sous la canicule, traversé villages des bourgs désertés de toute présence vivante, et affrontés les attaques incessantes des cavaliers arabes, les Français arrivent en vue du Caire, le 20 juillet, où les attend le gros de l’armée des Mameluk.
 |
| (128) Bonaparte en Egypte – 1798-1799 |
« Soldats !... Songez que du haut de ces monuments quarante siècles vous contemplent ! ». C’est par ses mots célèbres que Bonaparte galvanise ses troupes, le 21 au matin, face aux 60 000 hommes, dont 3000 cavaliers, de l’armée de Murad Bey, déployés sur la rive gauche du Nil, entre le village fortifié d’Embabeh, renforcé par 40 canons sur affuts fixes, et les Pyramides. Sur la rive opposée, se découpe à l’horizon, les silhouettes des trois cents minarets du Caire, grande citée de 250 000 âmes. L’armée française aligne un peu moins de 25 000 hommes et une centaine de cavaliers. Comme tout ce qui a trait à Napoléon, certains historiens britanniques actuels revisiteront ces chiffres, en estimant les forces des Mamelucks à 21 000 hommes. Cà ne mange pas de pain et çà colle parfaitement avec l’image anglo-saxonne traditionnelle de « Bony », petit dictateur dévoré d’ambition et assoiffé de sang. De toute façon, à ce petit jeu-là, deux siècles de propagande réductrice ont atteint leur objectif, puisque, de nos jours, on trouve un courant de pensée français bien en phase avec cette image fausse.
Bonaparte dispose son armée en carrés, pour contrer les charges de cavalerie, et répartit son artillerie mobile sur les flancs. Engagée en début de matinée, la bataille se prolonge jusqu’à la fin de l’après-midi. Les troupes égyptiennes font montre de vaillance, sa cavalerie bouscule, un temps, les carrés. Les unités des généraux Bon et Vial enlèvent le retranchement d’Embabeh à la pointe des baïonnettes. Les Mamelucks pris en tenaille, dos au fleuve et sous le feu de l’artillerie française – Bonaparte n’est pas officier d’artillerie pour des prunes- finissent par se débander, en laissant 10 000 hommes sur le terrain. Les Français ne déplorent que 30 morts et 260 blessés. Murad Bey se replie sur Gizeh avec le reste de ses forces, 2500 cavaliers.
 |
|
(129) La bataille des Pyramides - Louis-François Lejeune, tout à la fois général et peintre spécialiste des scènes de bataille – (1775-1848).
|
Une grande partie de l’infanterie égyptienne franchit le Nil à la nage mais les Mamelucks qui tentent la traversée, coulent à pic sous le poids de leurs cuirasses. L’ennemi abandonne un butin important aux mains des vainqueurs, dont plusieurs milliers de chevaux et 900 dromadaires. L’armée d’Orient vient de mettre fin à sept cents ans de domination de l’Egypte par les Mameluks turcs. Dans la nuit, des émeutiers cairotes s’en prennent aux édifices et aux demeures de leurs anciens maitres et se livrent au pillage.
Bonaparte et son état-major s’installent d’abord dans la maison de campagne de Mourad Bey à Gizeh. Il fait son entrée officielle au Caire, le 25 juillet, en milieu d’après-midi.
Cet évènement marque la fin du premier acte de l’Expédition Française en Egypte. Le rideau va bientôt se lever sur le deuxième, aux néfastes conséquences sur l’avenir de ladite l’Expédition.
 |
|
(130) Symbole de la Campagne d’Egypte – Bonaparte face au Sphinx.
|
Début juillet, avant de s’enfoncer dans les terres, Bonaparte se concerte avec Brueys sur les dispositions à prendre pour la flotte française, sous la menace d’un retour de l’escadre anglaise. Trois solutions se présentent,
Utiliser l’abri naturel de la magnifique rade d’Alexandrie, facile à défendre mais les premiers pilotes égyptiens consultés signalent des fonds insuffisants pour y mouiller des navires de guerre.
Reprendre la mer et mouiller à Corfou, à l’entrée de la Mer Ionienne, qui dispose de six mois de vivres dans ses magasins et d’une forte garnison française, rattachée à l’Armée du Levant.
Après escale à Corfou, rallier Toulon et y embarquer des renforts et du ravitaillement pour l’Armée d’Orient.
En fait, le général en chef, hormis la nécessité impérative d’assurer la protection de la flotte, laisse la plus grande liberté d’action à l’amiral mais, à la différence de ses généraux avec lesquels il pratique de la sorte, bizarrement, ce n’est pas la méthode à adopter avec un état-major naval, engoncé dans ses tactiques rigides et peu porté, par essence, sur les initiatives audacieuses. Nelson est l’exception qui confirme la règle mais ses initiatives peu orthodoxes feront grincer des dents plus d’un membre de l’Amirauté britannique
Une fois abandonné à son sort, Brueys retombe dans les vieux travers de sa caste. Après avoir sondé la rade d’Alexandrie, il s’avère que les fonds peuvent accueillir la grande majorité de la flotte sauf les plus grosses unités, les 74, 80, et 118 canons, auxquels il manque entre 1,20 à 1, 50m sous quille et qu’il faudrait délester de leurs batteries les plus lourdes pour les ancrer dans la rade. Cette manœuvre aurait permis d’installer de redoutables défenses sur les langues de terre qui barrent l’entrée de la baie mais la vision de ses vaisseaux partiellement désarmés déplait souverainement à l’amiral. Pourtant, une solution technique assez simple à réaliser existe dans la panoplie des charpentiers de marine, les demi-chameaux. Deux caissons disposés de part et d’autre du navire servent de flotteurs et diminuent le tirant d’eau. Les petites unités et les transports vont mouiller dans la rade mais les vaisseaux restent à l’ancre devant Aboukir. Brueys se contente de renforcer la défense de l’ilot d’Aboukir, à sa gauche, avec deux malheureuses pièces de 12. A l’aller, on a aménagé les ponts des bâtiments pour le transport de la troupe et des officiers, on déménage tout le fatras qu’on empile sur les batteries situées côté terre. Les pièces de 36 de ces batteries, devenues inutilisables, auraient été pourtant beaucoup plus utiles sur l’ilot et manqueront cruellement lors du combat.
Lorsque Bonaparte entre au Caire, Brueys est toujours à l’ancre à Aboukir et n’a toujours pris aucune disposition pour reprendre la mer. Il réunit son état-major pour définir l’attitude à adopter en cas d’arrivée de l’escadre anglaise. Du Chayla insiste pour qu’on lève l’ancre au plus vite pour l’affronter mais ses collègues partagent l’avis de l’amiral, on combattra à l’ancre et les Anglais n’oseront pas couper la ligne car les fonds sont trop faibles.
Le 1er Aout, vers 14H00, la flotte anglaise, après avoir reconnu, la veille, la rade d’Alexandrie, arrive en vue d’Aboukir. Une bonne partie des équipages est à terre et Brueys est à table. Côté français, on prend son temps, l’amiral envoie un officier à Alexandrie pour regrouper les équipages et demande à la flotte de prendre ses dispositions pour lever l’ancre…Tiens, je croyais qu’il avait été convenu de combattre à l’ancre ? En fait, l’amiral français, tablant sur une attaque le lendemain, n’exclut pas, une fois ses équipages complétés, de rejoindre la haute mer pour combattre l’Anglais. Evidemment, Nelson, car c’est lui, ne s’embarrasse pas de fioriture et lance sa flotte, numériquement inférieure, à l’assaut des français. Un mois de terre, çà a tendance à faire relâcher la discipline et si le signal de branle-bas de combat est enfin envoyé, celui-ci est loin d’être un modèle du genre.
 |
| (131) Les équipages français rallient le bord au début de l’engagement. |
Le loupé de Foley ou la légende de Nelson.
En fin d’après-midi, la flotte anglaise qu’observe Brueys, se compose exclusivement de onze 74 - et, ne dispose que d’une unité d’éclairage, le brick HMS Mutine. Nelson, chef d’escadre, est à bord du HMS Vanguard. Deux autres 74, rejoindront l’escadre sur les coups de huit heures du soir.
L’escadre française, à l’ancre, est mouillée à l’entrée de la zone de hauts-fonds de la baie d’Aboukir mais, par excès de prudence, il y a trop d’eau libre entre les vaisseaux et les hauts-fonds. Elle est composée d’un trois-ponts de 118, l’Orient, navire-amiral de Brueys, de deux 80 canons, le Franklin et le Tonnant, et de dix 74. En réalité, le Guerrier et le Conquérant sont usés jusqu’à la trame. Promis à la casse, ils avaient été intégrés à l’escadre pour faire bon poids. Pour éviter que leurs coques ne se disjoignent sous l’effet de salves, leurs batteries principales de 36 ont été réarmées avec du 18. En fait, militairement parlant, ils ne valent même pas les deux frégates de 18. Bénéficiant d’un moindre tirant d’eau, les quatre frégates, destinées à la répétition des signaux, sont ancrées plus près du rivage, sur les hauts-fonds. Sur le papier, la flotte française aligne plus de canons que son adversaire.
Les bâtiments britanniques et français sont identifiés sur les croquis (A) et (B) ci-après.
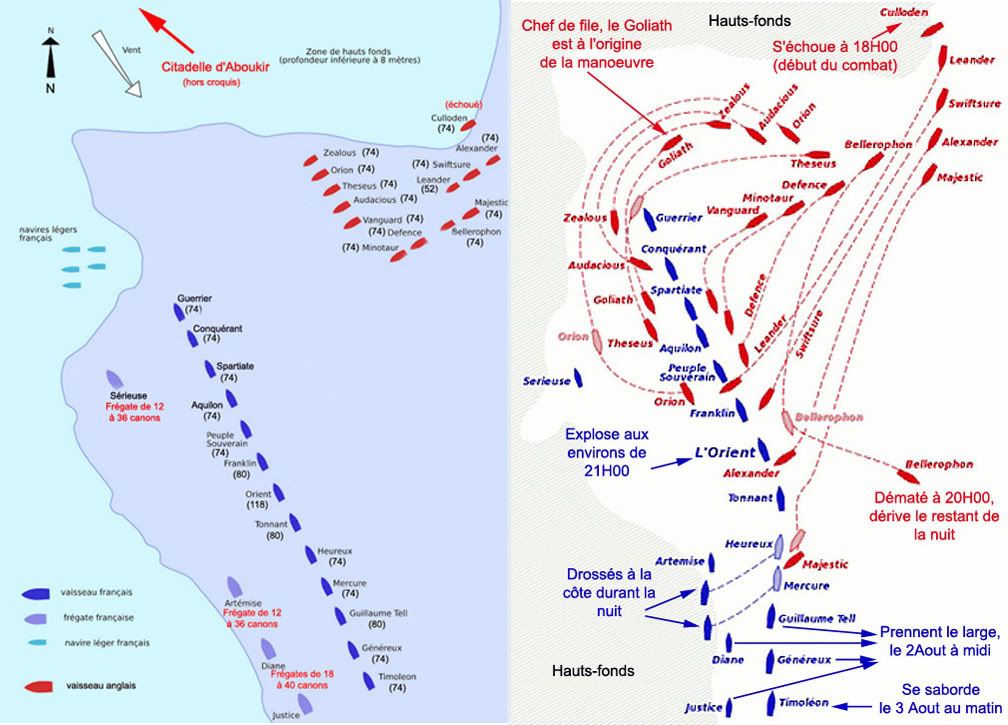 |
|
(132) (A) - Dispositions générales des escadres et de la baie d’Aboukir - (B) - Situation de combat.
|
Les Britanniques ne disposent pas de cartographie de la baie et, vu la disposition de l’escadre française, Nelson en déduit qu’elle est ancrée à la limite des hauts-fonds et, donc, qu’il n’est pas possible de la doubler sur son flanc gauche sous peine de s’échouer. D’ailleurs l’échouage du HMS Culloden, dès l’entame de l’attaque, confirme ses craintes. Il prend la décision de combattre à l’ancre en se positionnant entre les français et le large. Chacun de ses vaisseaux reçoit l’ordre de préparer une ancre sur bâbord arrière, le câble d’ancre est filé par le dernier sabord arrière de la batterie basse.
Le combat débute le 1er Aout à 18H00, à la tombée du jour. Il se prolongera jusqu’au 3 Aout au matin ! Dès le début de la manœuvre, le HMS Culloden va se planter sur les hauts-fonds. Heureusement pour lui, les deux malheureuses pièces de 12, installées sur l’ilot d’Aboukir, sont insuffisantes pour le mettre en péril. L’avant-garde emmenée par Foley, sur le HMS Goliath, effectue son virage par le nord, pour prendre l’alignement sur la ligne française. Evidemment, çà ne rate pas, entrainé par le vent et le courant, il loupe sa manœuvre, passe sur l’avant du Guerrier, navire de tête français et finit par jeter l’ancre, côté plage, après l’avoir dépassé et tourné. Sur le Guerrier, comme sur la plupart des navires français, la batterie vers la terre est masquée et inutilisable ! Déjà handicapé par sa batterie sous-calibrée et son mauvais état général, le Guerrier se fait consciencieusement démolir par le Goliath. Les deux suiveurs, HMS Zealous et Orion, sous la contrainte des éléments, s’engagent eux aussi vers la zone de hauts-fonds. Le Zealous, jette l’ancre à la hauteur du Guerrier, déjà aux prises avec le Goliath. Un moment engagé par une frégate française, La Sérieuse qui finira par couler sous les coups des Anglais, l’Orion vient mouiller entre Le Peuple Souverain et Le Franklin.
 |
| (133) Début de l’attaque anglaise- Le Goliath double la ligne française |
Ironie de l’histoire, la manœuvre ratée de l’avant-garde anglaise sera considérée par les historiens britanniques, comme une prouesse tactique de Nelson. En réalité, les livres de bords britanniques le confirment, il n’a jamais été envisagé de doubler la flotte française par la côte. C’est un énorme coup de bol et, si le sort des armes avait été moins favorable aux Britanniques, Nelson et ses commandants auraient passé un mauvais quart d’heure, de retour à Londres. Dans l’affaire, Brueys a fait trois fautes, assurer la protection de son aile gauche avec deux vaisseaux sous-armés, ne pas avoir doublé ses bâtiments de pointe pour parer à une telle éventualité, quitte à raccourcir sa ligne – cinq vaisseaux, à l’aile droite ne participeront pas au combat jusqu’au matin suivant-, ancrer sa flotte trop loin des hauts-fonds.
Le reste de la flotte anglaise manœuvre d’une manière beaucoup plus orthodoxe et vient s’embosser sur le flanc tribord de l’escadre de Brueys, jusqu’à la hauteur du Tonnant. Le HMS Bellerophon, pris à partie par L’Orient et Le Franklin, est démâté en un tournemain et lourdement endommagé. Dans un premier temps, il signale sa reddition, se ravise, coupe son câble vers 20H0 puis dérive vers le large et s’échoue à l’embouchure du Nil. La puissance de feu de L’Orient (118), du Franklin (80) et du Tonnant (80) est telle que d’autres bâtiments ennemis sont contraints de s’éloigner pour panser leurs plaies.
Là, il y a un mystère dans l’attitude de Villeneuve, qui commande l’aile droite, constituée de l’Heureux (74), Le Mercure (74), Le Guillaume Tell (80), Le Généreux (74), Le Timoléon (74) et des trois frégates restantes. Compte-tenu du déroulement du combat, sa division n’a pas tirer le moindre boulet et certains historiens lui reprocheront de ne pas s’être porté à la rescousse du corps de bataille de Brueys car, aux environs de 20H00, le renfort de ses cinq vaisseaux aurait probablement donné la victoire aux Français. Maintenant, il ne faut pas oublier qu’on a à faire à des voiliers et que ce jour-là, le vent et le courant lui sont contraires. D’un autre côté, en tirant, au préalable, des bords vers le large, son escadre serait venue prendre les Anglais en sandwich. C’est tout le problème du manque d’initiative du commandement naval français, attitude qui désespèrera Napoléon tout au long de son règne. Villeneuve se contente d’obéir aux ordres. Il est sensé encaisser l’attaque anglaise à l’ancre et non se porter à sa hauteur, point barre ! En attendant, le temps s’écoule et un peu avant 21H00, l’aile gauche française cesse le feu. Les deux vieilleries, Le Guerrier et Le Conquérant, désemparés sont pris, et Le Spartiate, l’Aquilon et Le Peuple Souverain, battus des deux bords sont à deux doigts de baisser pavillon.
 |
|
(134) Le Spartiate perd son grand-mât alors que l’Orient s’embrase.
|
A 21H15, le feu se déclare sur L’Orient, ses ponts sont bourrés de pots de peinture et d’huile, de cloisons en bois et de paillasses. Brueys, mortellement blessé dès la première de combat, est décédé et le contre-amiral Gantheaume, le plus ancien dans le grade le plus élevé du bord, ordonne de cesser le feu pour servir les pompes. D’une part, les canonniers de L’Orient continuent de tirer, d’autre part, les pompes sont démolies. L’incendie se propage rapidement aux batteries. Ordre est donné de noyer les soutes et l’équipage commence à abandonner le vaisseau. Gantheaume saute dans un canot et gagne la terre ferme, une demi-heure avant que L’Orient n’explose, à 22H45.
 |
| (135) L'Orient prend feu à 21H15 - 1er aout 1798 |
Là, se situe un événement dramatique qui fera longtemps pleurer dans les chaumières françaises. Casabianca, le capitaine de pavillon de L’Orient, donc son commandant en titre, avait emmené avec lui son fils de dix ans qui servait comme mousse. Grièvement touché, Casabianca est transporté au poste des blessés où le gamin, quand le feu atteint la deuxième batterie, le rejoint. Lors de l’abandon du vaisseau, un matelot vient chercher le petit pour l’évacuer mais, c’est assez compréhensible, il refuse d’abandonner son père et tous deux, avec les autres blessés et les attardés, disparaissent dans l’explosion de L’Océan.
 |
| (136) Explosion de L’Orient à 22H45 |
Quand l’incendie se déclare sur L’Orient, Le Franklin est lui aussi victime de départs de feux mais l’équipage en vient à bout tout en continuant le tir.
Une fois, le choc de l’explosion passé, les adversaires reprennent le combat jusqu’à 3H00 du matin. Pendant ce temps-là, on pourrait imaginer que Villeneuve s’est fait servir une petite tisane, tout en admirant le spectacle nocturne mais ce serait très médisant et guère dans nos habitudes, n’est-ce pas ?
Epuisés par neuf heures de combat, Français et Anglais, sans se concerter, marquent une pause mais reprennent de plus bel avant le lever du jour et se canonnent sans interruption jusqu’en début d’après-midi du 2 aout.
A l’heure de la sieste, alors que le combat dure depuis vingt heures, Villeneuve sort de sa léthargie, coupe ses câbles, et, sans avoir tiré un seul coup de canon, prend tranquillement le large avec Le Guillaume Tell, son matelot d’arrière, Le Généreux, et deux frégates, La Diane et La Justice.
L’Aquilon, Le Pouvoir Souverain et Le Spartiate ont résisté jusqu’en fin de matinée. La frégate La Sérieuse a sombré dans la soirée du 1er aout mais son équipage a rejoint le rivage. Sa compagne, L’Artémise, amène son pavillon le 2 Aout puis – çà, c’est très vilain ! - son capitaine se ravise et met le feu à son bâtiment avant d’évacuer. Ce revirement déchainera l’ire de la presse anglaise, qui fait preuve d’une amnésie fort opportune, en oubliant l’attitude similaire du Bellerophon, la nuit précédente.
Le Franklin, avec deux mâts en moins, les trois-quarts de son équipage hors de combat, trois canons de 36 encore opérationnels et sur le point d’être pris à l’abordage par deux navires ennemis, se rend à 13H00. Le Tonnant, L’Heureux et Le Mercure, menacés par l’incendie de L’Orient, ont dut coupés leur câbles et vont s’échouer. L’Heureux et Le Mercure baissent pavillon à 6H30, le matin du 2 Aout.
Le 3 Aout, en début de matinée, le pavillon tricolore flotte toujours sur deux bâtiments français. Bien qu’échoués, continuent de combattre, Le Timoléon, qui n’a pas suivi Villeneuve, et Le Tonnant. L’amiral anglais somme Le Tonnant de se rendre qui refuse puis, attaquer par deux adversaires, est contraint d’amener.
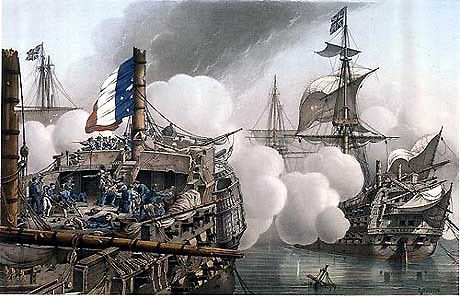 |
| (137) Le Tonnant, démâté et échoué, continue à se battre le 2 Aout. |
Durant la nuit, le capitaine du Timoléon a évacué ses blessés et la plupart de son équipage. A midi, il met le feu à son bâtiment et rejoint la plage. La bataille aura duré 36 heures !
La flotte française à perdu un trois-ponts de 118, deux 80, huit 74, dont quatre trop endommagés seront incendiés par les Britanniques, et deux frégates. Ses pertes humaines s’élèvent à 3925 hommes, 1500 prisonniers inclus, et 3500 rescapés iront grossir les rangs de l’Armée d’Orient, dont 1800 constitueront une légion nautique à trois bataillons. Le reste de la flotte de l’Expédition – deux vaisseaux armés en flute, sept frégates, tous les bâtiments légers et les transports du convoi - abrité dans la rade d’Alexandrie, est intact.
Les britanniques déclarent officiellement 895 hommes hors de combat mais le chiffre réel pourrait bien dépasser les 1500.
 |
| (138) Cérémonie religieuse sur le Vanguard, navire-amiral de Nelson. |
Nelson y est blessé à la tête mais gagne la postérité, un titre de noblesse, baron of the Nile, et une pension de 50 000 livres, transmissible à sa descendance, offerts par le roi d’Angleterre, une pelisse de 25 000 livres et une aigrette de diamants, d’une valeur de 100 000 livres, offertes par le Sultan de Constantinople. Cà ne doit pas être très pratique à porter sur la dunette d’un vaisseau, la fourrure et les diam’s ?
 |
| (139) Nelson arborant, sur son bicorne, la "discrète" aigrette de diamants du Sultan de Constantinople. |
 |
| (139) Leander - Vaisseau anglais de 4ème rang & 52 canons. |
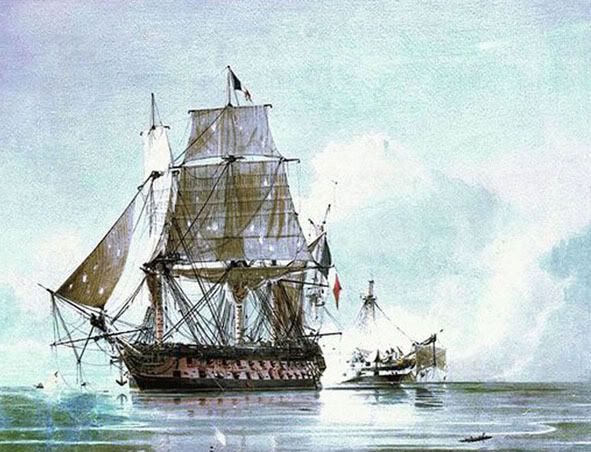 |
| (140) Combat du Généreux, 74 & du Leander, 52 canons – 18 Août 1798 |
Privé d’appui naval, l’armée d’Orient est coincée en Egypte tandis que la flotte anglaise a les coudées franches pour couper ses routes de ravitaillement et interdire l’envoi de renforts.
 |
| (141) Bonaparte apprenant la nouvelle d’Aboukir - Caricature anglaise. |
Bonaparte tente, les mois suivants, de faire rétablir un semblant de service de courriers entre son armée et la Métropole. Le 23 Aout 1799, après avoir passé près de quinze mois en terres égyptiennes, au lieu du trimestre qu’il s’était fixé, il confie le commandement de l’armée d’Orient au général Kléber, embarque sur la frégate la Muiron, ex-bâtiment vénitien, longe les côtes d’Afrique et, après une brève escale corse, débarque à Fréjus, le 8 Octobre 1799, en ayant éviter la flotte anglaise qui cherche à le capturer. Sa campagne d’Egypte mériterait à elle seule, un long chapitre mais le dromadaire a beau être baptisé le vaisseau du désert, je vais me limiter à l’odeur des embruns.
 |
| (142) Bonaparte débarque à Fréjus – 8 octobre 1799 |
Bayonnaise et Ambuscade - Un combat parmi tant d’autres – 14 décembre 1798
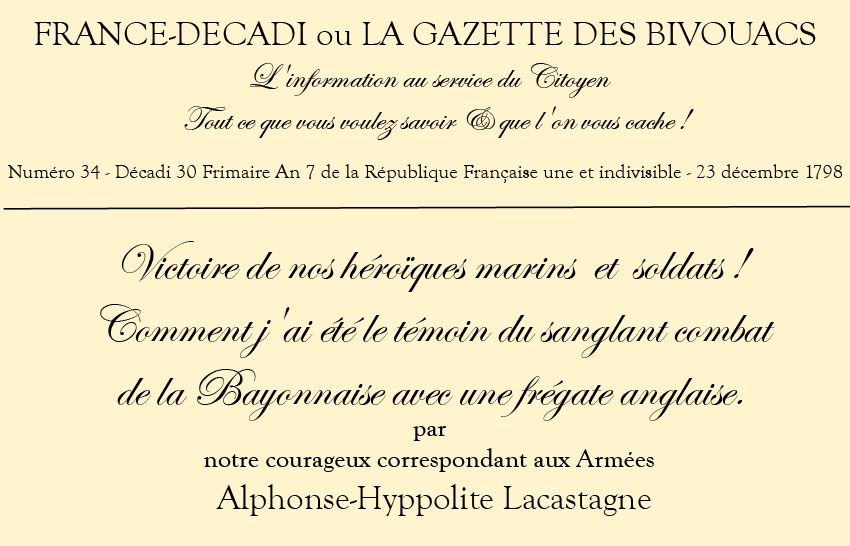 |
Date & lieu.
Date : 14 décembre 1798 (21 Frimaire an 7)
Lieu : A environ 170 km au large de l’estuaire de la Gironde (indication d’époque, d’origine française : « à 30 lieues des atterrages français »). La lieue marine correspond à 5565m, ce qui nous donne un peu plus de 165 km.
Visibilité bonne. Couverture nuageuse. Mer formée. Vent modéré de l’ordre de 10 nœuds.
Les adversaires :
Corvette française de 8 La Bayonnaise – percée à 12 sabords par bordé.
Déplacement : 580 tonneaux.
Armement : 24 canons de 8 long (batterie principale) – 6 canons de 6 long et 2 obusiers de 36 (Modèle 1787), sur le gaillard d’arrière – 8 pierriers de 1 livre en bronze. (Nota : les 2 obusiers de 36 remplacent 2 pièces de 6 long).
Mousqueterie et armes blanches (sabres, piques, haches, coutelas).
Commandant : Lieutenant de vaisseau Jean Baptiste Edmond Richer. Officiers : 2 enseignes dont un, commandant en second.
Equipage : Entre 200 et 220 hommes.
Garnison : Il n’est pas prévu de garnison sur les corvettes de cette classe. Mais le hasard a voulu que la corvette transporte une unité d’infanterie.
Passagers : 30 soldats des troupes des Colonies (Régiment d’Alsace) avec un officier, sous-lieutenant ou lieutenant Ledanseur (?) et, en principe un sous-officier (sergent), tous de retour d’un poste en Guyane.
Provenance du bâtiment : Cayenne
Destination (probable) : Rochefort
Frégate anglaise de 12 Ambuscade - percée à 13 sabords par bordée
Déplacement : 684 tonneaux (source anglaise) en réalité : 1096 tonneaux (source française).
Armement : 26 canons de 12 (batterie principale) – 6 canons de 6 et 8 caronades de 24 livres sur les gaillards. Nota : le nombre de pierriers (swivel) n’est pas précisé mais il est vraisemblable qu’elle en embarquait quelques uns, selon les habitudes de l’époque.
Mousqueterie et armes blanches (sabres, piques, haches, coutelas).
Commandant : Capitaine Henry Jenkins. Officiers : 3 lieutenants (identifiés : premier lieutenant et commandant en second : Dawson Maindon, troisième lieutenant : John Briggs, qui est alité pour cause de maladie).
1 lieutenant des Royal Marines (Sinclair), un commissaire de bord (William Bowman Murray).
Equipage : Effectif théorique, 250 hommes mais il semble que son rôle d’équipage était incomplet et qu’aux environs du 10 décembre, son équipage total n’était que de 212 hommes et même peut-être de l’ordre de 200 hommes, suite à un détachement de prises.
Garnison : une compagnie de Royal Marines. Effectif théorique : Trente hommes.
Provenance : Portsmouth (le 5 décembre 1798), elle fait partie du blocus britannique au large des ports français.
Particularité : l’Ambuscade est à l’origine une frégate française (Embuscade), capturée par les Anglais, lors de la tentative, en 1796, de débarquement en Irlande. Donnée par des sources anglaises comme lancée en 1773, après vérification, cette frégate de 12 a plus probablement été mise à flots en 1789, à l’arsenal de Rochefort.
Chronologie
Remarque : les heures indiquées sont celles du méridien de Greenwich, ou comme on dit de nos jours, heures GMT. Il y a donc une heure de décalage par rapport au méridien de Paris employé par les Français. Ainsi, quand il est indiqué 7H00, comme ci-dessous, il est en réalité, 8H00, heure française, ainsi de suite.
(144) Evolution chronologique de l'Ambuscade et la Bayonnaise |
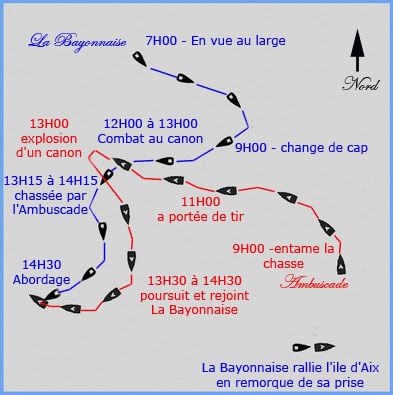 |
7H00 du matin :
L’Ambuscade est au point de rendez-vous, en attente, pour faire jonction avec une autre frégate anglaise, la Stag (Capitaine York). Les hommes de quart signalent une voile au large en approche. Pour l’état-major, comme pour l’équipage, pas de doute possible, c’est la Stag attendue et la veille ne cherche pas à affiner l’identification de l’arrivant. Hormis les hommes de quart, officiers et équipage sont appelés pour le petit déjeuner (Breakfast).
Un peu avant 9H00 du matin :
Le navire non identifié est à portée de canon. Brutalement il change de cap (serre au vent) et envoie de la toile, pour fuir et éviter le combat. La manœuvre l’identifie comme un navire ennemi. L’Ambuscade ordonne le branle-bas et prend ses dispositions pour entamer la chasse.
Entre 11H00 du matin et midi :
L’Ambuscade rattrape le fuyard, se retrouve à portée de canon et lâche sa première bordée. L’adversaire réplique aussi sec. A ce stade de la poursuite, celui-ci a été identifié comme une petite frégate française de 28 canons, La Bayonnaise. Les deux navires hissent leurs couleurs après avoir lâché leur première bordée. La Bayonnaise réduit sa voilure et accepte le combat.
Entre midi et 13H00 de l’après-midi:
Le duel d’artillerie dure près d’une heure, à portée de mousquet (150 mètres environ).
Aux environs de 13H00 :
Explosion d’une pièce de 12 dans la batterie principale de l’Ambuscade. Son origine reste indéterminée (défaut mécanique, erreur de chargement, coup au but de la Bayonnaise).
Dégâts constatés : Un canon hors d’usage, écoutille de pont démoli, début d’incendie des canots sur leur chantier (nota : le pont supérieur (aérien) comporte une grande découpe centrale, le chantier, dans laquelle sont entreposés les canots et chaloupes du bord. Les quilles des canots dépassent dans le plafond de la batterie située en dessous), 11 blessés graves, début de panique dans la batterie et interruption momentanée du tir.
Après 13H00
La Bayonnaise profite de la confusion pour tenter de s’esquiver en envoyant de la toile.
Dégâts constatés : gros dégâts à la coque et au gréement, importantes pertes humaines dont le commandant (LV Richer) et son second, qui sont blessés et hors de combat.
L’Ambuscade reprend sa chasse en se positionnant sous le vent mais le navire français en envoyant de la toile supplémentaire se met hors de portée de sa batterie (la corvette française doit être à 400/500m sur son avant).
13H30 à 14H30 (estimation personnelle)
L’Ambuscade a comblé son retard et se trouve maintenant à une demi-portée de pistolet d’où elle pilonne la Bayonnaise dans l’incapacité de s’échapper (source française).
La Bayonnaise manœuvre pour éperonner et aborder l’Embuscade sur son arrière tribord. Les sources anglaises précisent que l’initiative de l’abordage vient de l’officier commandant le contingent de soldats, qui aurait convaincu le dernier officier de marine français, encore au poste de combat, du succès de la manœuvre.
La Bayonnaise éperonne, de son beaupré, l’Ambuscade sur son tribord arrière, à la hauteur du gaillard, et, dans le choc, casse son bâton de foc, sa civadière, perd son mât de hune (le premier à l’avant) qui s’écroule sur le pont de l’Ambuscade et masque (ou désempare) la roue de gouvernail (de son adversaire). Elle dérape vers la poupe du navire anglais mais reste accrochée aux chaines de manœuvre du gouvernail soit par ses pelles d’ancre, soit par un grappin (c’est la version officielle anglaise). Suite aux échanges de tir ou à la collision, l’Ambuscade perd son mât d’artimon.
 |
| (145) La Bayonnaise éperonne l’Ambuscade – Lavis d’Ozanne. |
 |
| (146) Une autre représentation du combat. |
Selon la version anglaise, les soldats français, juchés sur le beaupré de la Bayonnaise, arrosent du feu de leur mousqueterie le gaillard d’arrière de l’Ambuscade et essuient une riposte en règle des fusiliers-marins britanniques, les Royal Marines. Le premier lieutenant, Maindon, touché mortellement à l’aine, est transporté à l’infirmerie et y décède rapidement. Le capitaine Jenkins, commandant en titre, est également gravement blessé par une balle de mousquet qui lui explose la tête de fémur et est évacué du pont. Le lieutenant Sinclair des Royal Marines, reçoit une balle dans la cuisse et une autre dans l’épaule qui le mettent hors de combat et nécessitent son évacuation. Au même moment, le maitre, Monsieur Brown, prend une balle en pleine tête.
Le (maitre) canonnier monte sur le pont pour signaler un incendie dans les appartements arrière. L’équipage, craignant une explosion de la soute à munitions, reflue vers le gaillard d’avant de la frégate et s’y barricade, en dépit des exhortations du commissaire du bord, W.B.Murray, seul officier encore debout.
L’incendie serait dû à un feu de gargousses (charges de poudres en sac) intempestif, alors que les canonniers anglais tentaient de tirer dans l’étrave de la Bayonnaise, depuis une fenêtre tribord du château arrière. Dégâts : les servants de la pièce (cinq à six hommes), tous plus ou moins grièvement blessés, et une chaloupe du bord, suspendue à ses porte-manteaux sur le flanc de la frégate, endommagée.
 |
| (147) L’équipage de la Bayonnaise monte à l’abordage. |
A partir de là, toujours selon les sources britanniques, c’est la panique. Les marins français, suivant l’exemple donné par leurs camarades soldats, envahissent le pont de l’Ambuscade et, après un bref (sic) corps à corps -« alors on se combat au pistolet, à la pique, à la hache, au poignard, au couteau ; tout instrument devient une arme mortelle ; on se prend aux cheveux, à bras le corps, et parfois les lutteurs tombent ensemble de l’arrière de l’Embuscade dans la mer…C’est une boucherie. » (Extraits d’Histoire Maritime de la France – Tome VI (1794-1815) – page 141 – Léon Guérin – 1851)- se rendent maitres de la frégate ennemie.
Durée du combat : Trois heures dont une heure pour la seule séquence du combat sur le pont de l’Ambuscade.
Après le combat :
Note de notre correspondant : Citoyen capitaine, je tiens à te faire part de mon mécontentement !...Euh, c’est quoi ce truc rouge et visqueux ?
L’équipage de la Bayonnaise doit prendre sa corvette désemparée en remorque de la frégate Ambuscade capturée pour rallier, le 20 décembre 1798, la rade de l’ile d’Aix. L’état-major et l’équipage de l’Embuscade bénéficient d’une libération sur parole ou d’un échange de prisonniers et sont rapatriés en Angleterre dès 1799.
Pertes officielles :
· Côté britannique :
Une frégate
10 morts
36 blessés graves.
60 à 70 blessés dits légers.
· Côté français :
30 morts
30 blessés graves
100 blessés dits légers.
Les suites :
Le capitaine Jenkins, ainsi que les survivants de l’état-major et l’équipage sont traduits en cours martial, en Aout 1799, mais acquittés pour « concours de circonstances exceptionnelles ». (26-27-28 aout 1799 à bord du HMS Gladiator à Portsmouth). Néanmoins un fort soupçon de couardise et de lâcheté face à l’ennemi a toujours plané sur l’équipage de l’Ambuscade, même s’il en a été lavé, au bénéfice du doute, par le jugement du tribunal militaire.
Le lieutenant de vaisseau Richer est promu, sur le champ, capitaine de vaisseau (saut de deux grades d’un coup).
Le Directoire ordonnera, au Bureau des Prises, le payement en récompense, en sus des parts de prise normales, d’une prime supplémentaire de 3500 francs par canon long et caronade comptabilisés à bord de l’Embuscade. Ces primes seront réparties entre officiers et équipage.
La frégate Ambuscade est réintégrée, après réparations, dans l’Armée Navale de la République mais sera, à nouveau, capturée par les Britanniques en 1803, peu de temps après la rupture de la Paix d’Amiens.
Commentaires
Britanniques comme Français, tous sont d’accord pour qualifier ce combat de « boucherie ». Le bilan humain peut paraître, à première vue, relativement modique. En effet, les Anglais n’enregistre que 10 morts et les Français, 30. Avant tout, il convient de s’entendre sur le terme « blessé légers », comme il est perçu à l’époque. La perte d’un œil, d’une oreille, de deux doigts de la main gauche, d’un doigt de la main droite (sauf pouce, index et majeur), une fracture simple (du bras) que le chirurgien peut réduire, etc. ne sont pas classées « graves »…autrement dit, tant que le bonhomme est debout, peut marcher, voir et entendre, c’est un blessé léger. La dénomination « blessé grave » dans les marines de l’époque s’applique à des cas extrêmes, plus proches de l’agonie que d’une hypothétique remise en forme. Cà concerne les cas nécessitant une amputation importante, un bras, une jambe…A noter que dans les conditions médicales de l’époque, une amputation de membre se déroule en 10 à 15 secondes, pour éviter un trop gros choc chirurgical au « patient ». L’élixir de laudanum, extrait de l’opium, est rare et souvent réservé à l’usage des officiers blessés. De toute façon, après l’amputation, la survie du blessé est tributaire des conditions d’hygiène et la gangrène achève souvent le travail entamé par le projectile adverse. Du coup, si on analyse d’un peu plus près le bilan, on constate que plus des deux-tiers de l’équipage français sont morts ou blessés et une bonne moitié du britannique. Dans ce contexte, le capitaine de la frégate anglaise, Jenkins, qui s’est pris une balle de mousquet (17,4mm de calibre !) dans la tête de fémur, a eu du bol de s’en sortir et si, d’aventure, il a pu conserver sa jambe, il est vraisemblable qu’il se soit présenté au Conseil de Guerre avec des béquilles et qu’il ait fini sa carrière navale comme demi-solde de la Royal Navy. Il n’y a plus trace de lui dans les listes d’active de la Royal Navy…en tout cas, je n’en ai pas trouvé.
Les retombées politiques seront importantes. Pourtant ce n’est qu’un combat parmi tant d’autres et les unités engagées ne sont pas particulièrement majeurs, une frégate « légère » de 12 et une corvette de 8, deux petites unités de surveillance et de liaison. On est loin de navires de ligne.
En France :
Nous venions de prendre une déculottée mémorable à Aboukir, en Aout de la même année (1798), notre énième tentative de débarquement en Irlande vient de foirer lamentablement (Octobre 1798) et la flotte anglaise nous serre le kiki à la sortie de tous nos ports. Alors, cette victoire est une véritable aubaine pour le Directoire qui n’a pas attendu nos médias modernes pour faire sa pub ! Néanmoins, la presse de l’époque, notamment le Moniteur, reste très mesurée, rédigeant un article d’une petite vingtaine lignes avec, certes, l’abus d’emploi de superlatifs héroïques mais tout à fait dans l’esprit d’une presse de guerre. De toute façon, les faits d’armes de notre marine sont toujours restés très secondaires dans notre beau pays de terriens indécrottables…Surtout que nos conquêtes terrestres, à l’époque, font de l’ombre à ce genre d’action isolée.
En Grande-Bretagne :
La Royal Navy, avec la bataille d’Aboukir, vient de démontrer sa suprématie navale mais, en son sein, l’ambiance est loin d’être au beau fixe et les relations entre officiers et équipages sont souvent détestables. Elle a mal digéré les importantes mutineries, survenues un an plus tôt. Mutineries, justifiées par la maigreur de la solde, d’exécrables conditions de vie à bord, son système d’enrôlement par voie de presse (la capture physique et systématique de citoyens britanniques enrôlés, contre leurs grés, dans la Royal Navy), la sévérité extrême de son code de justice militaire et le mépris affiché par une grande partie du corps d’officiers vis à vis de leurs équipages (Nelson est une exception, d’où sa légende toujours existante…ceci dit, ce n’ était pas un tendre, non plus !). Le peuple anglais n’accepte pas facilement l’annonce de défaite même si la perte de l’Ambuscade n’est qu’un incident de guerre anodin et, de surcroit, la presse anglaise, véritable troisième pouvoir, est toujours prompte à désigner des coupables à la vindicte populaire. Ce qui fait que des années après et jusqu’à nos jours, le combat de l’Embuscade et la Bayonnaise reste un sujet sensible pour les historiens navals anglo-saxons.
Bien que le texte exploité soit des plus officiels, compte-rendu du combat extrait de la « Naval Chronicle », on constate un parti pris très net dans sa rédaction. Volonté de surévaluer les caractéristiques de la corvette française, l’effectif de son équipage et, à l’inverse, sous-estimer autant que possible ces mêmes éléments pour la frégate anglaise. L’explosion du canon dans la batterie et l’incendie à la poupe ne sont dus qu’à la malchance, en aucun cas à l’action du français. Attribution d’un rôle excessif à la troupe embarquée sur la Bayonnaise ; sans vouloir minimiser son apport précieux, il y a doute quant à la réelle qualité militaire d’un détachement de 30 soldats des Colonies, peu ou pas amarinés, qui viennent de passer un mois en mer, confinés dans une petite corvette, après un an et demi ou deux ans en affectation dans un environnement hostile tel que la Guyane de l’époque. Personnellement, j’accorderai plus de crédit à la vingtaine de fusiliers-marins britanniques, qui, eux, appartiennent à une unité d’élite réputée, sont parfaitement intégrés à la vie du bord et formés pour ce type de combat naval.
De même, l’accent est mis sur une mauvaise ambiance à bord de l’Ambuscade, excuse fort opportune qui trouve son origine dans les mutineries de la Royal Navy de 1797. Son équipage est décrit comme un rassemblement de gibiers de potence, de pauvres hères extraits des geôles anglaises et de mousses et novices inexpérimentés. En réalité, l’Ambuscade était en poste dans la flotte de blocus depuis suffisamment de temps pour que son équipage soit bien amariné. Elle n’avait fait qu’un simple aller-retour à Portsmouth, début décembre, pour y ramener des prises qu’elle avait faites en novembre et venait, quelques jours avant sa rencontre avec la Bayonnaise, d’en capturer encore deux autres.
Les témoignages français font état d’une défense acharnée et les dégâts et les pertes enregistrés par la Bayonnaise prouvent, au contraire, l’efficacité de la canonnade et de la mousqueterie anglaise.
Bibliographie & Sources :
Artillerie de Mer – France 1650-1850 – Collection Archéologie Navale Française – Jean Baudriot – Edition Ancre – 1992.
BNF – Paris – Divers documents officiels.
Guerres Maritimes sous la République et L’Empire – E. Jurien de la Gravière – Charpentier - 1860
Histoire de la Frégate Française – 1650-1850 – Collection Archéologie Navale Française – Jean Baudriot – Edition Ancre – 1993.
Nota : Une collection remarquable mais le prix très élevé, bien que justifié des ouvrages, incite à une consommation modérée.
La Grande Epopée de la Marine à Voile – Martine Acerra & Jean Meyer – Editions Ouest France Université – 1987
La Royale – Tome I – La vergue et le sabord – Jean Randier – Editions Marcel-Didier Vrac – 1978
Marine et Constructions Navales 1789-1989 – Ph.Masson, M.Battesti & JC.Favier – Editions Lavauzelle – 1989
Naval Warfare – Spencer C. Tucker - Sutton Publishing - 2000
Navire & Marins – Tome II – De la Rame à l’Hélice – G.La Roërie – Librairie Rombaldi – 1930 (réédition 1946).
Quand voguaient les galères – Association des Amis du Musée de la Marine & Editions Ouest-France – 1991.
The Arming and Fitting of English Ships of War – 1600-1815 – Brian Lavery – Art Marine – 1999
The Naval History of Great Britain – W. James – Richard Bentley (London) – 1837
The Naval History of Great Britain 1783-1822 – E.P. Brenton – Henry Coburn (London) – 1837
Voiliers de l’époque romantique (un titre à la noix), en réalité – Voiliers, aquarelle d’Antoine Roux – Edita Lausanne – 1968 (exemplaire numéroté N° 2093).
…et de vieux exemplaires de la revue NEPTUNIA, qu’on peut dénicher sur les étagères de la librairie du Musée de la Marine, à Paris.
Sur le Web, quasiment rien, hormis un excellent Glossaire des anciens termes de Marine, quelques travaux privés, de bonne qualité, sur la Marine Impériale et surtout l’excellent site du Service Historique de la Défense – Section Marine qui a eu récemment la bonne idée de mettre en ligne un bon nombres de documents et de plans d’époque…sauf que les dimensions de certains documents flirtent avec les 1,50m à 2m et qu’ils sont mis en ligne sous GIFF…une pure horreur !

